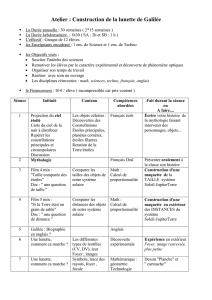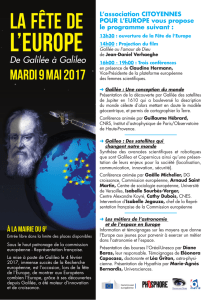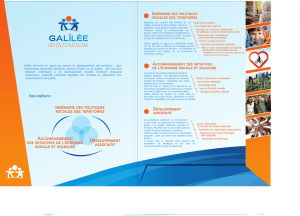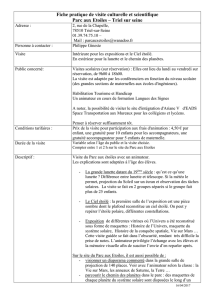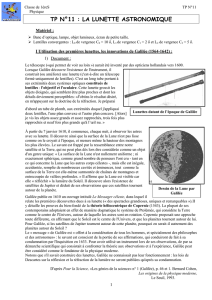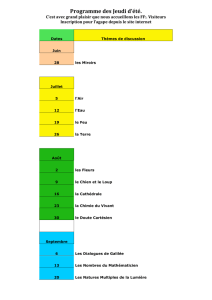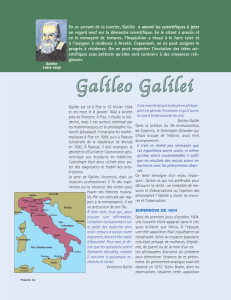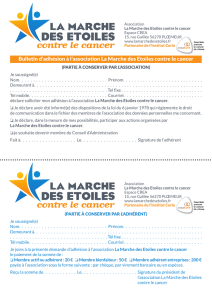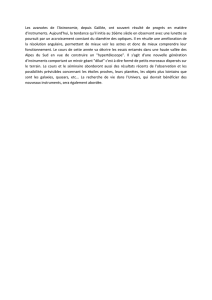la porte des étoiles

la porte des étoiles
le journal des astronomes amateurs du nord de la France
29
Numéro 29 - été 2015

Edition numérique sous Licence Creative Commons
A la une
Edito
Sommaire
4...........................................................Le(s) procès de Galilée
par Michel Pruvost
14................................................L’histoire de la lunette Arago
par André Amossé
23..................................................Histoires d’étoile : Arcturus
par Michel Pruvost
27........Une soirée avec la 49 de l’Observatoire de Strasbourg
par Simon Lericque
31...............................................................Souvenirs d’éclipse
Collectif
36.............................................................................. La galerie
Éclipse partielle de Soleil
Auteur : Simon Lericque
Date : 20/03/2015
Lieu : Warmeriville (51)
Matériel : APN Canon EOS7D,
hélioscope et lunette Orion 80ed
GROUPEMENT D’ASTRONOMES
AMATEURS COURRIEROIS
Adresse postale
GAAC - Simon Lericque
12 lotissement des Flandres
62128 WANCOURT
Internet
Site : http://www.astrogaac.fr
E-mail : [email protected]
Les auteurs de ce numéro
André Amossé - Membre du GAAC
E-mail : [email protected]
Site : http://astroequatoriales.free.fr
Michel Pruvost - Membre du GAAC
E-mail : [email protected]
Site : http://cielaucrayon.pagesperso-orange.fr/
Simon Lericque - Membre du GAAC
E-mail : [email protected]
Site : http://lericque.simon.free.fr
L’équipe de conception
Simon Lericque : rédac’ chef tyrannique
Arnaud Agache : relecture et diffusion
Catherine Ulicska : relecture et bonnes idées
Fabienne Clauss : relecture et bonnes idées
Olivier Moreau : conseiller scientifique
Il n’est pas dans nos habitudes de faire de la politique... Mais cette
fois, ‘‘ils’’ sont allés trop loin ! Comment est-il possible qu’en l’an
2015, l’obscurantisme et la bétise s’insinuent aussi sournoisement
dans nos écoles ? Comment peut-on donner comme consigne à des
enseignants de cloitrer les élèves dans une classe - de supprimer
récréations et sorties scolaires - alors que se déroule au-dessus de
leur tête l’un des plus fascinants spectacles que la nature puisse nous
offrir ? L’éclipse de Soleil du 20 mars dernier - puisque c’est de cela
dont il s’agit - est un phénomène astronomique dont le mécanisme
même est au programme des écoles et des collèges. Mais plutôt que
de développer un véritable projet pédagogique avec les enseignants et
leurs élèves, l’Éducation Nationale et son ministère ont préféré le sacro
saint principe de précaution. Heureusement, de courageux professeurs
ont tout de même tenu à montrer l’éclipse à leurs élèves malgré les
recommandations officielles... Bravo à eux ! Gageons qu’aucun gamin
n’aura perdu la vue après avoir observé l’éclipse du 20 mars dernier.

Nuit des Étoiles 2015
Le GAAC vous donne rendez-
vous le samedi 8 août sur le site
de la Ferme Pédagogique pour la
traditionnelle Nuit des Étoiles.
Au programme, espérons-le, de
belles observations du ciel.
Saint-Véran, le retour !
C’est reparti pour Saint-Véran !
L’équipe du GAAC montera à
l’Observatoire Astroqueyras du 6
au 13 septembre prochains pour
une mission dédiée aux galaxies
du Groupe Local.
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du
GAAC se déroulera le vendredi
18 septembre à Courrières,
l’occasion de faire le bilan de
cette sixième année d’existence,
en toute convivialité.
Retrouvez l’agenda complet de l’association sur http://www.astrogaac.fr/agenda.html
• • • • ACTU DU GAAC
C’était au printemps
Ce sera cet été
Conférence de Simon Lericque à Mont Bernenchon
Conférence de Marc Lachièze-Rey à Hellemmes
Rencontres Astronomiques de
Courrières 2015
Conférence d’Hubert Reeves à Lille
Animations astronomiques au
collège de Lesquin
Signature de la charte ANPCEN
par la commune de Ferques
Visite du CEA à Saclay
Rencontres Astronomiques du Printemps 2015
Réunion technique Astroqueyras
Exposition Mystérieuses
Aurores à Trilport
Nuit Astro de Grévillers du 13 juin 2015
Conférence d’Alain Ferreira
à l’Observatoire de Lille
Exposition ‘‘Système solaire : portraits de
famille’’ à Noeux-les-Mines
Conférence de Florent Deleflie à Villeneuve d’Ascq
21ème Nuit Noire du
Pas-de-Calais

La Porte des Etoiles n°29 4
Le(s) procès de Galilée
Par Michel Pruvost
d’après le livre d’Émile Namer ‘‘l’Affaire Galilée’’
L’arme du crime
Tout commence en juin 1609. Galilée est à Venise et c’est là qu’il
apprend qu’un artisan hollandais vient d’inventer une lunette capable
d’agrandir des objets lointains dans des proportions notables. Galilée
parvient à reproduire l’instrument et le présente au Sénat de Venise
suscitant l’étonnement de tous. D’emblée, la lunette est appréciée par
sa capacité à faire découvrir des navires fort éloignés du port et les très
nombreuses scènes de la vie vénitienne captées un peu partout dans
la ville depuis le sommet du campanile. Galilée souhaite en faire don
au Prince de Venise mais celui-ci n’acceptera pas, ne souhaitant pas
restreindre cet instrument au seul usage militaire. Toute cette publicité
faite autour de la lunette dite ‘‘de Galilée” permet à ce dernier de faire
face aux objections des nombreux sceptiques. Car, si le jour Galilée
intéresse les officiels avec sa lunette, le soir, depuis sa terrasse, il
observe le ciel et fait de stupéfiantes découvertes.
Une pièce à conviction
En mars 1610, Galilée publie “Le Messager Céleste”. Il y fait part de ses
découvertes astronomiques : “Ainsi l’évidence sensible fera connaître
à tous que la Lune n’est pas entourée d’une surface lisse et polie, mais
qu’elle est accidentée et inégale et, tout comme la surface de la terre,
recouverte de hautes élévations et de profondes cavités et anfractuosités. Mais ce qui passe en merveille
toute imagination et nous a surtout amené à nous adresser à tous les astronomes et philosophes, c’est d’avoir
découvert quatre étoiles errantes que personne avant nous n’avait connues ni observées.” Il s’agit des quatre
principaux satellites de Jupiter.
Galilée y fait aussi mention d’autres découvertes comme la nature de
la Voie lactée, des milliers de nouvelles étoiles et encore les phases de
Vénus. Tout cela l’a convaincu que le ciel n’est pas cette représentation
figée, parfaite et immuable qui était alors enseignée mais qu’il y a
communauté de nature entre la Terre et le ciel. Et puisque la Terre
est comme la Lune, éclairée par le Soleil, alors elle fait partie de ce
monde et comme les autres astres tourne sur elle-même et autour du
Soleil.
Alors que Copernic ou Giordano Bruno ne s’appuyaient que sur leur
seule intuition, Galilée invoque les découvertes faites avec la lunette
pour justifier et argumenter sa position. Il pense que le moment
est venu de balayer les anciennes croyances et de faire place à un
nouveau système du monde. Mais les réticences sont fortes. Le plus
grand philosophe de Padoue, Cremonini, un ami de Galilée, a refusé
de mettre l’œil à la lunette, argumentant qu’un tube métallique équipé
de deux lentilles ne pouvait remplacer la vue que Dieu avait donné
et qui, seule, permettait aux savants de fixer le nombre et les lois des
corps célestes.
Galilée fait la démonstration de sa lunette
Couverture du Sidereus Nuncius, le
Messager céleste
• • • • HISTOIRE

La Porte des Etoiles n°29 5
La préméditation
Fin août 1610, Galilée est de retour à Florence à la cour de Cosme II de Médicis.
À Venise, Galilée est trop occupé par ses charges pour se consacrer à son œuvre.
Il manque de temps. Il cherche donc à se rapprocher de la cour de Florence où il
pourra tout à loisir élaborer sa théorie héliocentrique du monde. La bonne nouvelle
tombe le 10 juillet 1610 quand il apprend qu’il est nommé mathématicien et
philosophe du Grand Duc de Toscane avec un traitement de mille écus florentins.
À Florence, Galilée reprend ses observations astronomiques. Il est grisé par ses
découvertes et il éprouve le besoin de les partager avec tous.
Son succès et la protection considérable que lui apporte son statut auprès des
Médicis ne suffisent pourtant pas à désarmer ses ennemis qui l’accusent de
supercherie et d’hallucination. Il faut donc qu’il frappe plus fort. Son but est
maintenant d’obtenir la consécration officielle de son travail à Rome. Ses
amis le pressent de s’y rendre afin d’écraser tous les sceptiques au nombre
desquels on trouve un certain Ludovico delle Colombe, personnage intriguant
et retors qui, pour appuyer sa polémique contre Galilée invoque désormais,
au côté des théories aristotéliciennes, l’autorité des Écritures et l’interdiction
faite par le concile de Trente d’en interpréter le texte. Face à ses détracteurs,
Galilée a beaucoup d’amis. En décembre 1610, il reçoit l’appui de Clavius,
une des principales autorités romaines qui lui montre une grande admiration
et qui consacre ainsi le triomphe scientifique de Galilée.
Galilée se sent prêt et quitte Florence
pour Rome à la fin de mars 1611. Dès
son arrivée, il se rend chez les pères
jésuites où il y rencontre Clavius. Il
apprend qu’ils observent depuis deux
mois les nouvelles “planètes médicéennes” et il compare avec eux
les positions qu’ils trouvent en tous points semblables. Les jésuites
cherchent à déterminer les périodes de ces planètes mais s’accordent à
dire que la tâche est difficile. C’est un triomphe pour Galilée qui obtient
la reconnaissance officielle de l’exactitude de ses observations.
Durant le mois d’avril 1611, Galilée est l’invité d’honneur des
cardinaux et des princes. Il est reçu par le souverain pontife, Paul V. Il
rencontre le cardinal Maffeo Barberini, le futur pape Urbain VIII qui
deviendra un de ses plus grands admirateurs. Il est reçu par le Prince
Cesi à l’Académie dei Lincei. Enfin, en mai 1611, le père jésuite Ode
Maelcote fait une communication intitulée “Le message céleste du
collège romain” signifiant ainsi le ralliement des jésuites aux thèses
galiléennes.
Un enquêteur aguerri : le cardinal Bellarmin
Roberto Francesco Bellarmino est un jésuite, archevêque de Capoue, cardinal et membre de l’inquisition
romaine. C’est lui qui a mené le procès de Giordano Bruno en 1600. Surnommé “le bastion de l’église”, il est
donc très sensible à ce qui touche la relation entre science et saintes écritures.
Alarmé par un manuscrit de Ludovico delle Colombe accusant Galilée d’introduire une hérésie nouvelle et
de donner une interprétation inexacte des écritures, le cardinal Bellarmin avait envoyé aux pères jésuites une
lettre afin de savoir exactement ce que la science pouvait réellement démontrer. Les jésuites lui avaient alors
répondu de façon claire et impartiale sur l’observation de nouvelles étoiles en particulier dans la Voie lactée, la
forme oblongue de Saturne, la croissance et la décroissance des phases de Vénus, l’aspect accidenté et inégal
Cosme II de Médicis
La Riposte de Galilée contre
Ludovico Delle Colombe
Christopher Clavius
• • • • HISTOIRE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
1
/
55
100%