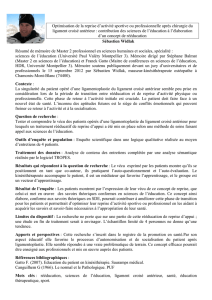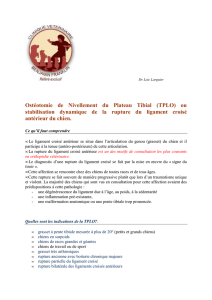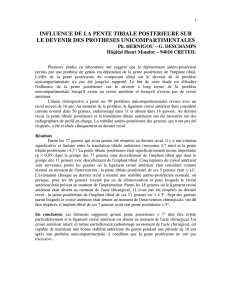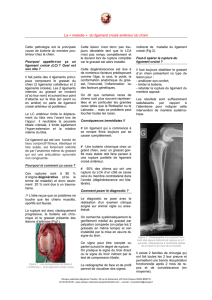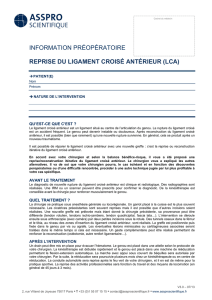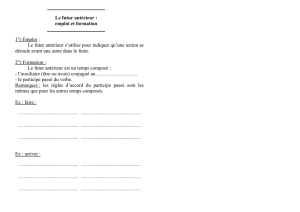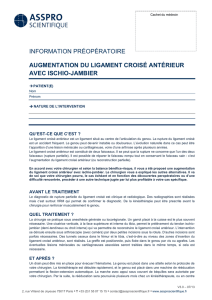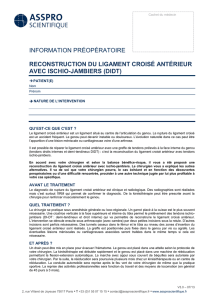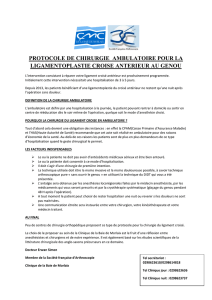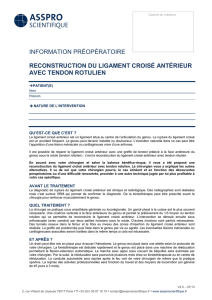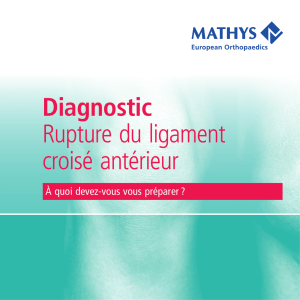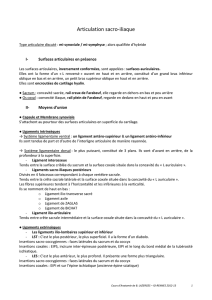Voir/Ouvrir

UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE -RABAT-
ANNEE: 200 THESE N°:
P
Pe
en
nt
te
e
t
ti
ib
bi
ia
al
le
e
e
et
t
r
ru
up
pt
tu
ur
re
e
d
du
u
l
li
ig
ga
am
me
en
nt
t
c
cr
ro
oi
is
se
e
a
an
nt
te
er
ri
ie
eu
ur
r
THESE
Présentée et soutenue publiquement le :………………………..
PAR
a) Mlle. Nada RIAHI
Née le 17 Novembre 1982 à Tanger
Pour l'Obtention du Doctorat en
Médecine
MOTS CLES Pente tibiale – Rupture du ligament croisé antérieur – Méthodes de mesure.
JURY
Mr. N. BOUSSELMAME PRESIDENT
Professeur Agrégé de Traumatologie Orthopédie
Mr. A. JAAFAR RAPPORTEUR
Professeur Agrégé de Traumatologie Orthopédie
Mr. A. BEZZA
Professeur Agrégé de Rhumatologie
Mr. F. ISMAEL
Professeur de Traumatologie Orthopédie
JUGES


D
Dé
éd
di
ic
ca
ac
ce
es
s

P
Pa
ar
r
l
la
a
G
Gr
râ
âc
ce
e
d
d’
’A
AL
LL
LA
AH
H,
,
l
le
e
T
To
ou
ut
t
P
Pu
ui
is
ss
sa
an
nt
t,
,
à
à
s
so
on
n
p
pr
ro
op
ph
hè
èt
te
e
M
Mo
oh
ha
am
mm
me
ed
d
(
(P
P.
.S
S.
.L
L)
)
J
Je
e
s
su
ui
is
s
s
se
eu
ul
le
e
à
à
s
si
ig
gn
ne
er
r
c
ce
et
tt
te
e
t
th
hè
ès
se
e
e
et
t
p
po
ou
ur
rt
ta
an
nt
t
d
de
e
n
no
om
mb
br
re
eu
us
se
es
s
p
pe
er
rs
so
on
nn
ne
es
s
o
on
nt
t
c
co
on
nt
tr
ri
ib
bu
ué
é
p
pa
ar
r
l
le
eu
ur
r
a
ai
id
de
e,
,
l
le
eu
ur
r
s
so
ou
ut
ti
ie
en
n
e
et
t
l
le
eu
ur
rs
s
c
co
on
ns
se
ei
il
ls
s
à
à
l
la
a
f
fa
ai
ir
re
e
e
ex
xi
is
st
te
er
r.
.
A
Al
lo
or
rs
s
à
à
v
vo
ou
us
s,
,
j
je
e
d
dé
éd
di
ie
e
c
ce
e
t
tr
ra
av
va
ai
il
l…
…

A
Au
ux
x
c
ci
in
nq
q
m
me
em
mb
br
re
es
s
d
de
e
m
ma
a
p
pe
et
ti
it
te
e
f
fa
am
mi
il
ll
le
e,
,
c
ce
eu
ux
x
q
qu
ui
i
c
co
om
mm
me
e
u
un
ne
e
c
co
on
ns
st
te
el
ll
la
at
ti
io
on
n
d
d’
’é
ét
to
oi
il
le
es
s
m
m'
'e
en
nt
to
ou
ur
re
en
nt
t,
,
m
m'
'é
éc
cl
la
ai
ir
re
en
nt
t
d
de
e
l
le
eu
ur
r
a
am
mo
ou
ur
r
e
et
t
l
le
eu
ur
r
t
te
en
nd
dr
re
es
ss
se
e
e
et
t
q
qu
ui
i
m
me
e
r
ré
ép
pè
èt
te
en
nt
t
:
:
«
«
F
Fo
on
nc
ce
e
N
No
ou
un
no
ou
u,
,
o
on
n
t
t'
'a
ai
im
me
e
t
to
ou
uj
jo
ou
ur
rs
s
!
!
M
Ma
al
lg
gr
ré
é
t
to
ou
ut
t
!
!
»
»
A
A
m
ma
a
p
pl
lu
us
s
b
be
el
ll
le
e
r
ra
ai
is
so
on
n
d
de
e
v
vi
iv
vr
re
e
A
A
m
me
es
s
t
tr
rè
ès
s
t
te
en
nd
dr
re
es
s
p
pa
ar
re
en
nt
ts
s
M
Mr
r.
.
M
Me
ed
d
K
Kh
ha
al
li
il
l
R
Ri
ia
ah
hi
i
e
et
t
M
Mm
me
e
H
Ha
af
fs
sa
a
M
Me
es
sb
ba
ah
h.
.
Q
Qu
ue
e
d
di
ir
re
e…
….
.
S
Si
i
c
c’
’é
ét
ta
ai
it
t
a
av
ve
ec
c
d
de
es
s
l
li
ig
gn
ne
es
s
q
qu
u’
’o
on
n
p
po
ou
uv
va
ai
it
t
e
ex
xp
pr
ri
im
me
er
r
l
l’
’a
am
mo
ou
ur
r,
,
l
le
e
d
dé
év
vo
ou
ue
em
me
en
nt
t,
,
l
le
e
r
re
es
sp
pe
ec
ct
t,
,
e
et
t
l
l’
’a
af
ff
fe
ec
ct
ti
io
on
n,
,
t
to
ou
ut
t
l
l’
’e
en
nc
cr
re
e
d
du
u
m
mo
on
nd
de
e
n
ne
e
m
me
e
s
su
uf
ff
fi
ir
ra
ai
it
t
p
pa
as
s
p
po
ou
ur
r
t
tr
ra
ad
du
ui
ir
re
e
m
me
es
s
s
se
en
nt
ti
im
me
en
nt
ts
s
e
en
nv
ve
er
rs
s
l
le
es
s
p
pl
lu
us
s
m
me
er
rv
ve
ei
il
ll
le
eu
ux
x
d
de
es
s
ê
êt
tr
re
es
s.
.
J
Je
e
v
vo
ou
us
s
r
re
em
me
er
rc
ci
ie
e
p
po
ou
ur
r
v
vo
ot
tr
re
e
a
am
mo
ou
ur
r,
,
v
vo
ot
tr
re
e
é
ét
te
er
rn
ne
el
ll
le
e
d
di
is
sp
po
on
ni
ib
bi
il
li
it
té
é,
,
v
vo
os
s
p
pr
ri
iè
èr
re
es
s,
,
p
po
ou
ur
r
v
vo
os
s
e
en
nc
co
ou
ur
ra
ag
ge
em
me
en
nt
ts
s,
,
v
vo
os
s
n
no
om
mb
br
re
eu
ux
x
c
co
on
ns
se
ei
il
ls
s
a
av
vi
is
sé
és
s,
,
p
po
ou
ur
r
l
la
a
c
co
on
nf
fi
ia
an
nc
ce
e
q
qu
ue
e
v
vo
ou
us
s
m
me
e
p
po
or
rt
te
ez
z,
,
p
po
ou
ur
r
l
le
es
s
s
sa
ac
cr
ri
if
fi
ic
ce
es
s
q
qu
ue
e
v
vo
ou
us
s
a
av
ve
ez
z
c
co
on
ns
se
en
nt
ti
i
p
po
ou
ur
r
m
mo
on
n
é
éd
du
uc
ca
at
ti
io
on
n
e
et
t
m
mo
on
n
b
bi
ie
en
n
ê
êt
tr
re
e
e
et
t
e
en
nf
fi
in
n
p
po
ou
ur
r
m
m’
’a
av
vo
oi
ir
r
t
to
ou
ut
t
a
ap
pp
pr
ri
is
s.
.
J
Je
e
n
ne
e
v
vo
ou
us
s
s
se
er
ra
ai
i
j
ja
am
ma
ai
is
s
a
as
ss
se
ez
z
r
re
ec
co
on
nn
na
ai
is
ss
sa
an
nt
te
e
d
de
e
c
ce
e
q
qu
ue
e
v
vo
ou
us
s
a
av
ve
ez
z
f
fa
ai
it
t
p
po
ou
ur
r
m
mo
oi
i.
.
S
Sa
an
ns
s
v
vo
ou
us
s
j
je
e
n
n’
’a
au
ur
ra
ai
is
s
j
ja
am
ma
ai
is
s
p
pu
u
a
al
ll
le
er
r
a
au
u
b
bo
ou
ut
t.
.
V
Vo
ou
us
s
ê
êt
te
es
s
m
ma
a
s
so
ou
ur
rc
ce
e
d
de
e
m
mo
ot
ti
iv
va
at
ti
io
on
n.
.
J
Je
e
p
pr
ri
ie
e
l
le
e
G
Gr
ra
an
nd
d
D
Di
ie
eu
u
d
de
e
v
vo
ou
us
s
p
pr
ro
oc
cu
ur
re
er
r
s
sa
an
nt
té
é
e
et
t
l
lo
on
ng
gu
ue
e
v
vi
ie
e,
,
e
et
t
d
de
e
m
m’
’a
ai
id
de
er
r
à
à
v
vo
ou
us
s
r
re
en
nd
dr
re
e
u
un
ne
e
é
én
ni
iè
èm
me
e
p
pa
ar
rt
ti
ie
e
d
de
e
c
ce
e
q
qu
ue
e
v
vo
ou
us
s
m
m’
’a
av
ve
ez
z
d
do
on
nn
né
é.
.
Q
Qu
ue
e
c
ce
et
tt
te
e
t
th
hè
ès
se
e
v
vo
ou
us
s
a
ap
pp
po
or
rt
te
e
l
la
a
j
jo
oi
ie
e
d
de
e
v
vo
oi
ir
r
a
ab
bo
ou
ut
ti
ir
r
v
vo
os
s
e
es
sp
po
oi
ir
rs
s
e
et
t
j
j’
’e
es
sp
pè
èr
re
e
a
av
vo
oi
ir
r
é
ét
té
é
d
di
ig
gn
ne
e
d
de
e
v
vo
ot
tr
re
e
a
am
mo
ou
ur
r.
.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
1
/
107
100%