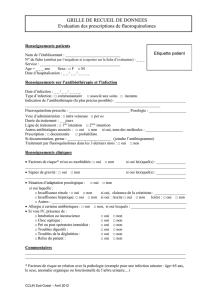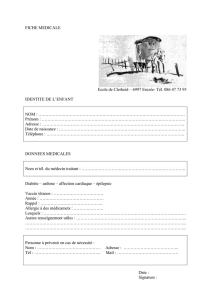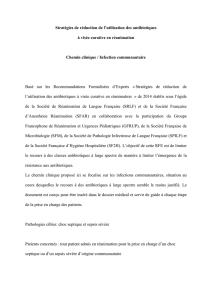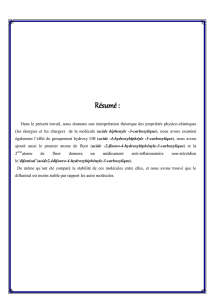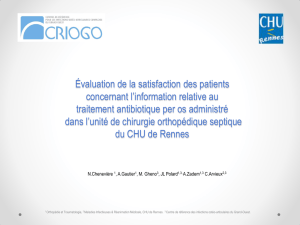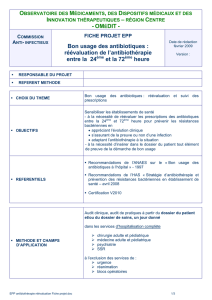L`essentiel à retenir des recommandations de bonnes pratiques en

L’essentiel à retenir des recommandations de bonnes pratiques en pédiatrie
volume 1
108947 10/12/07 15:56 Page 1

Index des mots clés
Allergie alimentaire 6
Anaphylaxie 6
Angine 8
Asthme 21
Asthme aigu grave 21
Autisme 28
Bandelette urinaire 19
Biberon (préparation, conservation) 30
Blépharite 17
Bordetella pertussis 36
Calendrier vaccinal 32
Carie dentaire 34
Chalazion 17
Coqueluche 36
Conjonctivite 17
Dacryocystite 17
Dermatite atopique 24
Déshydratation aiguë 42
Diarrhée aiguë 42
ECBU (examen, cytobactériologique
des urines) 19
Fluor 34
Fluorose dentaire 34
Folliculite superficielle 13
Furoncles 13
Gale 39
Gale commune 39
Gale profuse 39
Gastrite 41
Gastroentérite 42
Helicobacter pylori 41
HRB (hyperréactivité bronchique) 21
Impétigo 13
Infection cutanée 13, 39
Infection urinaire 19
Intertrigo 13
Kératite 17
Lait maternel (conservation) 30
Œil rouge 17
Orgelet 17
Otite externe 15
Otite moyenne aiguë 10
Otorrhée 15
Otorrhée sur aérateur
transtympanique 15
Perforation tympanique 15
Plaie cutanée 13
Pyélonéphrite aiguë 19
Reflux vésico-urétéral 19
Réhydratation orale 42
Rhinopharyngite 10
Scorad (scoring
of atopic dermatitis) 24
Sinusite 8
Stérilisation des biberons 30
Troubles envahissants du
développement 28
Troubles de la communication 28
Ulcère duodénal 41
Vaccins 32
Xérose 24
108947 10/12/07 15:56 Page 2

Direction scientifique et rédaction : Guy Dutau, Christian Copin, Robert Cohen, Olivier Mouterde.
Conseils à la rédaction : Marc Koskas, Jérôme Valleteau de Moulliac.
Le contenu rédactionnel de cette publication est indépendant de Sanofi Pasteur MSD. Les articles
sont publiés sous la seule responsabilité de la revue Médecine et enfance et des auteurs.
Médecine et enfance est répertoriée dans la banque de données CNRS/PASCAL de l’INIST et dans
le CISMEF du CHU de Rouen (www.cismef.org).
Allergies alimentaires
6
Asthme : suivi médical
21
Prise en charge de
la dermatite atopique
24
Autisme : dépistage
et diagnostic
28
Préparation et conservation
des biberons au domicile
30
Calendrier vaccinal 2007
32
Fluor et prévention de la carie
dentaire
34
Conduite à tenir devant un
ou plusieurs cas de coqueluche
36
Conduite à tenir devant un
cas de gale
39
Eradication d’Helicobacter
pylori
41
Gastroentérites : utilisation
des solutés de réhydratation
orale
42
Antibiothérapie par voie
générale dans les infections
respiratoires hautes
10
Antibiothérapie locale
dans les infections cutanées
bactériennes
13
Antibiothérapie locale
en ORL
15
Collyres et autres topiques
antibiotiques dans
les infections oculaires
superficielles
17
Diagnostic et antibiothérapie
des infections urinaires
bactériennes communautaires
19
Sommaire
108947 COA 03 12/12/07 17:53 Page 3

A paraître dans le volume 2
Direction scientifique : C. Copin, R. Cohen,
F. Corrard, G. Dutau, E. Fournier-Charrière,
J. Lechevallier, O. Mouterde
Asthme et allergie
Douleur
Fièvre
Infections respiratoires basses
Maladie de Lyme
Maladies à déclaration obligatoire
Migraine, céphalées
Mort subite du nourrisson
Obésité
Pédiculose
Pieds : déformations congénitales isolées
des pieds
Plomb : intoxication dépistage et prise
en charge
Purpura fulminans
Tuberculose
Traitement de l’acné
Urticaire chronique
108947 10/12/07 15:56 Page 4

janvier 2008
page 5
Médecine
& enfance
Au cours des vingt dernières années, la « médecine basée sur les preu-
ves »
(1)
est devenue indispensable à la conduite du diagnostic et du traite-
ment des maladies. Pour Sackett et al.
(2)
, c’est « l’utilisation consciencieu-
se, explicite et judicieuse des meilleures preuves ou données scientifiques
actuelles dans la prise en charge personnalisée des patients ». Cette nou-
velle façon de penser et d’agir se veut, en particulier, plus précise et plus
économe. Elle fait table rase des recettes empiriques, même si l’expérien-
ce médicale collective n’est pas à ranger aux oubliettes. Les conférences
de consensus et les recommandations se nourrissent des avis d’experts
et, surtout, des méta-analyses, un concept dont Archie Cochrane fut l’ini-
tiateur
(3)
.
Toutefois, les recommandations publiées par les instances publiques
et/ou par les sociétés scientifiques ne sont connues que d’un petit
nombre de médecins et, pour l’instant, ne sont pas toujours accessibles
au praticien dans son exercice quotidien. Il nous a donc paru utile de tirer
la quintessence de ces textes officiels dans un but d’information didac-
tique, sans nous substituer aux textes, et en donnant au début de chaque
article les liens avec le texte originel. Le lecteur remarquera que certaines
recommandations datent déjà de quelques années (aucune d’elles n’est
antérieure à 2002). Elles ne sont pas pour autant obsolètes, jusqu’à ce
que l’évolution de la matière rende indispensable la formulation de nou-
velles recommandations. Ce premier volume sera suivi d’un deuxième et,
peut-être, d’autres encore. D’ores et déjà nous remercions le laboratoire
Sanofi Pasteur MSD de nous avoir soutenu dans cette entreprise.
(1) C’est l’evidence based medicine (EBM) des auteurs anglo-saxons. Le terme de «médecine basée sur les niveaux de preuve»
est préférable.
(2) «Evidence based medicine : what it is and what it isn’t», Brit. Med. J., 1996; 13: 71-2.
(3) On lira avec profit le superbe ouvrage de F. Xavier Bosch : Archie Cochrane. Back to the Front, Thau SL, Barcelona, 2003.
108947 10/12/07 15:56 Page 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%