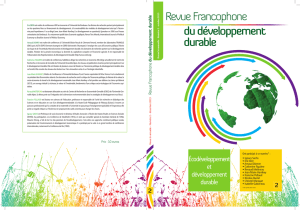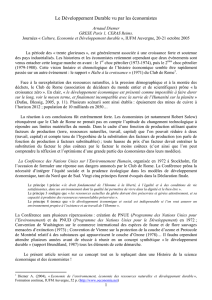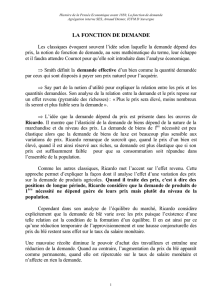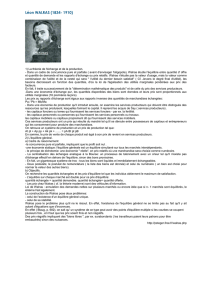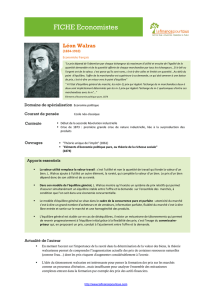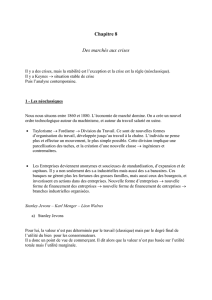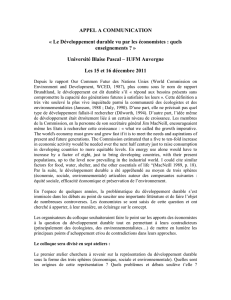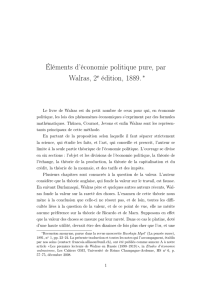De l`économie politique à la science économique

1
MEMOIRE DE SYNTHESE
De l’économie politique
à la science économique :
Le pari de la transdisciplinarité
Dossier d’Habilitation à Diriger la Recherche (HDR)
Arnaud DIEMER
TRIANGLE, OR2D
Sous la direction d’André TIRAN
Soutenance le mardi 16 février 2016, 14h 00
Université Lyon 2, Quai des Berges
JURY : Alain ALCOUFFE, Jérôme BLANC, Dominique BOURG, Robert
BOYER, Ludovic FROBERT, Roger GUESNERIE, Serge LATOUCHE, Jérôme
LALLEMENT, Alain LEGARDEZ, Basarab NICOLESCU, Jean-Pierre POTIER,
André TIRAN

2

3
Introduction
Les travaux de recherche qui sont présentés ici, relèvent de trois domaines principaux, à
savoir l’histoire des sciences et de la pensée économique ; la diversité du capitalisme
européen ; le développement durable et son éducation. Ces domaines de recherche ont
comme points communs de partager une analyse conceptuelle (que ce soit dans le cadre de
l’émergence d’une nouvelle discipline, le passage de l’économie politique à la science
économique (Diemer, 189); d’un nouveau paradigme, le développement durable ou la
décroissance (Diemer, 70, 93, 124, 125), ou encore de l’émergence d’un nouveau courant de
pensée, la diversité du capitalisme européen (Diemer, 192) et une démarche, la
transdisciplinarité (Diemer, 177). Ce dernier point servira de fil conducteur dans la
présentation de nos travaux.
En effet, l’histoire des sciences nous révèle que le découpage du savoir n’est pas une chose
récente (Diemer, 223). Dans les six livres de l’Organon, Aristote (384-322 av. J.C.) proposait
de partager le savoir en trois domaines correspondant à des champs de l’activité humaine : la
création ou l’art ; la pratique ou la morale, la théorie ou la science (elle-même décomposée
en mathématiques, physique, théologie). A partir d’une somme de connaissances issues de
plusieurs disciplines (biologie, physique, astronomie…) et basées sur le couple
observation/expérimentation, Aristote put établir une classification des êtres vivants, en
partant du principe que tous les êtres vivant ont une âme, mais une âme de nature différente
(âme nutritive, âme sensitive, âme appétitive, âme locomotrice…). L’homme se distingue de
tous les êtres vivants car il est le seul à posséder une âme rationnelle. Fort de ce
raisonnement, Aristote édifia une échelle de la Nature, caractérisée par des seuils de
complexité croissante de l’âme – de la matière inanimée en passant par les plantes… les
méduses, les mollusques… jusqu’aux mammifères et l‘Homme.
Cette classification méthodique des savoirs et des connaissances en logique des systèmes1
(Diemer, 191, 216, 222) sera également présente au Moyen Âge avec les systèmes
théocentriques (Dieu préside l’Ordre) et au 17e siècle, avec les travaux de Francis Bacon et
son système anthropocentrique. Dans son Novum Organum (1650), Bacon rappelle que la
méthode scientifique consiste à n’admettre comme vrais que les faits dont l’observation et
l’expérience ont démontré la réalité, et comme vérités que les conclusions que l’on peut
1 Que l’on peut opposer à une classification plus alphabétique (inventaire) présente dans l’Encyclopédie de
Diderot et D’Alembert (siècle des lumières).

4
naturellement en tirer « Notre méthode consiste à établir divers degrés de certitude, à
secourir les sens en les restreignant, à proscrire le plus souvent le travail de la pensée qui sui
l’expérience sensible, enfin à ouvrir et garantir à l’esprit une route nouvelle et certaine qui
ait son point de départ dans cette expérience même » (Bacon, 1857, p. 2).
Au 19e siècle, cette classification des connaissances et des sciences s’appuie sur trois
œuvres principales : l’Essai sur la philosophie des sciences d’Ampère ; la Philosophie
positive de Comte et l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale de Bernard.
Dans son Essai sur la philosophie des sciences (enseigné sous la forme de leçons au
Collège de France de 1832 à 1833), André-Marie Ampère (1834, 1843) propose un principe
méthodologique de classification des connaissances humaines qu’il associe à une science, la
mathésiologie. Cette dernière se propose d’établir, d’une part, les lois qu’on doit suivre dans
l’étude ou l’enseignement des connaissances humaines, et de l’autre, la classification
naturelle de ces connaissances. Au delà de l’aspect formel de la classification, la démarche
scientifique s’appuie sur quatre étapes importantes : le recueil des faits ; l’analyse des faits ;
la comparaison des faits et la déduction des lois ; l’étude des causes et des effets : « Quel que
soit l’objet de ses études, l’homme doit recueillir les faits, soit physiques, soit intellectuels ou
moraux ; il faut ensuite qu’il cherche ce qui est en quelque sorte caché sous ces faits ; ce
n’est qu’après ces deux genres de recherches qui correspondent aux deux points de vue
subordonnés compris dans le premier point de vue principal, qu’il peut comparer les
résultats obtenus jusque là, et en déduire les lois générales ; comparaisons et lois qui
appartiennent également au troisième point de vue subordonné : alors il peut remonter aux
causes des faits qu’il a observés sous le premier, analysés dans le second et comparés,
classés et réduits à des lois générales dans le troisième ; cette recherche des causes de ce
qu’il a appris dans les trois premiers points de vue, et celle des effets qui doivent résulter de
causes connues, constituent le quatrième point de vue subordonné, et complètement ainsi tout
ce qu’il est possible de savoir sur l’objet qu’on étudie » (1834, p. XIX).
Dans sa Philosophie positive, Auguste Comte (1830-1842) propose de se débarrasser de la
métaphysique2 (la philosophie sera constituée à l’état positif) et de regarder tous les
phénomènes comme assujettis à des lois invariables. Il ne s’agit pas de rechercher les causes
premières ou finales des phénomènes mais d’analyser « les circonstances de leur
production », de les rattacher « les uns aux autres par des relations de succession et de
similitude » (1929, vol I, p. 24). Le but de la philosophie positive est ainsi de résumer les
connaissances acquises pour les coordonner en les présentant comme autant de branches d’un
tronc commun. Selon Auguste Comte, cette démarche est nécessaire car toutes les sciences
ont été cultivées par les mêmes esprits : à mesure que les diverses conceptions se
développent, chaque branche du système scientifique se sépare insensiblement du tronc,
lorsqu’elle a pris assez d’assurance pour s’émanciper. Ainsi, si la division du travail
intellectuel fait partie des prodigieux résultats de la démarche scientifique, elle s’est
également accompagnée d’écueils liés à la spécialisation exagérée. Auguste Comte propose
2 « Il y a deux siècles, la philosophie positive a commencé son opposition contre l’esprit théologique et
métaphysique par l’action combinée des préceptes de Bacon, des conceptions de Descartes et des découvertes
de Galilée. Depuis cette époque, le mouvement d’ascension de la philosophie positive et le mouvement de
décadence des deux autres philosophies ont été bien marqués » (Comte, 1929, vol I, p. 25).

5
« qu’une nouvelle classe de savants, préparée par une éducation convenable, sans se livrer à
la culture spéciale d’aucune science, s’occupe à déterminer l’esprit de chacune d’elle, à
découvrir leurs relations et leur enchainement, à résumer, s’il est possible, tous leurs
principes en un moins grand nombre » (Comte, 1929, vol I, p. 28). La philosophie positive
s’attèle à articuler les disciplines entre elles. Il s’agit de partir des mathématiques3 pour aller
vers la sociologie (surplombant l’ensemble), en passant successivement par l’astronomie, la
physique, la chimie et la biologie. Chaque science est fondée sur les lois principales de la
précédente, tout en fondant les lois de la suivante.
Enfin, dans l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865) et la Science
expérimentale (1878), Claude Bernard systématise la méthode expérimentale en assignant
aux sciences exactes, une fonction prédictive : « Je me propose de démontrer que les
phénomènes des corps vivants sont, comme ceux des corps bruts, soumis à un déterminisme
absolu et nécessaire » (1878, p. 40). Selon le principe du déterminisme, une fois qu’une loi
est établie entre la cause et l’effet, la science exacte peut remonter de l’effet observé jusqu’à
la cause ou prédire l’effet lorsque la cause apparaît. Cette approche permet de classer les
connaissances humaines tout en rejetant du domaine scientifique, les sciences humaines. En
effet, ces dernières seraient incapables d’établir des lois entre les actions des hommes et leurs
effets, et donc de prédire avec exactitude les comportements humains. Ce serait ainsi le cas
avec l’économie, elle permet de comprendre et d’expliquer, a postériori, l’émergence et la
nature des crises, mais serait incapable de les prédire avec certitude.
Si la classification des sciences du 19e siècle permet de clarifier le champ de la connaissance,
elle fait également émerger des difficultés. D’une part, elle engendre l’hyperspécialisation et
le renfermement des disciplines sur elles-mêmes. D’autre part, la complexité du réel
s’accorde mal avec cette tendance humaine à vouloir étiqueter, séparer et simplifier
l’ensemble des connaissances. Ainsi, les efforts doivent être plutôt tournés vers une définition
de la science sans pour autant fermer la porte à de nouvelles méthodes scientifiques, à de
nouvelles façons de découper le réel en objets d’études. Il s’agit également de reconnecter les
disciplines découpées en classes et sous-classes. Dans Logique et connaissances scientifique
(1967) et L’interdisciplinarité : problèmes d’enseignement et de recherche dans les
universités (1972), Jean Piaget a été amené à concevoir le système des sciences4 (domaines
disciplinaires) non plus comme linéaire mais revenant sur lui-même en une spirale sans fin.
Cette approche repose sur une vision structuraliste des relations interdisciplinaires. Piaget
note que la structure présente de nombreuses propriétés : (i) contrairement aux lois des
sciences purement déductives (mathématiques, logique), la structure introduit dans le réel un
ensemble de connexions nécessaires ; (ii) elle dépasse la frontière des phénomènes et prend
en compte des liaisons non observables ; (iii) elle aboutit ainsi à modifier profondément notre
notion de la réalité. Selon Piaget, les conséquences de telles propriétés sont claires : « rien ne
3 Les mathématiques occupent la première place parce qu’elles permettent à chacune des autres disciplines
d’appliquer la puissance du raisonnement formel. La science mathématique est la science qui a pour but la
mesure des grandeurs.
4 Piaget distingue le domaine matériel (portant sur l’objet des disciplines), le domaine conceptuel (portant sur
l’ensemble des connaissances et des théories du domaine), le domaine épistémologique interne (portant sur le
rôle du sujet et la critique des théories) et un domaine épistémologique dérivé (portée épistémologique des
résultats de la discipline en rapport à l’ensemble du champ de la connaissance).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
1
/
171
100%