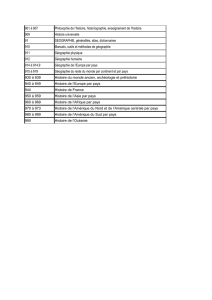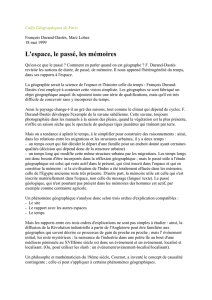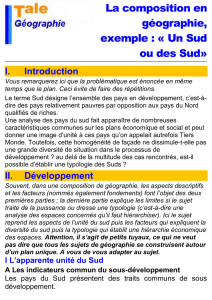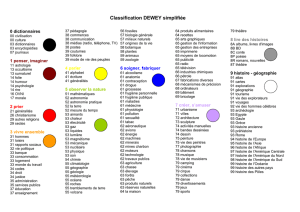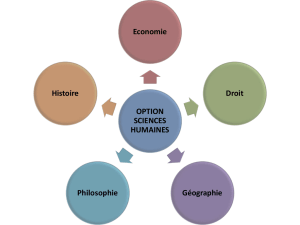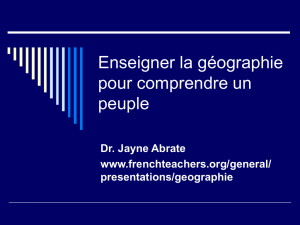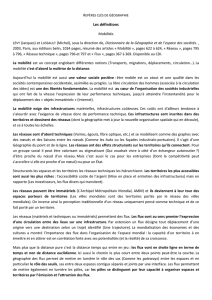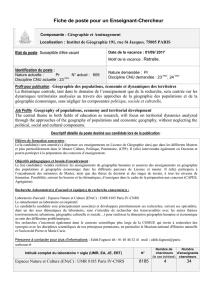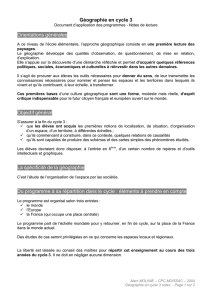Texte 1 - Département de Géographie de l`ENS

1
Subjectivité, socialité, spatialité :
Le corps, cet impensé de la géographie sociale
Subjectivity, sociality, spatiality:
The Body in Social Geography
Guy Di Méo
Professeur à l’Université de Bordeaux
ADES UMR 5185 du CNRS
Résumé : Cet article argumente en faveur de la prise en compte du corps humain comme
objet géographique. Il constate que le corps reste, à ce jour et à quelques exceptions près, plus
nombreuses depuis le début des années 2000, un impensé de la géographie sociale française,
à la différence de ce que l’on observe dans les écrits géographiques en langue anglaise.
C’est-à-dire une réalité toujours présente dans son propos, mais jamais explicitée ni évoquée
dans les problématiques, théories et méthodes que construisent ou utilisent les géographes.
L’auteur replace ici le corps dans une conception personnelle de la géographie sociale. Il en
fait le point de rencontre des rapports du social, du spatial et du sujet. Le corps est envisagé
sous cinq angles qui en éclairent l’intérêt géographique. Il est d’abord conçu comme un
espace générateur d’espaces, puis comme un organisme vivant, objet et sujet d’une écologie
humaine. L’accent est mis ensuite sur sa fonction de médium des interactions et de la
communication des individus dans l’espace social. Les deux dernières parties portent sur son
rôle identitaire : d’abord observé en regard de l’image de soi qu’il contribue à produire et du
point de vue de la distinction sociale ; puis analysé en tant qu’incorporation du social, du sexe
et du genre, mais aussi des attaches territoriales (embodiment).
Mots-clés : communication, corps, écologie humaine, espace géographique, incorporation,
identité, individu, interaction symbolique, société, sujet, territoire.
Abstract: This article argues that the human body should be considered as a geographical
object. The body is still largely unthought-of in the field of French social geography -very
different state in the English language one-, even if more and more exceptions can be found,
particularly since the beginning of the 2000s. Though it is always present, it never appears
clearly in the problems, theories, and methods used or constructed by geographers. The author
of this article replaces the body in a personal conception of social geography. According to
him, the body constitutes the place in which the relations between subject, space, and social
facts intersect. The body is considered in five different ways that shed light on its
geographical interest. First, it is seen as a space generating spaces, then as a living organism
that is both the object and the subject of a human ecology. The article also lays stress on its
function as medium allowing individuals to interact and to communicate within social space.
The last two parts are devoted to the role the body plays regarding questions of identity: first,
it is studied in relation to the self-image it contributes to produce and in relation to the point
of view of social distinction; then it is studied as an incorporation of social, sex, gender and
territorial dimensions (embodiment).
Keywords: body, communication, geographical space, human ecology, identity, embodiment,
individual, society, subject, symbolical interaction, territory.
*Mes remerciements vont à Marie-José Claverie, pour ses recherches documentaires et pour ses traductions.

2
La géographie sociale (Di Méo, 1998 ; Di Méo, Buléon, 2005) s’efforce de comprendre la
nature des rapports qui se nouent entre les êtres humains, sujets conscientisés, individus
organisés en sociétés, personnes socialement qualifiées et l’espace géographique. Attentive
aux jeux de co-construction qui se développent entre rapports sociaux et spatiaux, entre
individus et groupes d’une part, espaces géographiques d’autre part (jeux producteurs de lieux
et de territoires), elle tient le plus grand compte des processus de territorialisation et de
mobilité qui configurent de tels rapports. Cette démarche accorde un fort crédit à la
structuration sociale de l’espace géographique. Elle fait tout autant cas de la compétence et de
la mémoire de chaque sujet socialisé, percevant et se représentant, par son expérience
personnelle, les situations de son existence, mais agissant aussi au gré des interactions
multiples qui accompagnent, au quotidien, ses pratiques de l’espace.
À partir de ce canevas, je voudrais mettre l’accent, ici, sur un continuum majeur, que
je n’hésite pas à qualifier de fondateur de toute géographie sociale. Il s’agit du continuum, ou
succession quasi-insensible d’états de l’être humain passant par les figures enchaînées, voire
confondues du sujet (conscience), de l’individu, de la personne, de l’acteur, du groupe social
(communauté, classe, caste…). Continuum que l’on pourrait d’ailleurs étendre, en se référant
aux phénomènes de co-construction plus haut pointés, aux lieux, territoires et réseaux
spatialisés fonctionnant comme autant de scènes vivantes, constitutives d’une activité sociale
qui, en même temps, les produit.
Ce continuum, comme les éléments ou états qui le composent est, bien entendu, une
représentation. On peut le rattacher à une interprétation spinozienne de la réalité
s’opposant au dualisme cartésien. Le monisme de Baruch Spinoza rétablit en effet une
sorte d’unité de l’humain et de l’espace, de l’idéel et du matériel, en leur donnant le
statut d’une « substance infinie » et unique, à la fois matière et esprit dont les attributs
tangibles seraient la pensée et l’étendue. Ces deux dernières se manifesteraient à notre
perception, à nos sens, par les esprits et les corps confondus, spatialisés ; ceux des
humains, des animaux, sans parler, dans leur plus simple matérialité (jamais unique), de
tous les objets qui se situent dans le rapport géographique. Cette conception offrirait la
caractéristique de ne pas séparer substantiellement les corps des esprits et, par
conséquent, de confondre la matérialité géographique des premiers avec l’idéalité et
l’abstraction des seconds. Elle conférerait ainsi aux consciences une sorte de surface ou
de consistance géographique (corporelle, incorporée), une appartenance légitime à
l’étendue, redonnant au corps toute sa puissance, aussi bien ontologique que
géographique, ontique.
Je peux représenter ce continuum par un triangle équilatéral dont les sommets
seraient, pôles extrêmes, le sujet humain dans toute sa profondeur, intime et secrète, ses
groupes sociaux constitués et l’espace à la fois nature et produit par l’action de tous (figure 1).
La base du triangle figurerait le passage en continu du sujet au groupe, par les étapes fictives
de l’individu, de la personne et de l’acteur. Le côté groupes sociaux/espace serait, de la même
façon, jalonné par les stades du lieu et du territoire. Quant au côté sujet/espace, il égrainerait
les moments tantôt phénoménologiques de la « géographicité », tantôt plus structuraux de la
spatialité ; voire des séquences participant de ces deux ordres de la connaissance et de
l’expérience sensible, comme dans le cas de la territorialité.
Dans cette optique, je pose comme postulat (en m’inspirant de Spinoza) que d’un point
de vue anthropologique et géographique, on ne saurait réduire un tel continuum à de seuls
états de consciences, à des flux sociaux ou à des jeux abstraits de représentations, comme
déconnectés de toute matérialité. Pas plus d’ailleurs qu’on ne saurait le ramener à une pure

3
réalité objective, matérielle et distancée du sujet humain qui la vit ou qui l’observe. C’est à ce
niveau que le corps humain
1
(bien sûr conscientisé, socialisé, sexué/genré, ethnique,
particularisé -handicaps, âge, etc.- et spatialisé) doit faire son entrée sur la scène sociale et
géographique, en tant qu’interface active, que protagoniste à part entière des procès et
systèmes spatiaux. La figure 2 traduit de quelle façon le corps occupe des positions
articulaires sur chacun des trois côtés stratégiques du triangle de la géographie sociale. Si l’on
projette fictivement le « sujet » (pure conscience) sur le côté opposé du triangle (groupes
sociaux/espace), son installation dans le continuum social/spatial passe inévitablement par le
principe d’incorporation spatiale du social subjectivé. Le corps (C1), en tant qu’expression
concrète du sujet, témoigne simultanément, sur cet axe, de ses autres natures : sociale et
spatiale. La projection similaire du « social » (appartenance sociale à des groupes) sur le côté
sujet/espace du triangle, engendre une nouvelle manifestation du corps (C2) ; ce dernier
apportant la consistance sociale du sujet spatialisé ou se spatialisant. Enfin, dernier effet de
projection, celle du sommet « espace » sur le continuum (base du triangle) sujet/social (C3).
Dans ce cas, l’irruption de la matérialité du corps confère une forme spatiale aux figures
abstraites, mais de plus en plus sociales de l’individu, de la personne, de l’acteur… Pour se
résumer, si l’on projette, comme je viens de le faire, chaque sommet du triangle équilatéral
sur son côté opposé, le point de concours des hauteurs/bissectrices ainsi tracées (orthocentre)
est occupé par le corps (C). Ses trois formes (espèces) -subjective (C1), sociale (C2) et spatiale
(C3)- se déclinent alors par sa projection sur chacun des trois côtés du triangle. Ceux,
respectivement, des rencontres du social et du spatial (C1), du sujet (subjectif) et du spatial
(C2), du sujet et du social (C3).
Compris de la sorte comme une articulation subjectivée et substantielle du social et du
spatial (ou si l’on veut, en se plaçant à un niveau plus abstrait, de l’idéel et du matériel), le
corps (C) affiche des postures, des comportements, des pratiques, des consommations, des
habillages et des ornementations. Il se déplace selon des parcours et des cheminements. Tous
ces éléments contribuent à la production permanente et normative (co-construction
consubstantielle en fait) de l’espace géographique, de ses lieux et de ses territoires. Le corps
devient dès lors le point focal d’une rencontre inéluctable, permanente, entre une conscience
(sujet) qu’il inclut et qui l’inclut, des normes sociales que véhiculent les habitus au travers de
l’hexis corporelle, l’espace enfin qui forme, au même titre que la pensée, sa substance.
1
Réalité finalement beaucoup plus fluide qu’objet matériel aux limites indiscutables, le corps ne se définit
pas aisément. La manière dont le cerne E. Grosz (1992) est, sans doute, parce que large et globale, l’une
des plus satisfaisantes. Pour E. Grosz: “human body coincides with the shape and space of a psyche, a body
whose epidermic surface bounds a psychical unity, a body which thereby defines the limits of experience and
subjectivity”.
La question des appartenances de sexe et de genre souligne combien les frontières et les fonctions
symboliques identitaires du corps humain sont plus indécises et complexes qu’il n’y paraît a priori.
L’expérience des bisexuels, transsexuels et autres transgenres montre, d’une part, que le sexe (ou plutôt
les préférences sexuelles et choix de sexualité) n’est (ne sont) pas uniquement une donnée biologique
absolue, et, d’autre part, que le lien univoque entre sexe (soi-disant biologique) et genre (socio-culturel) ne
revêt aucun caractère automatique. Ainsi, l’athlète sud-africaine, championne du monde du 800 mètres en
2009 à Berlin, Caster Semenya, se considère sincèrement comme une femme, depuis sa naissance (genre),
dans un corps sexuellement imprécis et indécis : femelle, mâle, hermaphrodite ? Son cas et bien d’autres
remettent en question nombre de dualismes classiques, conférant, au sein de leur combinaison binaire, un
effet déterminant du premier terme sur le second : du sexe sur le genre, de l’esprit sur le corps, de la
nature sur la culture, de l’essentialisme sur le constructivisme, etc. (cf. J. Halberstram, 2005 ; J. D. Hester,
2004 ; C. Shilling, 1993 ; V. Kirby, 1992 ; M. Gatens, 1991 ; J. Butler, 1990…). Parmi ces auteurs, Chris
Shilling adopte un point de vue dialectique tout à fait convaincant. Elle argue que le corps ne peut se
réduire ni à une stricte réalité biologique, ni à une construction sociale indépendante de la nature, mais
correspond à une interaction dynamique constante de ces deux ordres du réel. Un rapport dialectique
similaire pourrait expliquer les relations sexe/genre, tous deux incorporés (embodiment) par les individus.

4
Dès lors, c’est par la médiation de ce corps conscientisé, socialisé (la sexuation et le
genre participant de ces composantes) et spatialisé, dans le mouvement de son vécu, que des
mots (géographiques) comme environnement, nature, paysage, lieu et territoire (et bien
d’autres : vivre ensemble, qualité de vie et bien-être, etc.) prennent sens.
Dans ces pages, je mettrai l’accent sur ces spatialités du corps. C’est alors qu’une
question devient obsédante : comment expliquer cette absence ou, pour le moins, cette
discrétion du corps, en France, dans le propos géographique savant ? L’idée d’un impensé de
la réflexion géographique, au sens d’une réalité omniprésente et néanmoins négligée -pour des
raisons idéologiques ? Pour des causes de partage disciplinaire ?- par la recherche et ses
modèles théoriques (affirmation que je serai amené à nuancer quelque peu), vient alors à
l’esprit.
Cet effacement du corps de l’univers conceptuel de la géographie, n’est-ce pas,
finalement, la rançon de ce qu’elle doit, en tant que discipline scientifique construite, à la
modernité du XIXe et du premier XXe siècle ? Comme l’explique David Le Breton (1990) :
« La définition moderne du corps implique que l’homme soit coupé du cosmos, coupé des
autres, coupé de lui-même (en tant que conscience). Le corps est le résidu de ces trois
retraits ». Ainsi (dé)spatialisé, (dé)socialisé, (dé)subjectivisé par la modernité (j’y reviendrai),
rejeté dans l’ordre du biologique, le corps pouvait-il émerger en géographie, dans la tradition
pesante du positivisme qui fonda les sciences modernes et leurs spécificités, leurs partages
disciplinaires ? (cf. Figure 3).
Notons par ailleurs que l’une des conséquences de cette réduction biologique du
corps fut sa séparation radicale de l’esprit (L. Johnson, 1989). Comme l’ont bien montré
les géographes féministes anglophones, cette division fut exploitée par l’idéologie
patriarcale, hégémonique en Occident, afin de masculiniser à outrance l’esprit, la
pensée, la raison et leur potentiel (philosophiquement élaboré en valeur universelle)
d’autonomie humaine, de transcendance, d’objectivité (Gatens, 1988). Le corps, frappé
du sceau de la féminité, fut affligé pour sa part de tous les stigmates de l’impureté, mais
aussi de cette capacité émotive, passionnelle (jusqu’à l’hystérie) et néanmoins passive
dont on affuble couramment et négativement le genre féminin (Grosz, 1989 ; Kirby,
1992 ; Rose, 1993). Autoproclamé rationnel et universel, esprit dégagé des entraves du
corps, le genre masculin incorporait alors son exclusive compétence à produire les
savoirs savants (Le Doeuff, 1987) et, concomitamment, à exercer un pouvoir sans
partage sur la société. Baignés et nourris de ces pseudos évidences, les habitus féminins
ont fini par en partager l’illusion.
Quant aux géographes du XIXe et du XXe siècle, ne devaient-ils pas répondre à
d’autres urgences, bien plus criantes que celle du corps, dans leur effort de fondation
disciplinaire ? Sur le plan scientifique, le corps n’avait-il pas été abandonné à la biologie
et à la médecine, voire à l’anthropologie, d’abord morphologique, puis sociale et
culturelle ? Sans accuser les anciens, cet article s’efforce simplement de mettre l’accent
sur la richesse d’un recours au corps pour qui veut promouvoir une géographie sociale
et culturelle holiste, globale, intégrant la structuration du monde et l’expérience vécue,
forcément corporelle, des humains. La géographie n’est certes pas mieux armée ou plus
légitime que l’anthropologie pour traiter du corps. Parce que l’anthropologie jouit d’une
longue et féconde expérience en la matière, le géographe a besoin de s’inspirer de ses
méthodes pour forger les modalités de sa propre approche scientifique du corps. Mais il
ne saurait faire l’économie de celle-ci s’il souhaite proposer une science vivante et
compréhensive des rapports humains et sociaux à l’espace géographique.
Une autre idée pourrait également expliquer ce silence du corps en géographie. C’est
que le corps forme le creuset des routines, des habitudes, de tous ces rituels apparemment
insignifiants du quotidien. Dans ces conditions, le corps ne figure-t-il pas une sorte

5
« d’évidence oubliée », une réalité naturelle/naturalisée, allant de soi, ne méritant guère
d’attention particulière de la part des géographes ? Comme l’écrit David Le Breton (1990) :
« Le corps est le présent – absent, à la fois pivot de l’insertion de l’homme dans le tissu du
monde et support sine qua non de toutes les pratiques sociales. Il n’existe à la conscience du
sujet que dans les seuls moments où il cesse de remplir ses fonctions habituelles, lorsque la
routine de la vie quotidienne disparaît ou lorsque se rompt le silence des organes ».
Pour être juste, il convient toutefois de signaler que si le poids de la routine, du banal,
du quotidien qui l’accable, discrédite la scientificité du corps, d’autres facteurs jouent en sens
contraire. C’est en particulier le cas du retour en force de l’individu sous toutes ses facettes
(homme, femme, enfant, gay, lesbienne, queer, transgenre et transsexuel, handicapé,
membre d’une minorité ethnique ou religieuse, avec telle ou telle couleur de la peau,
etc.), du sujet, de l’acteur et de l’intime (Sennett, 1979), dans la vie sociale comme dans les
sciences qui l’étudient. Ces réalités et ces aspirations ne militent-elles pas, de nos jours, en
faveur de l’introduction des corps différenciés dans le propos comme dans les méthodes de la
géographie sociale et humaniste ?
Dans ce texte, je partirai du principe selon lequel le corps intervient au moins à quatre
niveaux dans la production sociale des espaces géographiques. Primo (1), en tant qu’élément
constitutif à part entière de tels espaces, mais aussi en tant que force génératrice de leur
production et de leurs dynamiques. Secundo (2), en tant qu’organisme vivant parmi tant
d’autres, peuplant la terre et constituant avec elle un système d’échanges (écosystème). Tertio
(3), en tant que source et médium de connaissance (sensible et intellectuelle), de perception et
de représentation, de communication et d’interaction sociale, de savoir. Ce dernier registre
annonce et prépare, quarto, la fonction identitaire du corps humain. Je l’examinerai ici sous
deux angles. D’abord (4), en tant que productrice d’image de soi et de distinction sociale,
ensuite (5) dans ses extensions spatiales.
1- Le corps : un espace générateur d’espaces
Le corps est un élément constitutif à part entière de l’espace physique, de même que celui-ci
le constitue. Le corps est également un générateur de l’espace social : que serait une
description et, a fortiori, une analyse/explication de l’espace géographique qui négligerait les
corps qui l’occupent, le (re)produisent et en dessinent les principales dynamiques ?
1.1- La réalité spatiale et paysagère des corps
Des géographes comme Jean Brunhes l’avaient bien compris (édition 1934) : « Ici et là, par-
dessus tout, ce sont des masses ou des groupes plus ou moins denses d’êtres humains. Ces
êtres humains, en eux-mêmes et par eux-mêmes, sont des faits de surface et partant des faits
géographiques. Ils vivent sur la terre. Ils sont soumis aux conditions atmosphériques et
terrestres. Ils appartiennent à certains climats, à certaines altitudes, à certaines zones. En
outre, ils vivent sur la terre : c’est en se subordonnant eux-mêmes aux faits naturels qu’ils
assurent à leur corps l’entretien indispensable et à leurs facultés le développement et
l’épanouissement. Dans la géographie biologique, les êtres humains occupent une place
incomparable, une place unique. Ils méritent de la part des géographes une attention singulière
et exceptionnelle (…) par la réalité du revêtement que leurs corps vivants forment en tels ou
tels points de l’écorce terrestre ».
L’être humain, s’avère donc un « fait de surface » (dimension horizontale, celle du
plan ou de la carte), un « revêtement (…) de l’écorce terrestre » par son corps. Plus encore,
peut-être, le corps est une composante paysagère (verticale) active de l’espace géographique.
En témoignent éloquemment deux choses. D’abord notre expérience quotidienne, celle des
parcours que nous effectuons dans les rues, celle de notre fréquentation des plages, des
sentiers de montagne ou de la forêt. Le partage des lieux de travail, du logement, de la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%