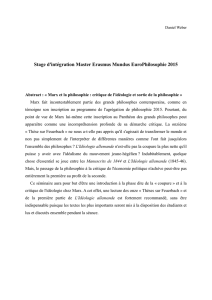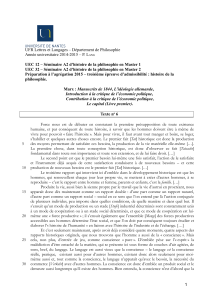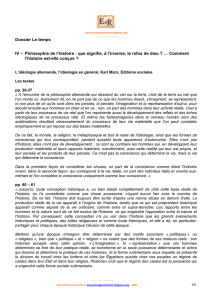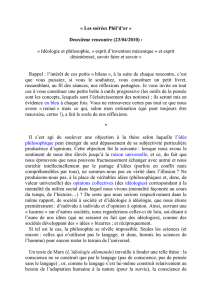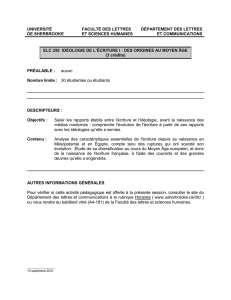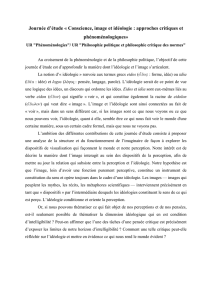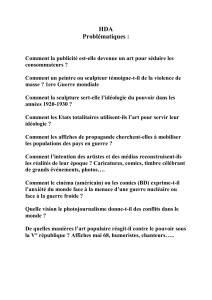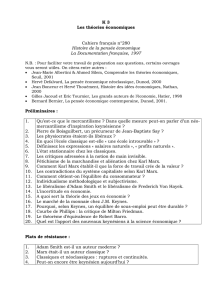La fin du travail et la mondialisation

La fin du travail
et la
mondialisation
Idéologie et réalité sociale

Collection L'Ouverture Philosophique
dirigée par Bruno Péquignot
Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux origi-
naux sans exclusive d'écoles ou de thématiques.
Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions qu'el-
les soient le fait de philosophes "professionnels" ou non. On n'y confon-
.dra donc pas la philosophie avec une discipline académique; elle est
réputée être le fait dé tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils
soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines,
sociales ou naturelles, ou ... polisseurs de verres de lunettes astronomi-
ques.< Dernières parutions
François NOUDELMANN, Sartre: l'incarnation imaginaire, 1996.
Jacques SCHLANGER, Un art, des idées, 1996.
Ami BOUGANIM, La rime et le rite. Essai sur le prêche philosophi-
que, 1996.
Denis COLLIN, La théorie de la connaissance chez Marx, 1996.
Frédéric GUERRIN, Pierre MONTEBELLO, L'art, une théologie mo-
derne, 1997.
Régine PIETRA, Lesfemmes philosophes de l'Antiquité gréco-romaine,
1997.
Françoise D'EAUBONNE, Féminin et philosophie (une allergie histo-
rique), 1997.
Michel LEFEUVRE, Les échelons de l'être. De la molécule à l'esprit,
1997.
Muhammad GHAZZÂLI, De la perfection. 1997.
Francis IMBERT, Contradiction et altération chez J.-J. Rousseau, 1997.
Jacques GLEYSE, L'instrumentalisation du corps. Une archéologie de
la rationalisation instrumentale du corps, de l'Âge classique à l'époque
hypermoderne, 1997.
Ephrem-Isa YOUSIF, Les philosophes et traducteurs syriaques, 1997.
Collectif, publié avec le concour de l'Université de Paris X, Objet des
sciences sociales et normes de scientificité, 1997.
Véronique FABBRI et Jean-Louis VIEILLARD-BARON (sous la di-
rection de), L'Esthétique de Hegel, 1997.
Eftichios BITSAKlS, Le nouveau réalisme scientifique. Recherche Phi-
losophiques en Microphysique, 1997.
Vincent TEIXEIRA, Georges Bataille, la part de l'art. La peinture du
non-savoir, 1997.
Tony ANDRÉANI, Menahem ROSEN (sous la direction de), Structure,
système, champ et théories du sujet, 1997.
@L'Harmattan, 1997
ISBN:
2-7384-5912-9

Denis COLLIN
La fin du travail
et la
mondialisation
Idéologie et réalité sociale
Éditions L'Harmattan
5-7, rue de l'École-Polytechnique
75005 Paris
L'Harmattan Inc.
55. rue Saint-Jacques
Montréal (Qc) - CANADA H2Y IK9


Introduction
Ni rire, ni pleurer, comprendre.
(Spinoza)
État d'urgence
Le succès de L 'horreur économique de Viviane Forrester, publié en
1996, et vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, est un
signe révélateur de notre situation intellectuelle et politique. Révélateur
des sentiments réels d'une large ftaction de la population qui, depuis
longtemps, ne trouve plus aucune expression dans les grands moyens
d'infonnation, ni dans la plupart des organisations sociales ou politi-
ques traditionnelles, ni même, si j'excepte un certain cinéma
britannique et quelques autres rares manifestations, dans les œuvres
artistiques. Mais aussi révélateur, en creux, de l'indigence et de la
futilité spirituelle de ces cohortes de spécialistes des sciences humai-
nes, philosophes, essayistes, experts, analystes, dirigeants politiques
qui renoncent à toute fonction critique pour se complaire le plus sou-
vent dans ce rôle que Nizan définit d'une fonnule lapidaire, « les
chiens de garde ».
Viviane Forrester a eu le mérite de dire au plus grand nombre ce
qu'on ne lisait plus que dans quelques revues confidentielles ou dans le
Monde Diplomatique. Elle a dénoncé avec talent la « novlangue» de
l'idéologie contemporaine, celle qui, comme dans le 1984 de Georges
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%