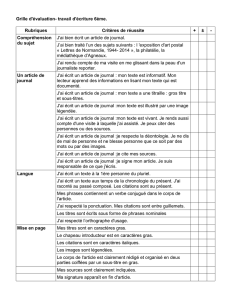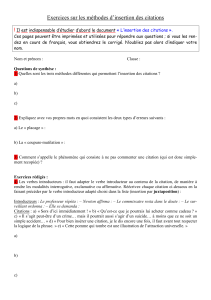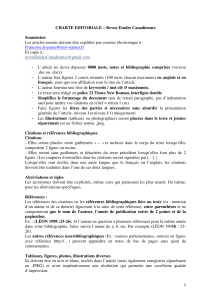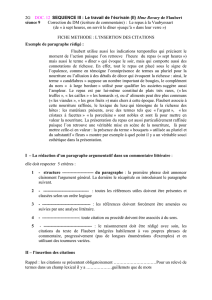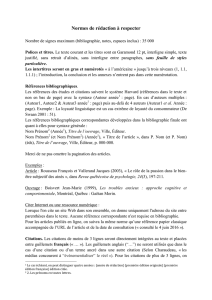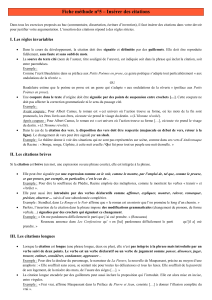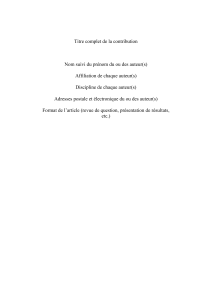Référence, déférence Une sociologie de la citation

Référence, déférence
Une sociologie de la citation

@L'Harmattan, 2007
5-7, rue de l'Ecole polytechnique; 75005 Paris
http://www.1ibrairieharmattan.com
diffusion.harmattan @wanadoo.fr
harmattan 1@wanadoo.fr
ISBN: 978-2-296-03996-4
EAN : 9782296039964

Stéphane OLIVESI
Référence, déférence
Une sociologie de la citation
L'HARMATTAN

Du même auteur aux éditions L'Harmattan:
Histoire politique de la télévision, 1998 (avec une préface d'Erik
Neveu).
Questions de méthode. Une critique de connaissance pour les sciences
de la communication, 2004.
La communication selon Bourdieu. Jeu social et enjeu de société,
2005.
Chez d'autres éditeurs:
La communication au travail. Une critique des nouvelles formes de
pouvoir dans les entreprises, PUG, 2006 (Nouvelle édition mise àjour
et augmentée -ouvrage traduit en roumain).
Sciences de l'information et de la communication. Objets, savoirs,
discipline, PUG, 2006 (ouvrage collectif).
Introduction à la recherche en SIC, PUG, 2007 (ouvrage collectif).

Le présent ouvrage a bénéficié des apports (critiques, suggestions,
remarques ...) de plusieurs lecteurs que l'auteur tient à remercier. Ils
trouveront au fil d'une relecture, ici ou là, des réponses directes ou
indirectes à leurs interpellations initiales. Ce dernier tient également à
remercier les collègues anonymes qui lui ont consacré un peu de leur
temps pour répondre à ses questions perfides et l'éclairer sur leurs
propres pratiques citationnelles.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%