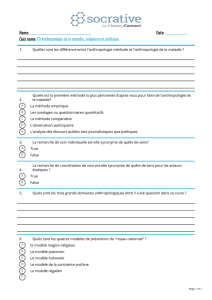Anthropologie et Sociétés, vol. 29, no 1, 2005 : xx

Anthropologie et Sociétés, vol. 29, no 1, 2005 : xx - xx
(MPCBMJTBUJPOEFTDVMUVSFT
2008
32 HS
Traces, traverses et voix de
jeunes anthropologues

ANTHROPOLOGIE ET SOCIÉTÉS est éditée par le Département d’anthropologie de l’Université
Laval. Elle vise à diffuser la recherche anthropologique effectuée par les chercheurs du Québec et d’ailleurs, dans
tous les champs de la discipline et dans tous les courants. Cela représente trois numéros thématiques par année,
qui incluent surtout des articles, mais aussi des notes de recherche, divers textes spécialisés (débats, essais,
actualités) et des articles hors thème.
RÉDACTRICE
Francine Saillant, Université Laval
COMITÉ DE RÉDACTION
Manon Boulianne, Université Laval
Michelle Daveluy, Université d’Alberta
Jean-Guy Goulet, Université Saint-Paul
Martin Hébert, Université Laval
Christine Jourdan, Université Concordia
Frédéric Laugrand, Université Laval
Joseph-Josy Lévy,Université du Québec à Montréal
Deirdre Meintel, Université de Montréal
Jean-Claude Muller, Université de Montréal
Sylvie Poirier, Université Laval
Bob White, Université de Montréal
ADJOINTE À LA RÉDACTION
Sonia Engberts ([email protected])
SECRÉTAIRE Vente et abonnements
Caroline Demers ([email protected])
TRADUCTION
Trucs en plume enr.
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
Anthropologie et Sociétés
Département d’anthropologie
Faculté des sciences sociales
1030, av. des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Canada
Téléphone : 418 656-3027 ou 3700
Télécopieur : 418 656-2831
www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/index.html
COMITÉ CONSEIL INTERNATIONAL
Jean Copans, Faculté de sciences humaines et
sociales, Université René Descartes, Paris
Roberto DaMatta, Museu Nacional, Rio de Janeiro
Philippe Descola, Collège de France, Paris
Françoise Héritier, Collège de France, Paris
Ellen R. Judd, Anthropology, University of Manitoba,
Winnipeg
Mondher Kilani, Institut d’anthropologie et de sociologie,
Université de Lausanne
François Laplantine, Centre de recherches et d’études
en anthropologie, Université Lumière-Lyon 2
David Le Breton, Faculté des sciences sociales,
Université Marc Bloch-Strasbourg 2
Luisa Paré, Universidad Nacional Autonoma de
México, México
Eric Schwimmer, Département d’anthropologie,
Université Laval, Québec
Philip Smith, Département d’anthropologie, Université
de Montréal, Montréal
Marilyn Strathern, Anthropology, Cambridge University
Marc-Adélard Tremblay, Département d’anthropologie,
Université Laval, Québec
ANTHROPOLOGIE ET SOCIÉTÉS est
publiée grâce à des subventions du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada (CRSHC)
et du ministère de l’Éducation du Québec provenant
du Fonds de recherche sur la société et la culture
(FQRSC). Nous reconnaissons l’aide financière
du gouvernement du Canada par l’entremise du
programme d’Aide aux publications (PAP) pour nos
dépenses d’envoi postal.
La revue est indexée dans Abstracts in Anthropology
(New York), Anthropological Index (Londres),
Anthropological Literature (Cambridge, États-Unis),
Canadian Periodical Index (Ontario), Francis (Paris),
IBR Zeller Verlag (Osnabrük, Allemagne), IBZ (Osna-
brück, Allemagne), Linguistics and Language Behaviour
Abstracts (Californie), Pais Foreign Language Index
(New York), Repère (Québec), Science Culture (Paris),
Sociological Abstracts (Californie), Ulrich’s International
Periodical Directory (New Jersey).
ISSN 1703-7921 (en ligne) ; ISSN 0702-8997 (imprimé)
Dépôt légal : 4e trimestre 2008
© Anthropologie et Sociétés, Université Laval — Tous droits de reproduction et de traduction réservés
Envoi de Poste-publications enr. no 1432605 / Port retour garanti — Anthropologie et Sociétés, 2008, décembre
Couverture 1 : Caroline Demers
Photographie : Fabien Pernet
Composition : Caroline Demers
RÉDACTEURS
Yvan Simonis, fondateur, 1977-1987
Mikhaël Elbaz, 1987-1995
Marie-Andrée Couillard, 1996-1998
Mikhaël Elbaz, 1998
Serge Genest, 1999

ANTHROPOLOGIE ET SOCIÉTÉS
2008 Volume 32 numéro hors série
GLOBALISATION DES CULTURES
Traces, traverses et voix de jeunes anthropologues
Sous la direction de Fabien Pernet et Karoline Truchon
Francine Saillant
Mot de la rédactrice ........................................................................................................ 3
Fabien Pernet
Présentation : « Il faut étudier l’homme sur son terrain si on ne veut pas avoir
à le penser comme un chaos » ....................................................................................................4
Plasticité e t a c t u a l i t é d e l’e x P é r i e n c e e t h n o g r a P h i q u e
Dorothée Guillem
Le charme féminin chez les Peuls Djeneri du Mali
Un « objet » de la nature ou de la culture? ..............................................................................11
Mathieu Bujold
Pluralisme médical polarisé
La représentation de la maladie du patient comme canal de communication
interdisciplinaire ........................................................................................................................18
Lindsay Bell
Posséder le dena’ina
Luttes autour de l’appropriation d’une langue autochtone en Alaska ......................................26
Catherine Therrien
Frontières du « proche » et du « lointain »
Pour une anthropologie de l’expérience partagée et du mouvement .......................................35
Vincent Mirza
Les furita et la définition du travail temporaire au Japon ........................................................42
Nadia Giguère
De l’appropriation anthropologique de l’interculturalité
La théorie des mythes modèles appliquée aux cas des expatriés occidentaux en inde ...........48
au P l u s P r è s . si l e n c e s , f r a c t u r e s , l i e n s
Annie Laliberté
Le silence du figurant de sa propre histoire
Autour du tournage du film français « Opération turquoise » au Rwanda ..............................55
Karine Vanthuyne
Ethnographier les silences de la violence .................................................................................64
Alice Verstaeten
Esquisse d’une anthropologie impliquée auprès des victimes de la « disparition forcée » ....72
anthroPologies i n d i g è n e s
Eduardo González Castillo
Action politique zapatiste et contexte régional. Le cas de Puebla, Mexique ..........................79
Charles Gueboguo
Mobilisations transnationales des communautés homosexuelles en Afrique. Une affaire à
suivre ..........................................................................................................................................85

Livia Vitenti
Le pouvoir tutélaire et la lutte pour la souveraineté chez les peuples
autochtones du Brésil ................................................................................................................94
co n c e v o i r l e s c o n t i n u i t é s
Khalid Mouna
Pour une autre démarche anthropologique. Étude de cas du Rif du Maroc ..........................101
Laurent Legrain
L’inaltérable mémoire des exemples. À propos de la confiance sociale en
régime de transition .................................................................................................................107
qu a t r e v o i x P o u r u n e a n t h r o P o l o g i e
Eduardo González Castillo, Anne Lavanchy, Zakaria Rhani
et Karoline Truchon
L’anthropologie et ses lieux. Altérité, genre, relativisme culturel et décolonisation .............117

MOT DE LA RÉDACTRICE
Francine Saillant
Cette édition hors série de la revue Anthropologie et Sociétés est issue d’un
certain nombre de contributions étudiantes présentées lors du colloque que nous
avions organisé à l’occasion de son trentième anniversaire, et intitulé Anthropologie
des cultures globalisées. Terrains complexes et enjeux disciplinaires, lequel s’est
tenu à Québec en novembre 2007. Devant l’ampleur de la participation étudiante,
l’idée de cette édition spéciale fut lancée. Dans les mois qui ont suivi le colloque,
un appel fut lancé à tous les participants étudiants, afin de leur proposer de présenter
un court article issu de leurs communications. Les responsables de cette publication,
Fabien Pernet et Karoline Truchon, tous deux membres du comité étudiant du
colloque, ont agi à titre de rédacteurs invités. Cette publication concrétise donc ce
projet collectif né de l’intérêt des divers comités du colloque et de la rédaction de
la revue de proposer, exceptionnellement, un numéro en ligne selon le modèle des
actes de colloque et qui serait réalisé entièrement par des étudiants. Le numéro
rassemble donc, outre son introduction, les diverses propositions des auteurs qui
ont bien voulu répondre à notre appel ainsi qu’un article spécial, « Quatre voix
pour une anthropologie », co-rédigé par quatre auteurs à la suite des discussions
et des échanges de ces derniers sur les lieux même du colloque et par la suite.
Cette parution n’est pas la seule à faire place aux étudiants puisque le colloque a
donné lieu à de nombreuses autres publications à partir de ses sessions spéciales,
certaines parues et d’autres à paraître, y compris bien sûr dans divers numéros de
la revue. Il me fait donc plaisir, à titre de rédactrice, d’accueillir en nos pages ce
numéro hors série et d’ainsi honorer la très importante contribution des étudiants
lors de cet événement marquant au sein de notre discipline. Je remercie également
les rédacteurs invités pour leur professionnalisme, leur disponibilité, de même que
pour leur engagement indéfectible.
Francine Saillant
Rédactrice
Anthropologie et Sociétés, vol. 32, no hors série, 2008 : 3 - 3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
1
/
128
100%