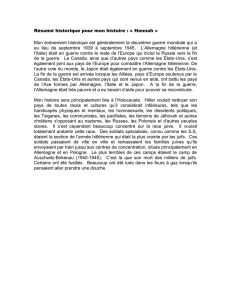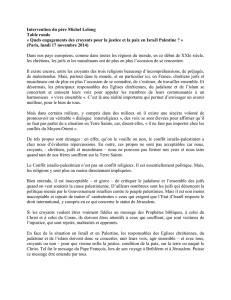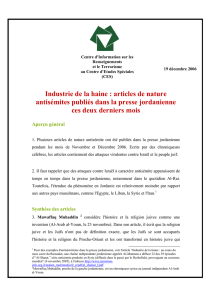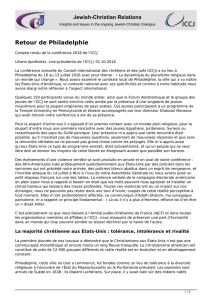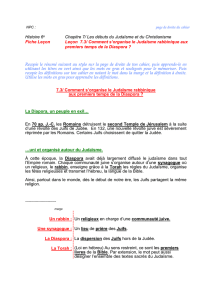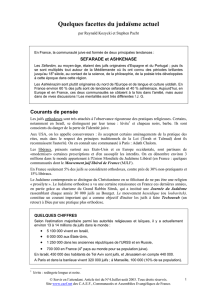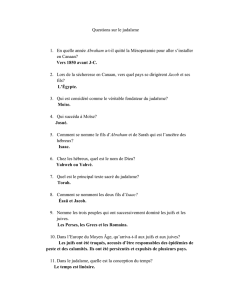Impérialisme américain

« Impérialisme américain »
et « guerre au terrorisme »,
Tony Judt, Philippe Moreau Defarges, Laurent Murawiec
Claire Demesmay, Eddy Fougier : L’adhésion de la Turquie en débat
Jeanne Favret-Saada : Mel Gibson en croisade
Théo Klein : Pour un renouveau du judaïsme
George Steiner : Erich Auerbach ou la puissance du verbe
numéro 133 janvier- février 2005
La démocratie peut-elle faire face
à une catastrophe climatique ?
Claude Allègre, André Lebeau, Jean-Christophe Rufin,
Jean-Jacques Salomon, Peter Schwartz et Doug Randall, Hubert Védrine
Les États-Unis de Bush II
Godfrey Hodgson, Jacques Julliard, Anatol Lieven, Vincent Michelot
Extrait de la publication

janvier-février 2005 numéro 133
Directeur: Pierre Nora
Théo Klein : Pour un renouveau du judaïsme. Entretien.
LES ÉTATS-UNIS DE BUSH II
Godfrey Hodgson : La nouvelle Amérique conservatrice. Entretien.
Jacques Julliard : Journal des États-Unis. Septembre-octobre 2004.
Anatol Lieven : Les composantes du nationalisme américain.
Vincent Michelot : Élections 2004 : un plébiscite en trompe l’œil ?
Jeanne Favret-Saada : Mel Gibson en croisade. Comment fabriquer de l’œcumé-
nisme avec une Passion intégriste.
«
IMPÉRIALISME AMÉRICAIN » ET « GUERRE AU TERRORISME » : DE
L’USA
GE
DES MOTS
Tony Judt : Rêves d’empire.
Laurent Murawiec : Empire ? Quel Empire ?
Philippe Moreau Defarges : Terreur, terrorisme, guerre.
Claire Demesmay, Eddy Fougier : La France qui fronde : l’adhésion de la Turquie
en débat.
LA DÉMOCRATIE PEUT-ELLE FAIRE FACE À UNE CATASTROPHE
CLIMATIQUE ?
Peter Schwartz, Doug Randall : Imaginer l’inimaginable. Le scénario d’un brusque
changement climatique et ses implications pour la sécurité nationale des États-Unis.
Claude Allègre : Penser l’avenir.
André Lebeau : Clear and present danger.
Jean-Christophe Rufin : La construction de la peur.
Jean-Jacques Salomon : Allocution du président de la République française
en date du 23 avril 2061.
Hubert Védrine : Surmonter l’insurmontable.
LA TRADITION CRITIQUE (SUITE)
George Steiner : Erich Auerbach ou la puissance du verbe.
LE DÉBAT DU DÉBAT
René Crozet, Nathalie Heinich.

Pour un renouveau du judaïsme
Entretien avec Théo Klein
Le Débat. – Partons du présent. La multipli-
cation d’agressions antisémites depuis quatre
ans inquiète et désoriente. Le phénomène est à
l’évidence surdéterminé par le conflit israélo-
palestinien, par la cristallisation d’un islamo-
progressisme dans une fraction de l’opinion, mais
il traduit aussi une évolution plus large de la
sensibilité démocratique, dont le victimisme
compassionnel est perméable à un nouvel « anti-
sémitisme au nom de l’autre ». Faut-il, selon
vous, s’alarmer, et de quoi au juste ?
Théo Klein. – On ne peut pas parler inconsi-
dérément d’antisémitisme après la Shoah compte
tenu de son poids historique. Il vaut mieux
réserver l’emploi du mot à la volonté d’éliminer
les Juifs, volonté pouvant aller jusqu’à l’exter-
mination, mais qui passe aussi par l’exclusion de
certaines professions, l’interdiction d’acquérir
certains biens, la soumission à un statut parti-
culier. C’est bien cette volonté d’éliminer, de
mettre à part, qui caractérise l’antisémitisme et
lui donne son caractère politique puisqu’il tend
à porter atteinte au statut civique de l’individu
juif. D’autre part, l’antisémitisme implique une
organisation, le cas échéant politique et, ultime-
ment, gouvernementale, comme ce fut le cas
avec le gouvernement de Vichy et le nazisme.
Lorsque ces deux traits ne sont pas réunis, on
devrait éviter de parler d’antisémitisme. Il faut
analyser le phénomène des violences contre les
Juifs aujourd’hui en France sans y projeter un
passé qui n’a rien à voir avec ce qui se produit
aujourd’hui. Or, le mot « antisémitisme » fait
immédiatement revivre des événements passés.
Cette remémoration de la Shoah a conduit à mal
interpréter ces événements, à leur donner un sens
qu’ils n’ont pas. Le président du
CRIF
a commis
une faute politique quand il a interpellé Lionel
Jospin, alors chef du gouvernement, sans tenir
compte de la situation des quartiers à forte popu-
lation immigrée devenus, précédemment déjà,
des zones de non-droit, avec des violences
urbaines de toutes sortes. Il ne fallait pas évo-
quer les attaques contre les Juifs en ignorant ce
Théo Klein est avocat international. Le Débat a déjà publié:
«Une manière d’être juif» (n° 82, novembre-décembre 1994).
Extrait de la publication

4
contexte, en les détachant de cette violence éma-
nant des mêmes sources, comme si les Juifs
étaient en dehors de la communauté nationale.
Lorsqu’on insulte un rabbin dans la rue, qu’on
persécute un enfant juif à l’école, qu’on attaque
une synagogue, c’est l’ordre public qui est en
cause, au-delà de la communauté juive. Cette
façon de parler de l’antisémitisme et d’inter-
peller les pouvoirs publics a eu, en outre, des
effets calamiteux en Israël et aux États-Unis.
Quand on examine l’histoire de l’antisémi-
tisme, les circonstances et les formes dans les-
quelles il se manifeste, on voit bien que les Juifs
n’y jouent qu’un rôle passif. L’antisémitisme
s’explique par tels ou tels problèmes de la société
dans laquelle il se développe ; il traduit un malaise
social, ou économique, ou politique, plutôt que
l’action ou le caractère des Juifs. Les Juifs ne
sont coupables que de continuer à exister. Tout
l’antijudaïsme chrétien repose là-dessus : les
Juifs, par leur simple existence, rappellent que
Jésus était juif, un parmi d’autres dans le bouil-
lonnement des idées et des sectes de son temps ;
c’est un problème pour les chrétiens. De même,
l’intégration des Juifs dans la société française
au moment de la Révolution a été un mouve-
ment dans la logique de l’idée révolutionnaire
d’égalité et d’émancipation des individus par
rapport aux statuts particuliers traditionnels.
L’affaire Dreyfus a été vécue, à l’époque, comme
la dernière bataille de la République contre la
réaction : problème français encore, de même
que l’épisode de Vichy. Les Juifs ont-ils quelque
chose à dire et à faire face à l’antisémitisme ?
Certes, je peux faire connaître aux autres le
judaïsme et les Juifs, expliquer d’où vient cette
identité, mienne par la naissance et parce que je
me veux juif, les valeurs qui la constituent, mon-
trer que cette identité et ces valeurs ne sont en
rien contradictoires, culturellement et politique-
ment, avec mon appartenance à la nation fran-
çaise. Mais ce sont les antisémites qui ont un
problème avec moi et non l’inverse. Beaucoup
de Juifs sont réticents à rattacher l’antisémitisme
au racisme, au problème plus général du respect
de l’autre, de celui qui paraît différent, étrange ;
ils ont le sentiment que l’antisémitisme est d’une
essence distincte. C’est une réaction néfaste, bien
que compréhensible. N’oublions pas qu’à nos
yeux aussi le « goy » paraît parfois si étrange !
Moi, juif, je n’ai aucun besoin de l’antisé-
mite pour assumer dans la dignité mon identité
et ma culture ; l’antisémite, lui, ne peut se passer
de me soupçonner, me craindre ou me haïr, pour
vivre les siennes. Je ne suis alors que le symptôme
apparent d’un mal-être dont je ne suis pas la
cause ; je n’en suis que le témoin ou la victime.
Les violences dans les écoles ou les lycées, les
outrances verbales et la récupération des vieux
poncifs contre les Juifs ne sont-ils pas, avant tout,
les signes d’un malaise profond que traverse une
jeunesse mal intégrée ou une société arabe en
quête d’elle-même dans les bouleversements de
la globalisation et la liquidation lente d’un colo-
nialisme passé ? Nous ne pouvons répondre que
par la volonté incessante du dialogue et de la
reconnaissance de la dignité de chacun.
En dépit de l’émancipation, nous ne sommes
pas encore sortis du ghetto. Sortir du ghetto,
c’est accéder à la dimension politique de l’exis-
tence humaine. Concrètement, c’est entrer dans
la vie politique du pays où l’on réside, pas seu-
lement en termes d’adhésion à des idéaux, mais
aussi de participation aux compromis, à la
balance du désirable et du possible qui sont le
propre de la politique. Là est notre difficulté,
nous avons du mal à considérer l’autre dans une
relation politique, parce que, à cause de l’antisé-
mitisme, nous avons désappris à le considérer
autrement que comme une menace, réelle ou
Théo Klein
Pour un renouveau
du judaïsme

5
potentielle ; pendant trop de siècles, nous n’étions
pas admis à la dignité de partenaires, mais enfer-
més dans un état d’exception : tant qu’on est
dans le ghetto, on ne peut avoir une relation nor-
malisée avec l’autorité politique légitime qui
gère la ville ou le pays où le ghetto n’est, généra-
lement, que toléré. Il y avait autrefois dans
les ghettos ce qu’on appelait les « stadtlanim » :
c’étaient ceux qui avaient par leur métier des
relations avec l’extérieur – commerçants, méde-
cins – et qui étaient chargés de trouver des inter-
locuteurs influents dans la société non juive
pour
en faire des relais du ghetto auprès des auto
rités.
Nous ne sommes pas complètement sortis de
cette relation d’extériorité. Les Juifs doivent
assumer leur liberté politique, être des citoyens
comme les autres.
Le Débat. – Il y a aujourd’hui, après la Shoah
et Vichy, une tendance à réduire l’identité juive
et la vie juive elle-même à la relation avec l’an-
tisémitisme. C’est une amputation profonde dont
les Juifs sont finalement victimes. Ce problème
ne se pose pas que pour la Diaspora, mais aussi
pour Israël. L’idée d’une normalisation est-
elle pensable pour un pays qui se veut à la fois
l
’ultime rejeton du mouvement des nationalités
et l’accomplissement d’un destin religieux, avec
ce que cela suppose s’agissant du lien avec la
Diaspora et de la place de la religion dans la vie
publique, tous traits au demeurant très difficile-
ment compréhensibles pour le reste du monde ?
État juif, État des Juifs, la redéfinition de l’iden-
tité juive est aussi compliquée en Israël qu’en
Diaspora.
Th. K. – Israël est un État créé par des Juifs,
à un moment où l’idée nationale était florissante
et où de nombreuses communautés juives dans
le monde étaient en danger permanent. On
connaît la réaction de Herzl, témoin de l’affaire
Dreyfus : même dans le pays qui a émancipé les
Juifs et accepté de les traiter comme des citoyens
ordinaires… Mais n’oublions pas que ce ne fut
pas la réaction de la plupart des Juifs de France
à l’époque.
L’identité juive est aujourd’hui essentiel-
lement familiale et se trouve, pour le reste, à peu
près vide de contenu, hormis la mémoire de la
Shoah. Une mémoire douloureuse, imprescrip-
tible, dont nous sommes les porteurs ; mais une
mémoire qui interpelle aussi, et peut-être surtout,
le passé historique des pays où le crime a dévasté
les communautés juives ; sans doute, en grande
partie, à cause de la lâcheté des gouvernements
face à la montée du fascisme et de l’hitlérisme.
Cette mémoire historique et politique interroge
les peuples au-delà des communautés juives ;
cette mémoire, nous ne devons pas la voiler
de notre deuil. Là encore, nous n’avons fait
que souffrir d’un crime que nous n’avons pas
commis.
Mais notre identité est ailleurs. Nos ancêtres
portaient leur judaïsme en eux-mêmes, dans leur
manière de vivre. Ils étaient, bien sûr, préoc-
cupés de leur sécurité, ils savaient leur situation
précaire, mais ils ne se définissaient pas
par l’hostilité du monde à leur égard. Au travers
d’une solide tradition, l’existence juive était
dominée par l’étude ; elle était marquée par
l’interrogation, par un questionnement jamais
satisfait et apaisé, même si cette interrogation
tournait, parfois, autour d’elle-même, avec des
exceptions brillantes dont l’histoire de la judaïté
témoigne. Tout cela tend à s’effacer au profit
d’une identité qui ne se pose pas de vraies ques-
tions, reposant tout entière sur notre place de vic-
time
s dans l’Histoire. Avec la perte de l’étude et
son appauvrissement, nous avons laissé s’effacer
les exigences d’une permanente remise en cause
et nous nous sommes affaiblis dans le sentiment
d’être victimes de l’Histoire. C’est un terrible
Théo Klein
Pour un renouveau
du judaïsme
Extrait de la publication
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%