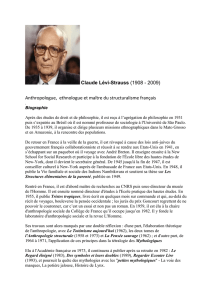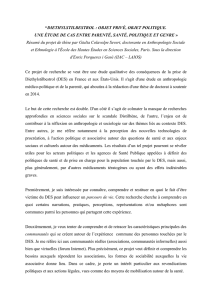USLB116801 - Université Saint

Anthropologie sociale et culturelle
Syllabus
(POLS1111)
J.-P. DELCHAMBRE
*USLB116801*
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES,
POLITIQUES ET DE LA COMMUNICATION
Edition 2016-2017

1
Université Saint-Louis - Bruxelles
1ère BAS POLS (+ options)
POLS 1111
ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE
Professeur : Jean-Pierre Delchambre
Syllabus
2016-17

3
Anthropologie sociale et culturelle
2016-17
Trois précisions importantes :
- Les notes de cours sont fournies sous deux types de supports : 1°) le Syllabus (Partie 1),
disponible dès le début du quadrimestre, à la fois au service reprographie et sur le serveur
eSaintLouis, le syllabus comprenant 4 des 6 chapitres qui seront abordés dans le cadre de ce
cours, et 2°) des documents supplémentaires, dont l'écriture est en cours d'actualisation, et qui
seront rendus disponibles uniquement sur le serveur eSaintLouis (tenir compte des indications
qui seront données au cours). Les notes écrites retravaillées pendant le quadrimestre sont qua-
lifiées réglementairement de «non obligatoire» au sens où elles ne sont pas rendues dispo-
nibles dès le début du quadrimestre (contrairement au Syllabus [Partie 1]), mais nous attirons
l'attention des étudiant.e.s sur le fait qu'elles ne sont pas moins importantes du point de vue de
l'étude de ce cours, et qu'il est donc important de s'y rapporter.
- Ce qui est considéré comme matière de référence, ou «matière d'examen», est non seulement
ce qui est présenté oralement par le professeur lors des cours magistraux, mais aussi les notes
écrites correspondantes qui figurent dans le syllabus et autres supports écrits. A noter toute-
fois que les supports écrits (ou parties de supports écrits) qui ne sont pas abordés oralement
par le professeur ne font pas partie de la «matière d'examen», SAUF EXCEPTION ! Et cette
année, il y aura des exceptions, en raison des leçons perdues pour cause de jours fériés (ou
autres raisons) et qui ne pourront pas être récupérées. Pour compenser les leçons perdues, il
sera demandé aux étudiant.e.s de lire et de s'approprier deux ou trois textes, ces lectures
donnant lieu à évaluation dans le cadre de l'examen.
- L'examen est oral, et la liste des questions d'examen est fournie à la fin du quadrimestre. Il
va de soi que l'étudiant ne doit pas attendre de disposer de cette liste pour se mettre à étudier
(cette liste est un outil ayant pour vocation d'aider l'étudiant à mieux calibrer et préciser son
étude en fin de parcours). Nous attirons l'attention sur le fait suivant : étudier uniquement sur
base de réponses types qui circulent s'avère souvent insuffisant ! Une bonne étude suppose
une appropriation approfondie et rigoureuse de la matière, sur base de notes prises au cours,
complétée par le syllabus et autres supports écrits. Pour se préparer à l'examen, il est impor-
tant de répondre par soi-même aux différentes questions de la liste fournie en fin de quadri-
mestre, à partir d'une étude préalable sur base de ses notes personnelles et des supports de
cours.
Plan du cours
Leçon introductive
Exercice interactif : Qu'est ce que l'anthropologie sociale et culturelle ? A quand remonte cette discipline ?
Dans quel contexte est-elle née ? Deux termes pour une même discipline : anthropologie sociale et culturelle
/ ethnologie (+ ethnographie). Quel est l'objet de cette discipline ? Qu'est-ce qu'elle étudie, selon quelles mé-
thodes (voir l'image de l'ethnologue s'immergeant dans un contexte particulier selon la méthode de l'observa-
tion participante et de la description ethnographique; importance de la relation d'enquête...). Quels rapports
avec d'autres disciplines (en particulier la sociologie) ? Quel rapport avec des débats du monde actuel ? Quel
est l'objet de l'anthropologie sociale et culturelle dans le monde contemporain ?

4
Modalités pratiques
PLAN
Première partie : Mise en perspective de la discipline
Chapitre 1 : Quelques clés pour comprendre la situation de l'anthropologie sociale et
culturelle
1. L'anthropologie sociale et culturelle aujourd'hui
2. Trois clés permettant de mieux cerner la spécificité de l'anthropologie sociale et culturelle.
- Contexte d'émergence.
- Transformation du contexte : le monde «postcolonial», le global et le local...
- Une ambition scientifique.
2.1. La naissance d'une discipline (clé n° 1)
- La différenciation entre l'anthropologie (sociale et culturelle) et la sociologie
- L'émancipation par rapport à l'héritage encombrant de l'anthropologie naturaliste
- Précisions terminologiques : anthropologie / ethnologie / ethnographie
2.2. Transformation du contexte : le monde «postcolonial» et l'incertitude concernant l'ob-
jet de l'anthropologie sociale et culturelle : la disparition des figures du «primitif» (clé n°
2)
2.3. Anthropologie et esprit scientifique (clé n° 3); les limites des approches objectivistes;
à la recherche d'autres critères de scientificité
Le terrain (fieldwork), la relation d'enquête directe (présence de l'observateur sur le terrain,
effets de perturbation...); la description ethnographique et l'observation participante (défa-
miliarisation / refamiliarisation, immersion durable...). Cf. F. Boas et B. Malinowski.
Approche du modèle de connaissance de l'anthropologie sociale et culturelle (et plus lar-
gement des sciences sociales) à partir de deux principes épistémologiques :
• La nature symbolique ou signifiante de l'objet.
• L'objet des sciences sociales et aussi un sujet ou un agent, (ré)actif et changeant
Stratégies méthodologiques : entre autres la stratégie de l'objectivation et la stratégie ré-
flexive...
Chapitre 2 : L'évolution des sociétés : problématiques initiales, remises en question de
l'évolutionnisme et bilan actuel
2.1. L'évolution des sociétés : premiers repères
- Le néolithique.
- Quelques exemples d'évolutions atypiques (non linéaires, non finalisées, complexes...) à
partir des Iroquois, des Indiens des Plaines et des Aborigènes australiens.

5
2.2. L'évolutionnisme dans son contexte (19ème siècle)
- L'évolutionnisme comme doxa (opinion, idéologie) et comme doctrine à prétention scien-
tifique (paradigme).
- D'où vient l'évolutionnisme ? Mise en perspective historique.
- Evolutionnisme et darwinisme : un double malentendu.
2.3. Caractérisation de l'évolutionnisme anthropologique comme doctrine à prétention
scientifique
- Deux présupposés et cinq caractéristiques.
- Précisions apportées par rapport à la distinction entre holisme et individualisme.
- Les critiques adressées à l'évolutionnisme.
2.4. Illustration de l'évolutionnisme à travers un débat d'époque : à la recherche de la reli-
gion des origines
- Le fétichisme
- L'animisme
- Le totémisme
- Le chamanisme
Développements à partir de l'animisme et du totémisme.
Sur base du totémisme : de la critique de l'évolutionnisme à un éclairage sur le structura-
lisme (Lévi-Strauss)
2.5. La pensée sauvage selon Lévi-Strauss
- Focus : quelques aspects du mythe
- Pensée sauvage vs. pensée scientifique
Chapitres 3 : Mises à l'épreuve de l'anthropologie classique et prise en compte d'enjeux
contemporains
3.1. Du culturalisme aux identités culturelles
3.1.1. Le culturalisme : présentation et critiques
Focus : Margaret Mead et la relativité des rôles sexués et de l'éducation des enfants
3.1.2. L'hypothèse Sapir-Whorf
[LES SECTIONS 3.2. et 3.3. DE CE CHAPITRE NE SERONT PAS ABORDEES CETTE
ANNEE]
3.4. Ethnocentrisme vs. relativisme : enjeux et débats
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
1
/
181
100%