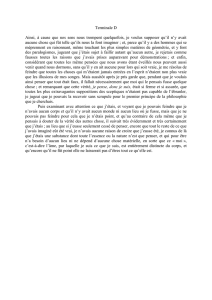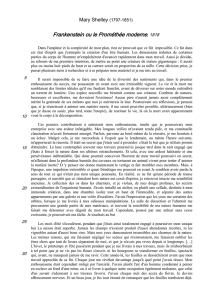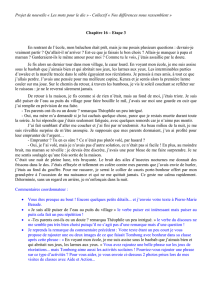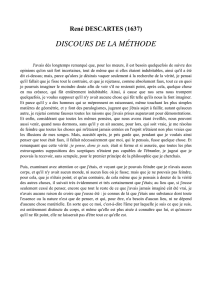1. Œuvre intégrale : L`Étranger d`Albert CAMUS, 1942

!
!
SEQUENCE!3!
!
LA!FIGURE!DE!L’ETRANGER!
!
Objet!d’étude!"!#$!%$&'())*+$!,$!&(-*).!/*!01$'23()!,$!#45(--$!,*)'!#4*&+1-$)2*23()!
Problématique!retenue!"!6(--$)2!#$!&(-*)!7*32!&87#8953&!:!#*!9(),323()!51-*3)$!
!
1. Œuvre!intégrale!:!L’Étranger!d’Albert!CAMUS,!1942!
!
;)!01(3!#*!7(&-$!)*&&*23<$!'3)+1#3=&$!,$!l’Étranger!7*32!,$!>$1&'*1#2!1)!%$&'())*+$!*1!,$'23)!
$?$-%#*3&$!@!
!
/$921&$'!*)*#A2301$'!"!
!
! L’incipit!"!,$!B!C1D(1&,4513!-*-*)!$'2!-(&2$.!E!:!B!F13G!-()'3$1&!#$!H3&$92$1&.!E!
!
! La!demande! en! mariage!"!,$!B!/$!'(3&G!>*&3$!$'2!<$)1$!-$!95$&95$&!E!:!B!/$'!+$)'!()2!#*!
%$*1!I#*)95$.!E!
!
! Le! meurtre!"! ,$! BJ(1&! -(3G! 9482*32! 1)$! 53'2(3&$! 73)3$!E! :! B!;2! 9482*32! 9(--$! 01*2&$! 9(1%'!
I&$7'!01$!D$!7&*%%*3'!'1&!#*!%(&2$!,1!-*#5$1&.!E!
!
! Le! procès!"! ,$! B!/4*%&='K-3,3G! #$'! +&*),'! <$)23#*2$1&'! I&*''*3$)2! 2(1D(1&'! #4*3&! 8%*3'! ,$! #*!
'*##$!E! :! B!L4*3! *9013$'98G! -*3'! -()! 9(-%#3-$)2! )482*32! %*'! '3)9=&$G! %*&9$! 01$! D482*3'! 2&(%!
7*23+18!E!
!
M21,$'!,4$)'$-I#$!"!
>$1&'*1#2G!1)!82&*)+$&!(1!1)!5(--$!9(--$!#$'!*12&$'!@!
6*-1'!$2!#4*I'1&,$!!
6(-%*&*3'()!3)93%32N$?93%32!
!
O$?2$'!9(-%#8-$)2*3&$'!"!
!
/489#*3&*+$!,$!6C>PQ!
! J&87*9$!:!#48,323()!*-8&39*3)$!,$*l’ÉtrangerG!RSTT!
!
6(-%*&$&!,$'!3)93%32!,$!&(-*)!"!
! Madame!de!LAFAYETTEG!La*Princesse*de*ClèvesG!RUVW!
! Denis!DIDEROTG!Jacques*le*Fataliste*et*son*maîtreG!RVVW!
! Émile!ZOLAG!GerminalG!RWWT!
! Marcel!PROUSTG!Du*côté*de*chez*Swann,!RSRX!
!
!
2. D’autres!figures!de!l’étrangeté!dans!le!roman!hugolien!
/$921&$'!*)*#A2301$'!"!
! Y392(&!ZP[FG!L’homme*qui*ritG!RWUSG!J(&2&*32!,41)!-()'2&$!
! Y392(&!ZP[FG!Les*MisérablesG!RWU\G!1)!$)7*)2!$)!$)7$&!
!
Lecture!cursive!:!!
J53#3%%$!6/CPH;/G!Le*rapport*de*Brodeck!
!
Spectacle!vivant!:!/$'!8#=<$'!()2!*''3'28!:!1)$!&$%&8'$)2*23()!,1!'%$92*9#$!,$!J3$!!
O'53I*),*!*1!258]2&$!,1!J$232!Z8I$&25(2G!Un*fou*noir*au*pays*des*blancs!
!

!
Séquence!3!! ! ! ! ! ! ! ! ! texte!1!
!
Albert!CAMUS,!L’Etranger,!1942!
!
!
R=&$!%*&23$G!65*%32&$!R!
!
!
!
!
!
! C1D(1&,^513G!-*-*)!$'2!-(&2$.!F1!%$12K_2&$!53$&G!D$!)$!'*3'!%*'.!L^*3!&$`1!1)!
28#8+&*--$!,$!#^*'3#$"!B>=&$!,898,8$.!;)2$&&$-$)2!,$-*3).!Q$)23-$)2'!,3'23)+18'.E!
6$#*!)$!<$12!&3$)!,3&$.!6^82*32!%$12K_2&$!53$&.!
!/^*'3#$!,$!<3$3##*&,'!$'2!:!>*&$)+(G!:!01*2&$K<3)+2'!a3#(-=2&$'!,^C#+$&.!L$!%&$),&*3!
#^*12(I1'!:!,$1?!5$1&$'!$2!D^*&&3<$&*3!,*)'!#^*%&='K-3,3.!C3)'3G!D$!%(1&&*3!<$3##$&!$2!D$!
&$)2&$&*3!,$-*3)!'(3&.!L^*3!,$-*),8!,$1?!D(1&'!,$!9()+8!:!-()!%*2&()!$2!3#!)$!%(1<*32!
%*'!-$!#$'!&$71'$&!*<$9!1)$!$?91'$!%*&$3##$.!>*3'!3#!)^*<*32!%*'!#^*3&!9()2$)2.!L$!#13!*3!
-_-$!,32!"!B6$!)^$'2!%*'!,$!-*!7*12$.E!bb!)^*!%*'!&8%(),1.!L^*3!%$)'8!*#(&'!01$!D$!
)^*1&*3'!%*'!,c!#13!,3&$!9$#*.!;)!'(--$G!D$!)^*<*3'!%*'!:!-^$?91'$&.!6^82*32!%#12d2!:!#13!
,$!-$!%&8'$)2$&!'$'!9(),(#8*)9$'.!>*3'!3#!#$!7$&*!'*)'!,(12$!*%&='K,$-*3)G!01*),!3#!
-$!<$&&*!$)!,$13#.!J(1&!#$!-(-$)2G!9^$'2!1)!%$1!9(--$!'3!-*-*)!)^82*32!%*'!-(&2$.!
C%&='!#^$)2$&&$-$)2G!*1!9()2&*3&$G!9$!'$&*!1)$!*77*3&$!9#*''8$!$2!2(12!*1&*!&$<_21!1)$!
*##1&$!%#1'!(77393$##$.!
! L^*3!%&3'!#^*12(I1'!:!,$1?!5$1&$'.!bb!7*3'*32!2&='!95*1,.!L^*3!-*)+8!*1!&$'2*1&*)2G!
95$e!
68#$'2$G!9(--$!,^5*I321,$.!b#'!*<*3$)2!2(1'!I$*19(1%!,$!%$3)$!%(1&!-(3!$2!68#$'2$!
-^*!,32"!BF)!)^*!01^1)$!-=&$.E!f1*),!D$!'13'!%*&23G!3#'!-^()2!*99(-%*+)8!:!#*!%(&2$.!
L^82*3'!1)!%$1!82(1&,3!%*&9$!01^3#!*!7*##1!01$!D$!-()2$!95$e!;--*)1$#!%(1&!#13!
$-%&1)2$&!1)$!9&*<*2$!)(3&$!$2!1)!I&*''*&,.!b#!*!%$&,1!'()!()9#$G!3#!A!*!01$#01$'!-(3'.!
! L^*3!9(1&1!%(1&!)$!%*'!-*)01$&!#$!,8%*&2.!6$22$!5]2$G!9$22$!9(1&'$G!9^$'2!:!9*1'$!,$!
2(12!9$#*!'*)'!,(12$G!*D(128!*1?!9*5(2'G!:!#^(,$1&!,^$''$)9$G!:!#*!&8<$&I8&*23()!,$!#*!
&(12$!$2!,1!93$#G!01$!D$!-$!'13'!*''(1%3.!L^*3!,(&-3!%$),*)2!%&$'01$!2(12!#$!2&*D$2.!;2!
01*),!D$!-$!'13'!&8<$3##8G!D^82*3'!2*''8!9()2&$!1)!-3#32*3&$!013!-^*!'(1&3!$2!013!-^*!
,$-*),8!'3!D$!<$)*3'!,$!#(3).!L^*3!,32!B(13E!%(1&!)^*<(3&!%#1'!:!%*&#$&.!
! /4*'3#$!$'2!:!,$1?!a3#(-=2&$'!,1!<3##*+$.!L4*3!7*32!#$!95$-3)!:!%3$,.!L4*3!<(1#1!<(3&!
-*-*)!2(12!,$!'132$.!>*3'!#$!9()93$&+$!-4*!,32!0143#!7*##*32!01$!D$!&$)9()2&$!#$!,3&$92$1&.!
6(--$!3#!82*32!(991%8G!D4*3!*22$),1!1)!%$1.!J$),*)2!2(12!9$!2$-%'G!#$!9()93$&+$!*!%*!$2!
$)'132$G!D4*3!<1!#$!,3&$92$1&!"!3#!-4*!&$`1!,*)'!'()!I1&$*1.!64$'2!1)!%$232!<3$1?G!*<$9!#*!
/8+3()!,45())$1&.!b#!-4*!&$+*&,8!,$!'$'!A$1?!9#*3&'.!J13'!3#!-4*!'$&&8!#*!-*3)!0143#!*!
+*&,8$!'3!#()+2$-%'!01$!D$!)$!'*<*3'!2&(%!9(--$)2!#*!&$23&$&.!b#!*!9()'1#28!1)!,(''3$&!$2!
-4*!,32!"!B!>-$!>$1&'*1#2!$'2!$)2&8$!393!3#!A!*!2&(3'!*)'.!Y(1'!823$e!'()!'$1#!'(123$).!E!L4*3!
9&1!0143#!-$!&$%&(95*32!01$#01$!95('$!$2!D4*3!9(--$)98!:!#13!$?%#301$&.!>*3'!3#!-4*!
3)2$&&(-%1!"!B!Y(1'!)4*<$e!%*'!:!<(1'!D1'2373$&G!-()!95$&!$)7*)2.!L4*3!#1!#$!,(''3$&!,$!
<(2&$!-=&$.!Y(1'!)$!%(1<3$e!'1I<$)3&!:!'$'!I$'(3)'.!b#!#13!7*##*32!1)$!+*&,$.!!Y('!'*#*3&$'!
'()2!-(,$'2$'.!;2!2(12!9(-%2$!7*32G!$##$!82*32!%#1'!5$1&$1'$!393.!E!L4*3!,32!"!B!F13G!-()'3$1&!
#$!H3&$92$1&.!E!
!
!
!
!
!

!
!
Séquence!3! ! ! ! ! ! ! ! ! texte!2!
!
Albert!CAMUS,!L’Etranger,!1942!
!
R=&$!%*&23$G!95*%32&$!T!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
/$!'(3&G!>*&3$!$'2!<$)1$!-$!95$&95$&!$2!-^*!,$-*),8!'3!D$!<(1#*3'!-$!-*&3$&!*<$9!$##$.!
L^*3!,32!01$!9$#*!-^82*32!8+*#!$2!01$!)(1'!%(1&&3()'!#$!7*3&$!'3!$##$!#$!<(1#*32.!;##$!*!<(1#1!
'*<(3&!*#(&'!'3!D$!#^*3-*3'.!L^*3!&8%(),1!9(--$!D$!#^*<*3'!,8D:!7*32!1)$!7(3'G!01$!9$#*!)$!
'3+)373*32!&3$)!-*3'!01$!'*)'!,(12$!D$!)$!#^*3-*3'!%*'.!B!J(1&01(3!-^8%(1'$&!*#(&'@!E!*K2K
$##$!,32.!L$!#13!*3!$?%#3018!01$!9$#*!)^*<*32!*191)$!3-%(&2*)9$!$2!01$!'3!$##$!#$!,8'3&*32G!
)(1'!%(1<3()'!)(1'!-*&3$&.!H^*3##$1&'G!9^82*32!$##$!013!#$!,$-*),*32!$2!-(3!D$!-$!
9()2$)2*3'!,$!,3&$!(13.!;##$!*!(I'$&<8!*#(&'!01$!#$!-*&3*+$!82*32!1)$!95('$!+&*<$.!L^*3!
&8%(),1!"!B!g().!E!;##$!'^$'2!21$!1)!-(-$)2!$2!$##$!-^*!&$+*&,8!$)!'3#$)9$.!J13'!$##$!*!
%*.!;##$!<(1#*32!'3-%#$-$)2!'*<(3&!'3!D^*1&*3'!*99$%28!#*!-_-$!%&(%('323()!<$)*)2!
,^1)$!*12&$!7$--$G!:!013!D$!'$&*3'!*22*958!,$!#*!-_-$!7*`().!L^*3!!
,32!"!B!g*21&$##$-$)2.!E!!;##$!'^$'2!,$-*),8!*#(&'!'3!$##$!-^*3-*32!$2!-(3G!D$!)$!%(1<*3'!
&3$)!'*<(3&!'1&!9$!%(3)2.!C%&='!1)!*12&$!-(-$)2!,$!'3#$)9$G!$##$!*!-1&-1&8!01$!D^82*3'!
I3e*&&$G!01^$##$!-^*3-*32!'*)'!,(12$!:!9*1'$!,$!9$#*!-*3'!01$!%$12K_2&$!1)!D(1&!D$!#*!
,8+(c2$&*3'!%(1&!#$'!-_-$'!&*3'()'.!6(--$!D$!-$!2*3'*3'G!)^*A*)2!&3$)!:!*D(12$&G!$##$!
-^*!%&3'!#$!I&*'!$)!'(1&3*)2!$2!$##$!*!,89#*&8!01^$##$!<(1#*32!'$!-*&3$&!*<$9!-(3.!L^*3!
&8%(),1!01$!)(1'!#$!7$&3()'!,='!01^$##$!#$!<(1,&*32.!L$!#13!*3!%*!*#(&'!,$!#*!%&(%('323()!
,1!%*2&()!$2!>*&3$!-^*!,32!01^$##$!*3-$&*32!9())*h2&$!J*&3'.!L$!#13!*3!*%%&3'!01$!D^A!*<*3'!
<891!,*)'!1)!2$-%'!$2!$##$!-^*!,$-*),8!9(--$)2!9^82*32.!L$!#13!*3!,32!"!B!6^$'2!'*#$.!b#!A!*!
,$'!%3+$()'!$2!,$'!9(1&'!)(3&$'.!/$'!+$)'!()2!#*!%$*1!I#*)95$.!E!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
Séquence!3! ! ! ! ! ! ! ! texte!3!
!
Albert!CAMUS,!L’Etranger,!1942!
!
R=&$!%*&23$G!95*%32&$!U!
!
!
!
!
!
!
J(1&!-(3G!9482*32!1)$!53'2(3&$!73)3$!$2!D482*3'!<$)1!#:!'*)'!A!%$)'$&.!
H='! 0143#! -4*! <1G! 3#! '4$'2! '(1#$<8! 1)! %$1! $2! *! -3'! '*! -*3)! ,*)'! '*! %(95$.! >(3G!
)*21&$##$-$)2G!D4*3!'$&&8!#$!&$<(#<$&!,$!i*A-(),!,*)'!-()!<$'2().!C#(&'!,$!)(1<$*1G!3#!
'4$'2!#*3''8!*##$&!$)!*&&3=&$G!-*3'!'*)'!&$23&$&!#*!-*3)!,$!'*!%(95$.!L482*3'!*''$e!#(3)!,$!#13G!
:! 1)$! ,3e*3)$! ,$! -=2&$'.! L$! ,$<3)*3'! '()! &$+*&,! %*&! 3)'2*)2'G! $)2&$! '$'! %*1%3=&$'! -3K
9#('$'.!>*3'!#$!%#1'!'(1<$)2G!'()!3-*+$!,*)'*32!,$<*)2!-$'!A$1?G!,*)'!#4*3&!$)7#*--8.!/$!
I&132!,$'!<*+1$'!82*32!$)9(&$!%#1'!%*&$''$1?G!%#1'!82*#$!014:!-3,3.!6482*32!#$!-_-$!'(#$3#G!
#*!-_-$!#1-3=&$!'1&!#$!-_-$!'*I#$!013!'$!%&(#()+$*32!393.!b#!A!*<*32!,8D:!,$1?!5$1&$'!01$!
#*!D(1&)8$!)4*<*)`*32!%#1'G!,$1?!5$1&$'!014$##$!*<*32!D$28!#4*)9&$!,*)'!1)!(98*)!,$!-82*#!
I(13##*)2.!C!#45(&3e()G!1)!%$232!<*%$1&!$'2!%*''8!$2!D4$)!*3!,$<3)8!#*!2*95$!)(3&$!*1!I(&,!,$!
-()!&$+*&,G!%*&9$!01$!D$!)4*<*3'!%*'!9$''8!,$!&$+*&,$&!#4C&*I$.!
L^*3!%$)'8!01$! D$!)^*<*3'!01^1)!,$-3K2(1&!:! 7*3&$!$2!9$!'$&*32!73)3.!>*3'!2(12$!1)$! %#*+$!
<3I&*)2$!,$!'(#$3#!'$!%&$''*32!,$&&3=&$!-(3.!L^*3!7*32!01$#01$'!%*'!<$&'!#*!'(1&9$.!/^C&*I$!
)^*!%*'!I(1+8.!>*#+&8!2(12G!3#!82*32!$)9(&$!*''$e!#(3).!J$12K_2&$!:!9*1'$!,$'!(-I&$'!'1&!
'()!<3'*+$G!3#!*<*32!#^*3&!,$!&3&$.!L^*3!*22$),1.!/*!I&c#1&$!,1!'(#$3#!+*+)*32!-$'!D(1$'!$2!D^*3!
'$)23!,$'!+(122$'!,$!'1$1&!'^*-*''$&!,*)'!-$'!'(1&93#'.!6^82*32!#$!-_-$!'(#$3#!01$!#$!D(1&!
(j!D^*<*3'!$)2$&&8!-*-*)!$2G!9(--$!*#(&'G!#$!7&()2!'1&2(12!-$!7*3'*32!-*#!$2!2(12$'!'$'!
<$3)$'!I*22*3$)2!$)'$-I#$!'(1'!#*!%$*1.!C!9*1'$!,$!9$22$!I&c#1&$!01$!D$!)$!%(1<*3'!%#1'!
'1%%(&2$&G!D^*3!7*32!1)!-(1<$-$)2!$)!*<*)2.!L$!'*<*3'!01$!9^82*32!'21%3,$G!01$!D$!)$!-$!
,8I*&&*''$&*3'!%*'!,1!'(#$3#!$)!-$!,8%#*`*)2!,^1)!%*'.!>*3'!D^*3!7*32!1)!%*'G!1)!'$1#!%*'!
$)! *<*)2.! ;2! 9$22$! 7(3'G! '*)'! '$! '(1#$<$&G! #^C&*I$! *! 23&8! '()! 9(12$*1! 01^3#! -^*! %&8'$)28!
,*)'!#$!'(#$3#.!/*!#1-3=&$!*!+39#8!'1&!#^*93$&!$2!9^82*32!9(--$!1)$!#()+1$!#*-$!823)9$#*)2$!
013!-^*22$3+)*32!*1!7&()2.!C1!-_-$!3)'2*)2G!#*!'1$1&!*-*''8$!,*)'!-$'!'(1&93#'!*!9(1#8!
,^1)! 9(1%! '1&! #$'! %*1%3=&$'! $2! #$'! *! &$9(1<$&2$'! ,^1)! <(3#$! 23=,$! $2! 8%*3'.! >$'! A$1?!
82*3$)2! *<$1+#8'! ,$&&3=&$! 9$! &3,$*1! ,$! #*&-$'! $2! ,$! '$#.! L$! )$! '$)2*3'! %#1'! 01$! #$'!
9A-I*#$'!,1!'(#$3#!'1&!-()!7&()2!$2G!3),3'23)92$-$)2G!#$!+#*3<$!89#*2*)2!D*3##3!,1!9(12$*1!
2(1D(1&'! $)! 7*9$! ,$! -(3.! 6$22$! 8%8$! I&c#*)2$! &()+$*32! -$'! 93#'! $2! 7(13##*32! -$'! A$1?!
,(1#(1&$1?.!6^$'2!*#(&'!01$!2(12!*!<*93##8.!/*!-$&!*!95*&&38!1)!'(177#$!8%*3'!$2!*&,$)2.!b#!
-^*!'$-I#8!01$!#$!93$#!'^(1<&*32!,$!2(12$!'()!82$),1$!%(1&!#*3''$&!%#$1<(3&!,1!7$1.!O(12!
-()!_2&$!'^$'2!2$),1!$2!D^*3!9&3'%8!-*!-*3)!'1&!#$!&$<(#<$&.!/*!+]95$22$!*!98,8G!D^*3!2(1958!
#$!<$)2&$!%(#3!,$!#*!9&(''$!$2!9^$'2!#:G!,*)'!#$!I&132!:!#*!7(3'!'$9!$2!*''(1&,3''*)2G!01$!2(12!*!
9(--$)98.!L^*3!'$9(18!#*!'1$1&!$2!#$!'(#$3#.!L^*3!9(-%&3'!01$!D^*<*3'!,82&132!#^8013#3I&$!,1!
D(1&G! #$! '3#$)9$! $?9$%23())$#! ,^1)$! %#*+$! (j! D^*<*3'! 828! 5$1&$1?.! C#(&'G! D^*3! 23&8! $)9(&$!
01*2&$!7(3'!'1&!1)!9(&%'!3)$&2$!(j!#$'!I*##$'!'^$)7()`*3$)2!'*)'!01^3#!A!%*&c2.!;2!9^82*32!
9(--$!01*2&$!9(1%'!I&$7'!01$!D$!7&*%%*3'!'1&!#*!%(&2$!,1!-*#5$1&.!
!
!
!
!
!

!
Séquence!3! ! ! ! ! ! ! ! texte!4!
!
Albert!CAMUS,!L’Etranger,!1942!
!
\=-$!%*&23$G!95*%32&$!k!
L’après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l’air épais de la salle et les petits
éventails multicolores des jurés s’agitaient tous dans le même sens. La plaidoirie de mon
avocat me semblait ne devoir jamais finir. A un moment donné, cependant, je l’ai écouté
parce qu’il disait: « Il est vrai que j’ai tué. » Puis il a continué sur ce ton, disant « je » chaque
fois qu’il parlait de moi. J’étais très étonné. Je me suis penché vers un gendarme et je lui ai
demandé pourquoi. Il m’a dit de me taire et, après un moment, il a ajouté: « Tous les avocats
font ça. » Moi, j’ai pensé que c’était m’écarter encore de l’affaire, me réduire à zéro et, en un
certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j’étais déjà très loin de cette salle
d’audience. D’ailleurs, mon avocat m’a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très
rapidement et puis lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m’a paru qu’il avait beaucoup moins
de talent que le procureur. « Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme, mais,
contrairement à l’éminent représentant du ministère public, j’ai trouvé quelque chose et je
puis dire que j’y ai lu à livre ouvert.» II y avait lu que j’étais un honnête homme, un
travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qui l’employait, aimé de tous et
compatissant aux misères d’autrui. Pour lui, j’étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère
aussi longtemps qu’il l’avait pu. Finalement j’avais espéré qu’une maison de retraite
donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui
procurer. « Je m’étonne, messieurs, a-t-il ajouté, qu’on ait mené si grand bruit autour de cet
asile. Car enfin, s’il fallait donner une preuve de l’utilité et de la grandeur de ces institutions,
il faudrait bien dire que c’est l’Etat lui-même qui les subventionne. » Seulement, il n’a pas
parlé de l’enterrement et j’ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie. Mais à cause de
toutes ces longues phrases, de toutes ces journées et ces heures interminables pendant
lesquelles on avait parlé de mon âme, j’ai eu l’impression que tout devenait comme une eau
incolore où je trouvais le vertige. A la fin, je me souviens seulement que, de la rue et à travers
tout l’espace des salles et des prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la
trompette d’un marchand de glace a résonné jusqu’à moi. J’ai été assailli des souvenirs d’une
vie qui ne m’appartenait plus, mais où j’avais trouvé les plus pauvres et les plus tenaces de
mes joies: des odeurs d’été, le quartier que j’aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes
de Marie. Tout ce que je faisais d’inutile en ce lieu m’est alors remonté à la gorge et je n’ai eu
qu’une hâte, c’est qu’on en finisse et que je retrouve ma cellule avec le sommeil. C’est à
peine si j’ai entendu mon avocat s’écrier, pour finir, que les jurés ne voudraient pas envoyer à
la mort un travailleur honnête perdu par une minute d’égarement, et demander les
circonstances atténuantes pour un crime dont je traînais déjà, comme le plus sûr de mes
châtiments, le remords éternel. La cour a suspendu l’audience et l’avocat s’est assis d’un air
épuisé. Mais ses collègues sont venus vers lui pour lui serrer la main. J’ai entendu:
« Magnifique, mon cher.» L’un d’eux m’a même pris à témoin: « Hein? » m’a-t-il dit. J’ai
acquiescé, mais mon compliment n’était pas sincère, parce que j’étais trop fatigué.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%