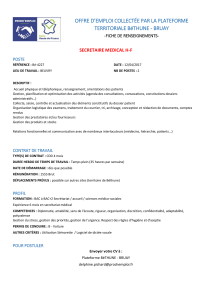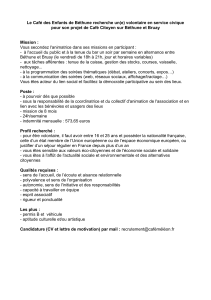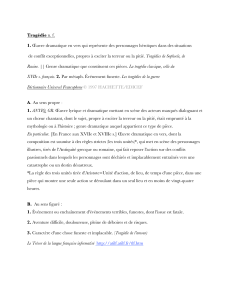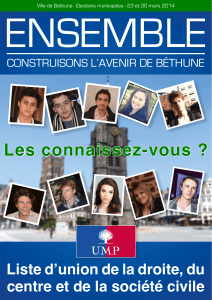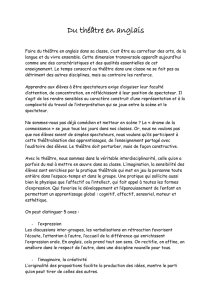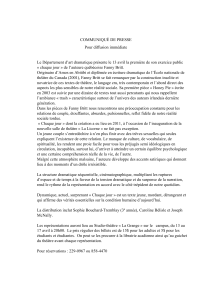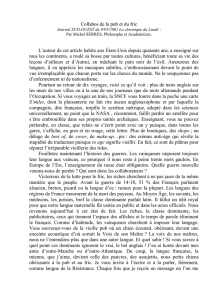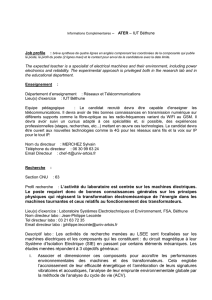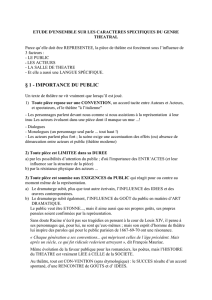dossier dramaturgique

la comédie de béthune - centre dramatique national hauts-de-france - cs 7o631 62412 béthune cedex
MON FRIC
dossier dramaturgique
©Malte Martin atelier graphique
de David Lescot mise en scène Cécile Backès
à partir de 10 ans | durée estimée 1h25
dossier dramaturgique réalisé par Guillaume Clayssen
partageons le théâtre
comédie de béthune
cdn hauts-de-france

la comédie de béthune - centre dramatique national hauts-de-france - cs 7o631 62412 béthune cedex
équipe
texte David Lescot (éd. Actes Sud)
mise en scène Cécile Backès | La Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France
jeu Pauline Jambet, Pierre-Louis Jozan, Maxime Le Gall, Simon Pineau, Noémie
Rosenblatt dramaturgie Guillaume Clayssen
assistanat à la mise en scène Margaux Eskenazi
scénographie Raymond Sarti
chorégraphie Marie-Laure Caradec
lumière Pierre Peyronnet
son Stephan Faerber
conseil son Juliette Galamez
costumes Camille Pénager
réalisation accessoires Morgane Barbry
maquillage Catherine Nicolas
régie générale, régie plateau Marie-Agnès d’Anselme
régie lumière Jean-Gabriel Valot
régie son Julien Lamorille
construction du décor atelier Comédie de Béthune :
Jean-Michel Cerf, Jean-Claude Czarnecka, Eddy Garcie, Erwann Henri
équipe technique lors de la création
Olivier Merlin, Mélanie Sainz Fernandez, Alix Weugue
mentions de production
production Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France
coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre Dramatique National
avec le soutien du Ballet du Nord Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-
France
texte publié aux éditions Actes Sud-Papiers
calendrier
› juin – novembre 14
commande d’écriture à david lescot
› 11 au 14 octobre 16
création - comédie de béthune cdn hauts-de-france
› novembre 2o16 – mars 17
théâtre national de nice › 3o nov au 2 déc 16
théâtre dijon-bourgogne - cdn › 6 au 9 déc 16
comédie de saint-étienne - cdn › 11 au 13 jan 17
la criée – théâtre national de marseille › 2 au 4 mars 17
théâtre de sartrouville et des yvelines - cdn › 22 au 24 mars 17
› 28 mars au 1er avril 17
reprise - comédie de béthune cdn hauts-de-france

la comédie de béthune - centre dramatique national hauts-de-france - cs 7o631 62412 béthune cedex
introduction
note d’intention de la metteure en scene
On parle peu d’argent. Le théâtre se mêle souvent de parler de la famille, mais rarement sous l’angle
de l’argent. Pourtant, de l’enfance au soir de la vie, la préoccupation de l’argent rythme le quotidien.
Car on peut rêver d’en avoir plus. Et souvent, on dépense plus qu’on ne gagne. Mais comment faire ?
On me propose de m’enrichir en magouillant un peu… j’accepte ? Mais à quelles conditions ? Où
situer la limite de l’argent sale, de l’argent immoral, de l’argent interdit ? Peut-on imaginer de vivre
sans argent, et sans tous ces tourments ? L’argent, étroitement lié au travail et au besoin de
dépense, obsède nos jours et nos nuits.
David Lescot avait écrit une forme courte sur l’argent. Je lui ai proposé d’écrire le texte d’un
spectacle qui, à travers ce thème, parlerait aux adolescents d’aujourd’hui. Dans
Mon
Fric
, il écrit le
récit d’une vie entre 1972 et 2040. « Moi, j’ai juste eu une vie normale », dit Moi, le personnage
central. Une enfance dans les années 70, encore empreinte d’URSS, de culture marxiste et déjà de
rock. Une vie où vont débouler Renaud (le chanteur), l’Inde, un vendeur de chez Darty, une sortie au
cirque, Georges Bataille, les spectres du marxisme, l’avènement du libéralisme sauvage, et l’espoir
des économies alternatives.
Voici donc Moi et sa famille, Moi, ses amours, ses emmerdes, sa jeunesse et ses ratages qui défilent.
Voici aussi, en filigrane, les dernières décennies qui défilent. David Lescot déplie les feuilles d’un
théâtre choral, drôle et léger, où l’on s’adresse en alternance tour à tour au public et aux autres
personnages… personnages ? Des croquis d’êtres humains, plutôt, qui passent la tête le temps d’une
ou deux répliques, le temps dont la fable a besoin.
Mon Fric
est un texte à jouer dans l’esprit d’une
BD en croquant les détails, les gestes et les façons de parler.
La cour de récré, la rue devant le collège, l’arrêt du bus de ramassage scolaire, les colonies, le couloir
de la maison où nous sommes nombreux à avoir inventé nos premiers théâtres de mômes, nos
courses folles, nos cachettes sous un manteau qui sent fort le monde des adultes… les lieux de
Mon
Fric
composent un « vestiaire de l’enfance », comme l’a joliment écrit Patrick Modiano. Entrelaçant
les thèmes du moi, du temps et de l’argent, David Lescot s’affirme comme l’auteur d’un théâtre de la
mémoire commune.
« J’aime beaucoup les fantômes : des êtres qui n’existent pas mais qui sont là, qui sont morts mais
qui reviennent, qui parlent. Les fantômes peuplent les rêves aussi bien que les scènes de théâtre. Un
personnage de théâtre c’est un fantôme. Il n’existe pas, mais il revient tous les soirs. On y croit
quand on est enfant, puis on n’y croit plus, puis on y recroit, quand on a compris que l’univers du
rêve et celui du théâtre étaient frères ». Ces paroles de David Lescot révèlent une fantaisie exaltante,
toute en humour et en délicatesse, et pour moi un terrain de jeu intimement lié à ce que je cherche
au théâtre : un espace habité par les ombres du paradis perdu de l’enfance, où les revenants et les
présents s’évanouissent et reparaissent comme dans un rêve. Ce « récit-théâtre » de
Mon Fric
propose de jouer avec les différentes couleurs du temps : présent et passé s’enlacent pour laisser
apparaître la possibilité d’un futur composé. Est-ce possible ? Oui, puisque l’art du théâtre détient les
clés de ce jeu des temps. « L’argent, c’est le temps », semble dire David Lescot, à l’inverse du
proverbe bien connu.
Ce terrain de jeu, je vais le partager avec une équipe de jeunes acteurs vus dans
J’ai 20 ans qu’est-ce
qui m’attend ?
et
Requiem
, qui vont jouer de cette joyeuse écriture à ressort. Car la musique de
l’écriture de David Lescot, percussive, battante, entraînante, éteint et rallume à volonté les signes de
toute vie.
Cécile Backès

la comédie de béthune - centre dramatique national hauts-de-france - cs 7o631 62412 béthune cedex
de quoi mon fric est-il le titre?
« Avoir du fric, du pognon, du blé, de l’oseille, de la thune, de la maille, des sous, des ronds, du
flouze, etc.
Utilisés dans le langage familier, tous ces mots sont des synonymes du mot « argent ». Les formes
employées sont nombreuses: selon les époques, les régions, l’âge du locuteur, l’origine sociale, les
intentions, le contexte, le vocabulaire utilisé diffère. Etablir une liste exhaustive de toutes les
expressions utilisées pour qualifier le mot
argent
s’avère donc être une entreprise difficile, où il est
presque certain qu’un mot manquera à l’appel! De même, il est difficile de connaître l’origine exacte
de ces mots, résultats d’inventions et d’évolutions constantes au sein du langage parlé populaire.
Certaines origines peuvent tout de même être identifiées. Ainsi le mot « fric » prend ses origines au
19ème siècle dans le mot « fricot », lui-même tiré du mot « fricoter » qui signifie « être dans des
affaires louches ». Le mot « flouze » provient quant à lui du mot arabe « flws » qui signifie une petite
somme d’argent. »
Le Petit journal.com
un entrelacs singulier de trois notions : l’argent, le moi
et le temps
Mon fric
questionne évidemment notre rapport à l’argent mais aussi au temps. Ces deux concepts
sont souvent corrélés dans un sens économique. La célèbre formule attribuée à Benjamin Franklin
- « le temps c’est de l’argent » - consacre une vision capitaliste et quantitative de la vie.
L’originalité de la pièce est d’inverser le rapport habituel entre les deux concepts. Ce n’est plus ici
l’argent qui mesure le temps, mais le temps qui mesure l’argent. La question posée par
Mon fric
pourrait être la suivante : comment l’argent me raconte ? Comment fait-il partie de mon
identité
narrative
, pour reprendre l’expression de Paul Ricœur ? Souvent occulté dans nos discours, dans nos
récits de vie, l’argent parle pourtant de nous de manière essentielle. Présent à chaque étape de
notre vie, sous une forme ou sous une autre, il se remplit de notre imaginaire, de nos besoins réels
ou factices, de nos jugements de valeur. De l’argent de poche aux dettes bancaires ou familiales, des
jeux d’argent à la question quotidienne de l’aumône aux SDF, notre existence est jalonnée par tous
les usages possibles que nous faisons du « fric ». On pourrait donc résumer la pièce de David Lescot
en inversant la célèbre formule capitaliste : « l’argent c’est du temps ». C’est ce temps-là de notre
économie réelle et imaginaire, de notre économie intime et psychique, souvent oublié, refoulé, que
nous raconte très concrètement et très poétiquement
Mon Fric
.
Cette structure temporelle du texte fait naturellement vibrer notre oreille musicienne. La pièce est
une sorte de fuite, de fugue, de flux où l’écoulement du temps et l’écoulement de l’argent sont en
écho l’un de l’autre. Le « Moi » file, dépense et se dépense, et part comme le temps ou comme
l’argent.
Au final, un entrelacs de trois notions essentielles se dégage à la lecture de
Mon fric
: l’argent, le moi,
le temps (A.M.T.)

la comédie de béthune - centre dramatique national hauts-de-france - cs 7o631 62412 béthune cedex
› références
Texte 1 :
Jean Baudrillard,
La Société de Consommation
(in.
Antimanuel d’économie
de Bernard Maris, p. 231)
« L’analogie du temps avec l’argent est par contre fondamentale pour analyser “notre temps”, et ce
que peut impliquer la grande coupure significative entre temps de travail et temps libre, coupure
décisive, puisque c’est sur elle que se fondent les options fondamentales de la société de
consommation.
Time is money
: cette devise inscrite en lettres de feu sur les machines à écrire
Remington l’est aussi au fronton des usines, dans le temps asservi de la quotidienneté, dans la
notion de plus en plus importante de “budget-temps”. Elle régit même — et c’est ce qui nous
intéresse ici — le loisir et le temps libre. C’est encore elle qui définit le temps vide et qui s’inscrit au
cadran solaire des plages sur le fronton des clubs de vacances. Le temps est une denrée rare,
précieuse, soumise aux lois de la valeur d’échange. Ceci est clair pour le temps de travail, puisqu’il
est vendu et acheté. Mais de plus le temps libre lui-même doit être, pour être “consommé”,
directement ou indirectement acheté. Norman Mailer analyse le calcul de production opéré sur le
jus d’orange, livré congelé ou liquide (en carton). Ce dernier coûte plus cher parce qu’on inclut dans
le prix les deux minutes gagnées sur la préparation du produit congelé : son propre temps libre est
ainsi vendu au consommateur. Et c’est logique, puisque le temps “libre” est en fait du temps
“gagné”, du capital rentabilisable, de la force productive virtuelle, qu’il faut donc racheter pour en
disposer. »
Iconographie 1 :
Mona Hatoum,
Light Sentence
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%