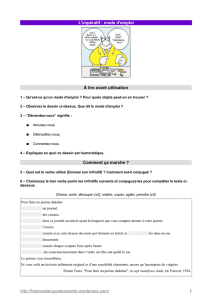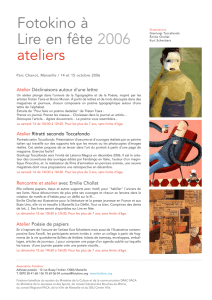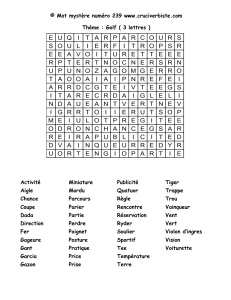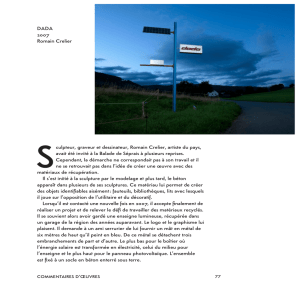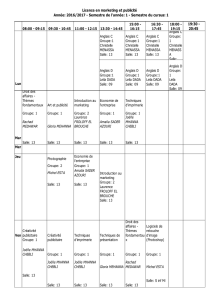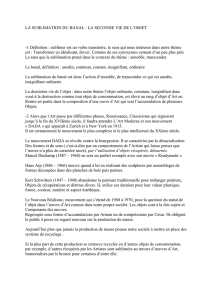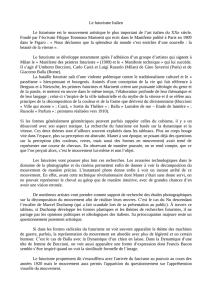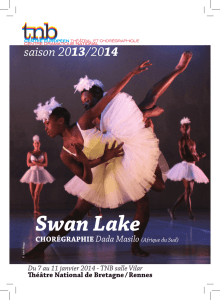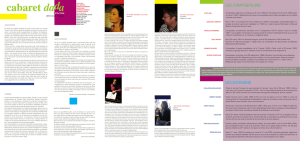CHAPITRE 1 : LE DÉGOÛT

CHAPITRE 1 :
LE DÉGOÛT
41

42

1.1 Introduction
Ah ! dégoût, dégoût, dégoût ! — Ainsi
parlait Zarathoustra soupirant et frissonnant;
car il lui souvenait de sa maladie.
(Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, III,
Le convalescent).1
"Les débuts de Dada n'étaient pas les débuts d'un art, mais ceux d'un
dégoût", dit Tzara dans 1922. 2 Précisément, comme nous verrons le long de
ce chapitre, la pensée Dada de Tzara —et de des autres dadaïstes — est
inséparable de cette forte sensation de " dégoût "(dégoût) face aux idées et
l'état de choses dominantes de l'époque : il apparaît comme rejet tranchant à
cette civilisation qui paraissait profondément malade (bien qu'elle s'agit d'un
rejet, comme nous verrons dans les chapitres 2 et 3, accompagné par une
proposition absolument positive). Ainsi, tout comme Zarathustra le
convalescent, Dada naît comme une grande force affirmative à partir de cette
négativité alors régnante.
Il est pour cette raison que nous commençons notre recherche par étudier
les différents éléments de la civilisation européenne qui lui provoquaient cette
sensation de dégoût à Tzara. La liste est assez longue et comprend beaucoup
de domaines : la "selfcleptomanie ", l'instinct de domination, la morale, la
logique, le culte a le beau, etc.. Dans ce chapitre, nous verrons chacun de ces
éléments et d’autres pour avoir une vision générale du tableau diagnostique de
Tzara de ce qu'il appelle "cadre européen de faiblesses", cadre qui, comme
nous avons déjà dit, ce n'est que la condition de la naissance de Dada.
Ainsi, dans 1.2, nous commencerons par voir l'évaluation globale que Tzara
fait de la civilisation européenne de l'époque. Pour notre auteur, l'homme
européen —spécialement le bourgeois —est profondément touché par une
"maladie" qu'il appelle "selfcleptomanie " (c'est-à-dire, l'homme européen se
vole à lui-même sa personnalité propre), et ceci dérive du faux "principe de
1 Cité par Deleuze, Nietzsche, PUF, París, 1992, p. 92. (Traduction au français par G. Bianquis).
2 O. C., t 1, p 423. Phrase de la "Conférence sur Dada", prononcée à Weimar et Iéna en septembre
1922. Après Dada, Tzara répète l'idée du dégoût (dégoût) comme origine de Dada, voir, par
exemple, O.C., t 5., pp. 85 et 396.
43

propriété" que régit la société européenne. Posent une certaine solution les
intellectuels et les artistes à cette situation ? Au contraire, trop de d'eux,
tellement vides comme les bourgeois, se consacrent à dominer aux autres et à
s’imposer, à travers une utilisation sophistiquée de la logique et de la morale
—en réaffirmant ainsi le statu quo. Selon Tzara, toute cette situation, et "le
contrôle de la morale et de la logique", a laissé spécialement à l'homme
européen dans un état d'impuissance et d'esclavage : il s'ensuit que Dada
envisage un grand travail de nettoyage.
Ce travail de nettoyage a quelques fronts essentiels. Un d'eux est la morale
(1.3). Tout comme Nietzsche, Tzara découvre dans la morale et la piété —
hautement favorisées par les intellectuels —une lourdeur, une foncée volonté
de négation de la vie. De là, "le dégoût dadaïste " à la morale et à la piété, et
son effort par "démoraliser partout".
Un autre front est la logique (1.4). Tzara pense que l'intelligence logique est
incapable de saisir la vie. La logique, pour Tzara, nous remplit
d'"explications", lesquelles, bien qu'ils soient seulement des simples
justifications a posteriori, finissent par remplacer ce qui est vécu et en somme,
finissent par réprimir la multiplicité naturelle des flux vitaux. Mais il y a plus :
les sciences et la philosophie (spécialement la philosophie dialectique)
construisent de grands bâtiments logiques qui nous imposent une seule
manière de voir la réalité —et cette manière de voir est complice de l'ordre
établi dans la société européenne. Comment libérer de ce buisson de choses
dans lesquelles l'homme européen est plongé? Une proposition à la fois
amusante et totalement cohérente de Tzara —et de Dada —consiste
l'instauration de l’"idiot", figure de liberté, maître de l’oubli.
L'autre grand front, est constitué par l'art (1.5). Devant toute cette situation
de l'homme européen, comment ont réagi les artistes ? Tzara voit que les
artistes, trop fois, sont des complices du même ordre, tout comme les
intellectuels. À ce sujet, une des pires choses que s'est produit dans l'art
européen, pour notre auteur, est l'apparition du culte à l'art dans la
Renaissance, culte qui a été maintenu depuis lors. Et ceci a facilité la
domination des formes artistiques en accord avec le goût bourgeois (l'art
illusionniste ou représentatif, le sentimentalisme). Certainement l'avant-garde
du siècle XX, observe Tzara, s'est efforcé pour abattre cet art bourgeois.
Cependant, ce qui est certain est que l'avant-garde artistique n'est pas arrivée à
44

détruire la sensibilité ou l'esprit dont naît cet art bourgeois. La preuve en est
que l'avant-garde finit en proposant —ou en imposant, comme école —un
nouveau code formel (comme substitut du bourgeois précédent) au lieu de
promouvoir la créativité individuelle, qui est naturellement multiple, et, pour
cela même, liberatrice.
Finalement, nous considérerons la relation entre Dada et la politique pour
Tzara (1.6), puisque, naturellement, l'approche de Tzara et Dada —qui cherche
une transformation radicale de l'homme —nécessairement s'habille de
caractère politique. Toutefois, il est important de rappeler que la "politique "
Dada ne s'installe pas dans le schéma politique dans le sens classique : Tzara,
à l'époque Dada, exprimera clairement son désaccord avec le communisme et
avec une certaine politisation de l'art, très à la mode à son époque. Alors, qui
consiste la politique Dada ? Ce qui propose Tzara est une transformation
radicale de la sensibilité de l'homme européen, une "dictature de l'esprit ", une
nouvelle façon de situer à l'homme dans "le cosmique ".
45
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
1
/
51
100%