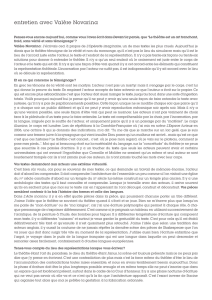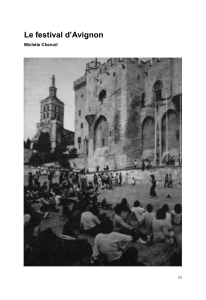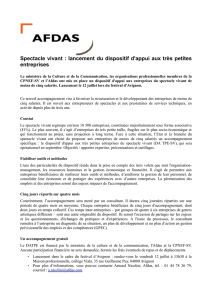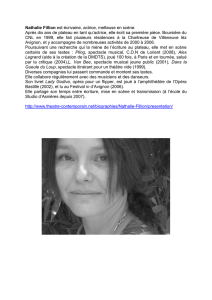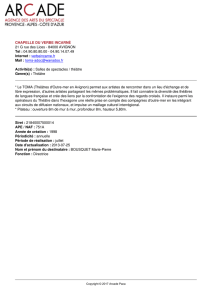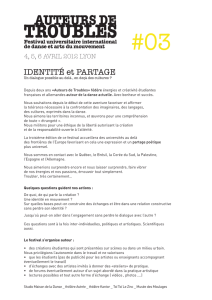dossier de presse - Festival d`Avignon

DOSSIER DE PRESSE
FESTIVAL
D’AVIGNON
67
ÉDITION
du 5 au 26
juillet 2013
e


sommaire
05 Entretien avec Hortense Archambault
et Vincent Baudriller
09 LA FABRICA
Entretien avec Maria Godlewska
11 GROUPE F
OUVERT ! u2pj
13 STANISLAS NORDEY ARTISTE ASSOCIÉ
PAR LES VILLAGES u
19 MICHELLE KOKOSOWSKI ET STANISLAS NORDEY
ÉLOGE DU DÉSORDRE ET DE LA MAÎTRISE
21 ANNE THÉRON
L’ARGENT ucp
24 DIEUDONNÉ NIANGOUNA ARTISTE ASSOCIÉ
SHÉDA u2
30 JEAN-PAUL DELORE
SANS DOUTE u2
33 JÉRÔME BEL
COUR D’HONNEUR u
35 ANNE TERESA DE KEERSMAEKER ET BORIS CHARMATZ
PARTITA 2 SEI SOLO c2
38 DELAVALLET BIDIEFONO
AU-DELÀ c2
41 FAUSTIN LINYEKULA ISTUDIOS KABAKO
DRUMS AND DIGGING cu
44 QUDUS ONIKEKU
QADDISH c2u
47 ARISTIDE TARNAGDA
ET SI JE LES TUAIS TOUS MADAME ? u2
50 MILO RAU/INTERNATIONAL INSTITUTE OF POLITICAL MURDER
HATE RADIO up
53 BRETT BAILEY
EXHIBIT B È02
56 GINTERSDORFER/KLASSEN
LOGOBI 05 ILA FIN DU WESTERN ILA JET SET uc
60 RIMINI PROTOKOLL
LAGOS BUSINESS ANGELS u
REMOTE AVIGNON u
65 PHILIPPE DUCROS
LA PORTE DU NON-RETOUR DÉAMBULATOIRE THÉÂTRAL ET PHOTOGRAPHIQUE uÈ
67 JEAN-FRANÇOIS PEYRET
RE : WALDEN u
70 LUDOVIC LAGARDE
LEAR IS IN TOWN u
73 NICOLAS STEMANN ITHALIA THEATER
FAUST I + II u
77 KATIE MITCHELL I SCHAUSPIEL KÖLN
REISE DURCH DIE NACHT up
80 ANGÉLICA LIDDELL IATRA BILIS TEATRO
PING PANG QIU u
TODO EL CIELO SOBRE LA TIERRA (EL SÍNDROME DE WENDY) u2
83 SILVIA ALBARELLA ET ANNE TISMER
NON-TUTTA 0
87 SOPHIE CALLE
CHAMBRE 20 È0
89 KRZYSZTOF WARLIKOWSKI I NOWY TEATR
KABARET WARSZAWSKI u
92 JULIEN GOSSELIN ISI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON CŒUR
LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES u
95 NICOLAS TRUONG
PROJET LUCIOLE u
98 LAZARE
AU PIED DU MUR SANS PORTE u
101 MICHÈLE ADDALA
LA PARABOLE DES PAPILLONS u2
104 MYRIAM MARZOUKI
LE DÉBUT DE QUELQUE CHOSE u
107 SANDRA ICHÉ
WAGONS LIBRES ucp
110 CHRISTIAN RIZZO
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE c2
112 FALK RICHTER ET ANOUK VAN DIJK IDÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS
RAUSCH uc
116 JAN LAUWERS INEEDCOMPANY
PLACE DU MARCHÉ 76 u2c
119 PHILIPPE QUESNE IVIVARIUM STUDIO
SWAMP CLUB u
122 ANTOINE DEFOORT ET HALORY GOERGER
GERMINAL u
125 JEAN MICHEL BRUYÈRE/LFKS
TROISIÈME VIE DE FRANÇOIS D’ASSISE LE SIMPLE ET L’OUVERT
130 NICOLAS KLOTZ ET ÉLISABETH PERCEVAL
LE VENT SOUFFLE DANS LA COUR D’HONNEUR LES UTOPIES… p
133 DES ARTISTES UN JOUR AU FESTIVAL
GUY CASSIERS, SASHA WALTZ, ALAIN PLATEL, CHRISTOPH MARTHALER,
PETER BROOK, ARTHUR NAUZYCIEL, CLAUDE RÉGY, THOMAS OSTERMEIER,
JAN FABRE, DIEUDONNÉ NIANGOUNA ET STANISLAS NORDEY, BORIS CHARMATZ,
PIPPO DELBONO, ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, PASCAL RAMBERT ET DENIS PODALYDÈS,
JOSEF NADJ, OLIVIER CADIOT, FRÉDÉRIC FISBACH, WAJDI MOUAWAD,
ROMEO CASTELLUCCI ET VALÉRIE DRÉVILLE, PATRICE CHÉREAU
139 LES EXPOSITIONS DE L’ÉCOLE D’ART
KIRIPI KATEMBO SIKU, NYABA LÉON OUEDRAOGO, CLAIRE INGRID COTTANCEAU
140 LE THÉÂTRE DES IDÉES
141 SUJETS À VIF
D’ DE KABAL ET ÉMELINE PUBERT, MAMELA NYAMZA ET FANISWA YISA, AMBRE KAHAN,
DUNCAN EVENNOU ET KARINE PIVETEAU, VINCENT DISSEZ ET PAULINE SIMON,
SÉBASTIEN LE GUEN, JÉRÔME HOFFMANN ET DGIZ, HASSAN RAZAK,
PIERRE CARTONNET ET PIERRE RIGAL, NICOLAS MAURY ET JULIEN RIBOT,
SARAH CHAUMETTE ET MIRABELLE ROUSSEAU
145 ÉCOLES AU FESTIVAL
ÁRPÁD SCHILLING/LA MANUFACTURE, GÉRARD WATKINS/ÉRAC
147 TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES
148 AIX-ARLES-AVIGNON
149 CYCLE DE MUSIQUES SACRÉES
150 FRANCE CULTURE EN PUBLIC
151 RFI EN PUBLIC
152 INFORMATIONS POUR LES SPECTATEURS
154 BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ÉDITION 2013
155 CALENDRIER
157 LES PARTENAIRES DU FESTIVAL D’AVIGNON
u
THÉÂTRE
c
DANSE
p
VIDÉO
0
PERFORMANCE
2
MUSIQUE
È
EXPOSITION
j
PYROTECHNIE

À noter :
Les informations sur les parcours et les rencontres seront réactualisées dans le Guide du spectateur
disponible au Cloître Saint-Louis et sur notre site internet dès début juillet.

Entretien avec
Hortense Archambault et Vincent Baudriller
directeurs du Festival d’Avignon
Dieudonné Niangouna dit : «Un héritage, il faut le faire fructifier, sinon il n’a aucun intérêt.» Avez-vous le sentiment d’avoir
fait fructifier l’héritage que vous avez reçu en devenant, il y a dix ans, directeurs du Festival d’Avignon?
Vincent Baudriller : Le projet que nous avons proposé pour le Festival et qui a été choisi pour que nous le mettions en œuvre
à partir de l’édition 2004 se référait aux fondamentaux esthétiques et politiques que Jean Vilar avait affirmés dès 1947 : réunir
la création et la démocratisation culturelle. C’est ce qu’il réalisera, avec sa troupe et ses spectacles, pendant une vingtaine
d’années. Nous nous sommes surtout inspirés de ce qu’il a fait ensuite au milieu des années 60, après avoir quitté le Théâtre
National Populaire et arrêté son activité de metteur en scène-comédien pour devenir uniquement directeur du Festival,
se mettre entièrement au service des artistes et du public qu’il conviait à Avignon, comme nous l’avons fait à notre tour.
Il effectue, à l’époque, une véritable révolution, en s’intéressant à d’autres formes artistiques que le théâtre, contemporaines
et audacieuses, à des artistes plus jeunes, tout en conservant les fondamentaux sur lesquels il a bâti le Festival. Nous n’avons
donc rien inventé : nous avons simplement voulu éprouver les questionnements de Jean Vilar avec les réponses du XXIesiècle.
Parmi ces interrogations, une nous semblait particulièrement essentielle : la construction d’une salle de répétitions, ouverte
toute l’année à Avignon. S’engager dans ce projet revenait à poursuivre le combat débuté par Jean Vilar et ses successeurs.
Cela nous a pris dix années, mais nous allons enfin inaugurer cette salle, la FabricA, en juillet prochain. L’implantation de ce
bâtiment à l’intersection de deux quartiers populaires, Champfleury et Monclar, concorde avec les principes de démocratisation
culturelle, qui nous animent depuis notre prise de fonction, et avec notre désir d’inscrire résolument le Festival d’Avignon dans
le paysage de la ville.
Le «nous» que vous employez concerne la direction bicéphale du Festival, que vous vivez au quotidien depuis dix années.
Pourquoi ce choix d’être deux?
Hortense Archambault : Nous avons tout de suite voulu placer les projets et les enjeux du Festival sous le signe du dialogue.
D’abord dialogue à deux, entre Vincent et moi, et ensuite dialogue à trois ou quatre, avec l’appel à un ou deux artistes associés
pour irriguer, bousculer chaque année cette institution qu’est le Festival d’Avignon, puis l’élargir progressivement à l’équipe.
Il nous paraissait nécessaire d’aborder chaque nouvelle édition avec de nouveaux angles pour regarder le théâtre, de nouveaux
points de vue. Diriger à deux, c’était aussi l’idée qu’il fallait, pour que notre parole et notre démarche artistique soient crédibles,
que notre manière de faire à l’intérieur du Festival soit cohérente. À l’issue de ces dix ans de codirection, nous sortons renforcés
dans la conviction qui était la nôtre en proposant cette dualité, même s’il n’est pas toujours simple de diriger dans le dialogue.
À deux, nous avons gagné en humanité, nous avons éloigné le dogmatisme. Les décisions et les risques pris ont toujours été
le fruit de nos discussions au cours desquelles nous pouvions partager nos doutes et nos convictions. Enfin, cela nous a permis
d’assumer pleinement cette très grande charge de travail que représente le Festival. Cela étant, nous ne défendons pas un
système modélisable, valable pour tous et partout.
Les fondamentaux dont vous parlez ne sont-ils pas soumis à l’évolution de la société dans laquelle ils sont mis en œuvre?
H.A. : Bien sûr. On constate justement que les grandes ruptures, les grandes évolutions du Festival, sont concomitantes avec
les grands mouvements de notre société. Par exemple, les nouveaux artistes invités au Festival à la fin des années 90, au début
par Bernard Faivre d’Arcier, notre prédécesseur avec qui nous travaillions, puis par nous, les Thomas Ostermeier, Krzysztof
Warlikowski ou Romeo Castellucci, ont inscrit leur démarche dans un monde bouleversé par la chute du mur de Berlin.
Les « messages» qu’ils peuvent délivrer et les formes artistiques qu’ils utilisent sont différents de ce que l’on voyait sur les
scènes européennes auparavant.
Ces nouvelles formes ont-elles amené de nouveaux spectateurs?
H.A. : Absolument, sinon nous n’aurions pas un taux de fréquentation très élevé et un renouvellement des spectateurs.
C’est particulièrement vrai pour les jeunes nés à partir des années 80, qui ont grandi avec internet, et entretiennent un autre
rapport au savoir, à la lecture des textes et des images que leurs aînés. Au théâtre, nous pouvons agir «sur» le temps, mais
nous sommes aussi agis «par» le temps.
V.B. : Cela nous a conduits à changer notre façon de nous adresser au public, pour que la démocratisation ne soit pas seulement
un mot, mais une réalité. De ce point de vue, il y a vraiment trois époques pour le Festival qui accompagnent les transformations
des arts et de la société. La première est l’époque où Jean Vilar est à la fois artiste, metteur en scène, comédien, directeur du
TNP à Paris et directeur du Festival d’Avignon. Elle correspond à la période de la reconstruction de la France, après la Seconde
Guerre mondiale. Jean Vilar travaille alors à faire venir à ses spectacles toutes les catégories socio-professionnelles, et pas
seulement les plus fortunées. Il souhaite rassembler au théâtre et autour de grands textes la société qui sort divisée, déchirée
des années de guerre. Vient ensuite l’époque où Jean Vilar devient, à partir du milieu des années 60, directeur du Festival
d’Avignon à temps plein et qu’il ouvre le Festival à d’autres formes artistiques et aux nouvelles générations d’artistes. Cette
transformation et cette ouverture du Festival en 1966 et 1967 répond à l’aspiration de la jeunesse française au changement,
à plus de liberté, des revendications qui éclateront en 1968. Cette période durera une quarantaine d’années, pendant laquelle
le Festival s’ouvrira au monde, notamment aux cultures extra-européennes. Puis à la fin des années 90, on observe la rupture
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
1
/
176
100%