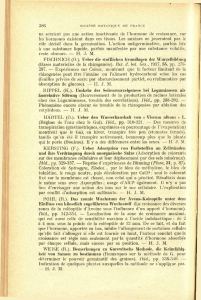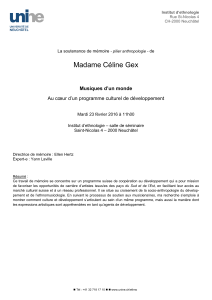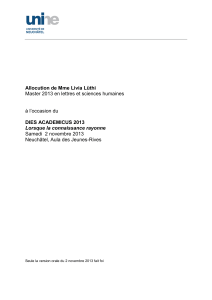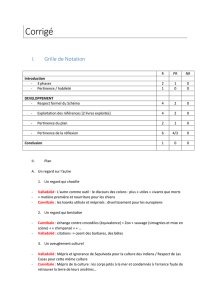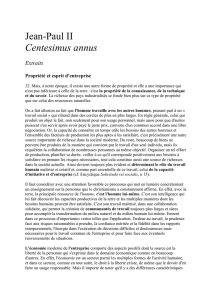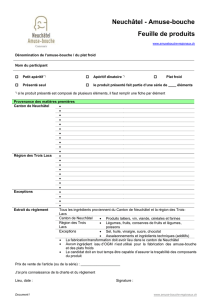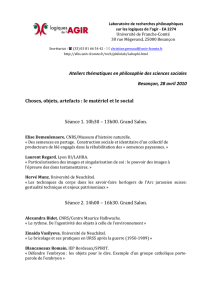Le goût de la croyance

EVISITEUR
de l’exposition Le Musée cannibale, qui s’est tenue, en Suisse, au
Musée d’ethnographie de Neuchâtel, du 9 mars 2002 au 2 mars 2003, entreprend
son parcours par un mur d’objets disparates, entassés de façon chaotique, comme
pour évoquer la dérivequotidienne des accessoires de la modernité. Cet
« Embarras du choix », titre de la section, forme « une masse critique que les socié-
tés humaines gèrent et organisent, en assimilant, négligeant, recyclant ou détrui-
sant, sous peine d’être submergées par elles »1. La métaphore cannibale se précise
davantage dans l’espace suivant, nommé « L’appétit vient en classant » : ici, la
menace que l’embarras du choix se transforme en un chaos indistinct est ironi-
quement déjouée par l’installation de plusieurs récipients/ classeurs évoquant la
compartimentation du savoir, et donc du monde. Des échantillons des divers
règnes, minéral, végétal, animal et… humain, sont stockés. Ce patrimoine
d’exempla donnerait matière, selon les organisateurs, à notre « Goût des autres »
(intitulé de la partie adjacente), illustré par les outils de la collection ethnogra-
phique, à la fois moyens d’une muséographie prédatrice et témoins du « désir d’in-
corporer une altérité d’autant plus valorisée qu’elle semble radicale »2. L’itinéraire
se poursuit à travers la « Chambre froide », vitrine/frigidaire où les protocoles de
l’interprétation et de la conservation visualisent le présent muséographique de
l’objet. On arrive à l’espace dit de la « Boîte noire », la scène, une cuisine où un
objet ethnologique, en train d’êtredécoupé en vue d’un repas, nous est montré
comme ingrédient d’une recette, en vue de sa préparation en tant qu’élément
d’une « juxtaposition, esthétisation, sacralisation, mimétisme, changement
d’échelle, hybridation, relation logique ou association poétique dans un contexte
À PROPOS
L’HOMME
166 / 2003, pp. 171 à 184
Le goût de la croyance
Sur la dénégation nécessaire et son objet fétiche
Gaetano Ciarcia
L
1. Le Musée cannibale, Textes réunis par Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard & Roland Kaehr.
Neuchâtel, Musée d’ethnographie de Neuchâtel, 2002 : 9.
2. Ibid. : 13.
Àpropos de l’exposition Le Musée cannibale. Musée d’ethnoghraphie de Neuchâtel,
Neuchâtel, 9 mars 2002-3 mars 2003.
La grande douleur de la vie humaine, c’est que regarder et
manger soient deux opérations différentes.
Simone Weil, Formes de l’Amour implicite
de Dieu, 1942.

de simple mise en vitrine ou de complexe mise en espace »3.La boîte noire, alors,
nous livrerait les secrets des modalités permettant de concocter divers menus à la
disposition de diverses écoles gastronomiques. Quelques musées importants, ou
leurs démiurges, sont visés à travers des écrans interactifs dont les images sont cen-
sées illustrer l’art(ifice) de la « cuisine ethnomuséale »4: « la juxtaposition à la Jean
Clair » ; « l’association fonctionnelle à la bâloise » ; « l’esthétisation à la Barbier-
Mueller » ; « la sacralisation à la Jacques Kerchache » ; « le mimétisme à la dauphi-
noise » ; « l’association esthétique à la Jean-Hubert Martin » ; « l’association
poétique à la Harald Szeeman ».
Le clou de la visite est une luxueuse salle à manger de taille imposante, où sur
chaque table sont posés des objets symbolisant quelques cas d’anthropophagie
muséale : « les féroces sauvages » ; les indigènes « acculturés » ou « primi-
tifs » ; mais aussi artistes « inconnus » ou « citoyens du monde » sont là en agui-
cheurs d’une clientèle probablement friande de dépaysements gustatif, olfactif
et visuel. Un large choix de menus s’étale : « saveur primitif (à l’autre
féroce) » ; « exotique (à la bon sauvage) » ; « nostalgie (à la paysanne) » ; « saveurs
globales » et… « autocélébration (à la saucisse au choux) », clin d’œil par lequel
les organisateurs de l’exposition mettent sur la table leur cuisine à eux ;au fond
de la salle, un buffet « cuisines du monde » achève la mise en scène du musée
cannibale comme un « ethnoservice »5.Pour digérer, peut-être, la « grande
bouffe »d’altérités qu’on vient d’ingurgiter, la section latérale, dans l’ombre et
le silence (contrastant avec l’éclairage et le bruit de fond de conversations convi-
viales de la salle à manger voisine), est meublée de choses peu rassurantes, objets
clochards et sans pedigree, dépourvus de tout exotisme domestique : un réver-
bère, une voiture brûlée, deux chevalets sur lesquels sont présentés la une de
journaux, allusion à l’humanité « lointaine » des banlieues et aussi à la dérive
sécuritaireclaironnée dans les médias. Enquittant cet espace de réflexion, le
visiteur, à travers une meurtrière, peut lancer un dernier regardvers ce monde
enfoui et quotidien et s’apercevoir que cet étrange dispositif visuel lui permet de
voir les autres convives en train d’observer cette « Chambre double » (celle de la
digestion, mais aussi, selon les sensibilités, celle du recul ou du refoulement)
comme s’ils étaient sous verre eux aussi, c’est-à-dire créatures d’une vitrine/cage
prêts à êtreexposés et, donc, mangés.
Après la transition par cet au-delà de la consommation et de la distanciation,
le voyage arrive à son terme devant une autre table, mythique et spirituelle à la
fois, celle de La Cène – le thème de cette dernière installation étant appelé
« Cannibale toi-même ». Sur les murs, autour de ce repas – fondateur, en
quelque sorte, de notretradition – sont accrochées les figures d’autres canniba-
lismes ; sous forme de panneaux de morceaux de verre découpés et colorés évo-
quant les vitraux d’une église, on peut voir reproduites la toile de Rubens
172
Gaetano Ciarcia
3. Ibid. : 16.
4. Ibid. : 33.
5. Définition de Myriam Stucki, étudiante en licence d’ethnologie à l’Université de Neuchâtel, avec qui
j’ai échangé quelques impressions au cours de la visite.

Saturne dévorant un de ses fils ;les affiches des films Tales from the Cannibal Side,
Delicatessen, Hannibal ;une illustration du Petit Poucet de Perrault ; la figure
Corps entier tenant sa peau, de Gunther von Hagens ; les performances Le Corps
du silence, de Tania Bruguera et Eating People, de Sun Yan ou encore diverses
représentations du sacrifice d’Abraham, Mahâvajrabhairava personnage du pan-
théon tantrique, la déesse Kali et le tableau d’Henri Bellechasse illustrant le
Retable de Saint-Denis. Comme un tableau synoptique, dans « la chambre
double », les effets de circulation du regard traversent le musée d’ethnographie
et confluent vers le lieu toujours imaginaire occupé par les autres où une ques-
tion se pose : « qui est finalement le cannibale de qui ? »6et où une réponse
semble se profiler : « … s’il faut que les cultures se mangent entre elles pour que
les musées existent, ceux-ci peuvent en retour désigner ce moment d’ingestion
cérémonielle pour en faire enfin une forme pensée et assumée, et non un simple
allant de soi justifiant a posteriori une histoire controversée »7.
La dénégation nécessaire
Selon Freud, « Un contenu refoulé de représentation ou de pensée peut per-
cer jusqu’à la conscience, à condition qu’il se laisse dénier. La dénégation est une
façon de prendreconscience du refoulé, elle est, à proprement parler, déjà une
levée du refoulement, mais, certes, pas une acceptation du refoulé »8.Cette
acceptation étant un acte fondateur d’une croyance, l’objet refoulé peut (doit)
être invoqué, sous forme de fétiche, pour conjurer le danger qui serait constitué
par la reconnaissance de la fiction. Si on reste au plus près du principe freudien,
le fétiche nie, accepte et conserve une disparition ; objet ethnographique et/ou
métaphore catégorielle, le fétiche est la dénégation, parce qu’il est précisément
voué à préserver une croyance illusoire de sa désagrégation9.D’ailleurs, ses ver-
tus conservatrices paraissent êtreàl’œuvreaussi dans le traitement muséogra-
phique des objets « ethnologiques ». Leur exhibition, en tant que fragments
d’une culturedonnée, procède d’une invention/découverte créatrice : la fonc-
tion authentifiante du chercheur/collectionneur sur ses objets est masquée par
la destination et l’usage originels ou primitifs fondant la valeur de la pièce.
En traitant des mutations affectant les jugements en matière d’art, Gérard
Genette parle d’idolâtrie et cite la critique de Proust à Ruskin :
« Les doctrines qu’il professait étaient des doctrines morales et non des doctrines esthé-
tiques, et pourtant il les choisissait pour leur beauté. Etcomme il ne voulait pas les pré-
senter comme belles, mais comme vraies, il était obligé de se mentir à lui-même sur la
nature des raisons qui les lui faisaient adopter. »10
À PROPOS
173
Le goût de la croyance
6. Le Musée cannibale…, op. cit. : 45.
7. Ibid.
8. Sigmund Freud, La Dénégation, Paris, Le Coq-Héron, 1982 [1925] : 13.
9. Sigmund Freud, « Fétichisme » [1927], in Œuvres complètes, Paris, PUF, 1994 : 125-131.
10. Marcel Proust, « Préface » à Ruskin 1885, in Contre Sainte-Beuve, cité in Gérard Genette, La Relation
esthétique, Paris, Le Seuil, 1997 : note 39.

La chose dès qu’elle devient œuvre d’art primitif peut être possédée par le « je sais
bien… mais quand même » du collectionneur-exposant croyant à la révélation de
la beauté et de la force des objets ; à ce titre, quelques amateurs parlent de mana.
Un canon esthésique, déniant un parti pris moral, exprimerait, donc, l’aspiration à
découvrir et à vivre un état d’entéléchie : le génie autochtone fonderait la pureté de
la chose et agirait comme une sorte de principe énergétique nécessaire à la quête
d’une plénitude sensorielle de la part du connaisseur. Mais – c’est ici qu’on peut en
apercevoir la dimension doctrinale –, alors que l’appréciation de l’élite des experts
revendique implicitement son goût comme sensus créateur qui donne un sens à la
révélation d’une vérité esthétique universelle, la source culturelle de cette percep-
tion doit demeurer primitive, contextuelle ou, si l’on veut, ethnique. Par consé-
quent, elle serait offusquée par toute forme de reconnaissance des interventions
extérieures, ou plutôt hors contexte, inhérentes aux transformations successives du
statut de l’objet. La menace de la fin du mana dévoilerait l’existence d’un
négoce autour des arts ethnographiques ou naïfs11 ; pour escamoter cette « dérive »,
la fétichisation esthétique d’une prétendue originalité auratique, évente « démocra-
tiquement »,en la rendant floue, l’image trop réaliste d’un marché lié à l’avènement
moderne de l’artprimitif.Ce processus paradoxal, consistant à fabriquer une aura,
ne saurait évidemment pas se confondre avec cette « singulière trame d’espace et de
temps […] unique apparition d’un lointain, si proche soit-il »12,dont parle Walter
Benjamin. En tant que seule construction autorisée d’une authenticité garantie
arrêtant le devenir de son usage, la prétendue aura contemporaine de l’objet eth-
nologique se met en scène comme sa propre extinction. La durée matérielle, sa
transmissibilité vivante sont évacuées et avec elles l’origine de la pièce disparaît,
l’apparition est effacée par l’actualisation de son spectacle. Ence sens, la reproduc-
tion destructrice ne se limite pas à la recréation technique des copies, mais elle s’em-
pareaussi de la multiplication des occurrences où un même objet est exposé. Cette
prolifération suscite des opérations qui semblent s’apparenter à des tentatives de
« standardiser l’unique »13.Dans la dernière version de son essai sur la reproducti-
bilité de l’œuvre d’art, Benjamin voit dans la « sécularisation » de la valeur cultuelle
des images la diffusion de la quête de l’authenticité, l’unicité de la pièce serait rem-
placée par « l’unicité empirique du créateur ou de son activité créatrice »14.Cette
substitution intégrerait la recherche d’une « garantie d’origine » à de nouvelles
formes de cultualisation de l’objet dont « l’exemple plus significatif étant ici celui
du collectionneur qui ressemble toujours un peu à un adorateur de fétiches et qui,
par la possession même de l’œuvre d’art, participe à son pouvoir cultuel »15.
174
Gaetano Ciarcia
11. Sur ce sujet, voir Carlo Avierl Celius, L’Avènement de l’artnaïf en Haïti. Discours institué et nouvelle
approche, Paris, École des hautes études en sciences sociales, thèse de doctorat, 2001.
12. Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » (1reversion, 1935), in
Walter Benjamin, Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000 : 75 sq.
13. Ibid. : 76 sq.
14. Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » (dernière version, 1939),
in Walter Benjamin, Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000 : note 2, 280 sq.
15. Ibid.

Si le paradigme de l’authenticité ordonne les pratiques de montage auratique,
les actions discursives et scéniques qui le supportent déclinent l’immobilité
muséale de l’objet en le stabilisant comme forme esthétique. En même temps,
la collection comme théâtre d’un exotisme primordial ne peut être mise en scène
(et en mouvement) qu’à travers la dénégation de son devenir économique, c’est-
à-dire de la valeur matérielle et du prestige symbolique que respectivement ses
pièces détiennent et confèrent. L’investiture esthétique nécessiterait donc un
excès de transparence, la visualisation d’une pureté artistique originaire, dont le
contrepoint serait l’opacification du processus authentifiant.
Suivant le magistral essai de Claude Lévi-Strauss sur la trajectoire de Quesalid qui
« n’est pas devenu un grand sorcier parce qu’il guérissait ses malades, il guérissait ses
malades parce qu’il est devenu grand sorcier »16,nous pouvons nous demander si la
dénégation est une forme de confession qui permet d’avouer sans expier la peine, en
inscrivant la faute –àsavoir, l’inauthenticité structurale à toute fabrication d’au-
thentique et à l’invention de l’Autre comme proie du Soi – dans le champ de gravi-
tation d’une vérité. Cette vérité, ou plutôt autorité, semble devoir se construire
autour de deux axes : la répudiation de l’expérience et l’exigence que « l’“illusion”
soit parfaite »17, c’est-à-direcrédible pour le fétichiste lui-même (ou, si l’on veut,
pour l’apprenti sorcier lévi-straussien18). En ce sens, « le mais quand même » c’est le
fétiche »19.Comme Octave Mannoni l’ajoute, ce régime de croyance, avant d’être
alimenté par la perfection de l’illusion nécessaire à la transformation magique de l’ob-
jet en fétiche, n’est possible que grâce au je sais bien ;en effet, c’est le je sais bien qui
produit la conversion de la négation en vérité où « la place du crédule, celle de
l’autre, est maintenant occupée par le fétiche lui-même »20.
Unexemple littérairede dénégation, habitée par un refoulement d’ordre
anthropologique se trouve dans la nouvelle de Herman Melville, Benito
Cereno 21.C’est l’histoiredu capitaine Amasa Delano qui ne voit pas que sur le
San Dominick, le bateau négrier en détresse, commandé par Benito Cereno, à
qui il porte secours, les Blancs sont les otages des Noirs. Il perçoit la menaçante
étrangeté rôdant sur le navire, mais les codes pour interpréter cet altérité opaque
lui échappent. L’intrus, se voulant être le sauveur, est en réalité le dupe que
Benito Cereno, l’autre capitaine, tente désespérément de sauver. Pourtant,
Delano essaie de maîtriser les signes à la fois familiers et incongrus au travers
d’hypothèses domestiques – par moment, il imagine Cereno en ennemi, chef
d’un équipage de pirates –, qui peuvent s’avérer être aussi bien des illusions
À PROPOS
175
Le goût de la croyance
16. Claude Lévi-Strauss, « Le sorcier et sa magie », in Anthropologie structurale, Paris, Plon 1958 : 198 sq.
[1republication in Les Temps modernes, 1949, 41 :3-24].
17. Octave Mannoni, « Je sais bien mais quand même… », in Clefs pour l’imaginaire, Paris, Éditions du
Seuil, 1969 : 10 sq.
18. Avec, quand même, une différence, soulignée par Octave Mannoni (ibid. :24) : Quesalid, au
contraire du fétichiste, est rendu dupe par son propre jeu, mais « retrouve sa naïveté, il ne se confirme
pas dans sa foi ».
19. Ibid. : 12 sq.
20. Ibid. : 32 sq.
21. Herman Melville, Benito Cereno [1855],Paris, Flammarion, 1991. Je dois à Jean Jamin l’idée de lire
le texte de Melville à la lumière de cette piste de réflexion.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%