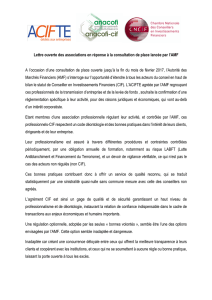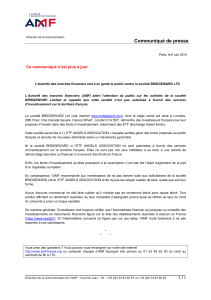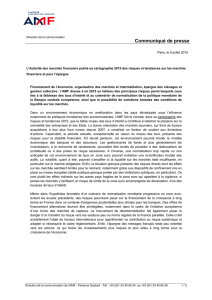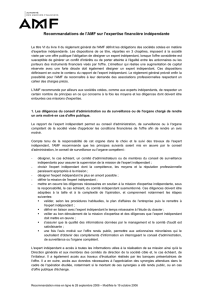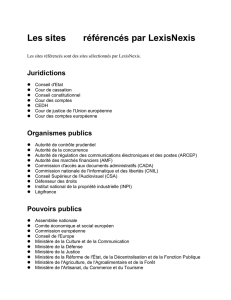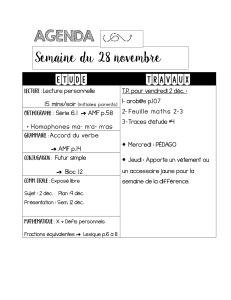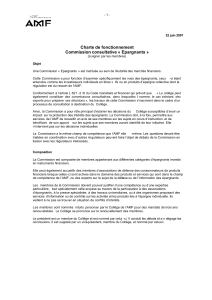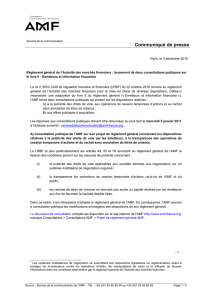l`article complet en PDF

RAPPORT 2006 DE L’AMF SUR LE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET LE
CONTROLE INTERNE
Le 22 janvier 2007
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse 75082 Paris cedex 02
Tél. : 01 53 45 60 00 – Fax : 01 53 45 61 00

2
SOMMAIRE
INTRODUCTION........................................................................................................................................................................2
1 LA METHODOLOGIE ET LES CONSTATS STATISTIQUES GENERAUX ........................................................4
1.1 La méthodologie de travail....................................................................................................................................4
1.2 Le mode d'analyse.................................................................................................................................................4
1.3 L'inclusion des rapports dans les documents de référence............................................................................4
1.4 Le respect des règles de publication...................................................................................................................5
2 LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE FRANÇAIS...............................................................................5
2.1 Le cadre législatif....................................................................................................................................................5
2.2 Le cadre réglementaire..........................................................................................................................................6
2.3 Les recommandations de l'AMF pour l'élaboration du document de référence...........................................6
2.4 Le nouveau cadre de référence du contrôle interne des sociétés cotées.....................................................7
2.4.1 Historique.......................................................................................................................................................7
2.4.2 Dispositif prévu par le cadre de référence...............................................................................................8
2.4.3 Définition et objectifs....................................................................................................................................8
2.4.4 Périmètre du contrôle interne.....................................................................................................................8
2.4.5 Composantes du dispositif de contrôle interne.......................................................................................9
2.4.6 Recommandation de l'AMF.........................................................................................................................9
3 L'EVOLUTION DU CONTEXTE INTERNATIONAL ...............................................................................................10
3.1 Les textes communautaires................................................................................................................................10
3.1.1 Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006....................................................................................................10
3.1.2 Directive 2006/46/CE du 14 juin 2006....................................................................................................11
3.2 Les positions de la Commission Européenne.................................................................................................11
3.3 Les autres dispositifs internationaux.................................................................................................................11
3.3.1 Plan d’action de l'OICV (Organisation Internationale des Commissions de valeurs)......................11
3.3.2 Application de la loi Sarbanes-Oxley aux sociétés cotées aux Etats-Unis.......................................11
4 LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE.....................................................................................................................13
4.1 Les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de
surveillance............................................................................................................................................................13
4.1.1 Organisation et fonctionnement du conseil............................................................................................13
4.1.2 Organisation et fonctionnement des comités spécialisés....................................................................15
4.1.3 Evaluation des travaux du conseil...........................................................................................................17
4.2 Les limitations apportées par le conseil d’administration aux pouvoirs du directeur général..................18
4.3 Les rémunérations des dirigeants.....................................................................................................................18
4.3.1 Rémunérations des membres du conseil...............................................................................................18
4.3.2 Rémunérations des mandataires sociaux..............................................................................................18
5 LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE....................................................................................................21
5.1 La description des procédures de contrôle interne.........................................................................................21
5.1.1 Définition et objectifs du contrôle interne...............................................................................................21
5.1.2 Périmètre couvert par les rapports du Président...................................................................................22
5.1.3 Référentiel utilisé........................................................................................................................................22
5.1.4 Recensement et gestion des risques......................................................................................................23
5.1.5 Précisions sur les procédures de contrôle interne................................................................................24
5.1.6 Moyens affectés au contrôle interne.......................................................................................................24
5.2 Les diligences mises en œuvre et l’appréciation du dispositif de contrôle interne....................................25
5.2.1 Diligences ayant sous-tendu la préparation du rapport.......................................................................25
5.2.2 Appréciation du dispositif de contrôle interne........................................................................................25
5.2.3 Sociétés soumises à la loi Sarbanes-Oxley...........................................................................................26
5.2.4 Rapports des commissaires aux comptes .............................................................................................26
CONCLUSION..........................................................................................................................................................................27

3
INTRODUCTION
Le présent rapport est établi en application de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, issu de la loi de
sécurité financière du 1er août 2003, qui charge l’Autorité des marchés financiers (AMF) d'établir chaque année
un rapport sur la base des informations publiées par les personnes morales faisant appel public à l’épargne, en
matière de gouvernement d’entreprise et de contrôle interne.
La première partie du rapport est consacrée au contexte législatif et réglementaire français ainsi qu'aux évolutions
internationales en matière de contrôle interne et de gouvernement d'entreprise. Les parties suivantes du rapport
se concentrent sur les constats effectués par l'AMF lors de son analyse des rapports produits par les sociétés en
matière de gouvernement d'entreprise et de contrôle interne au titre de l'exercice 2005.

4
1 LA METHODOLOGIE ET LES CONSTATS STATISTIQUES GENERAUX
1.1 La méthodologie de travail
L'objectif du rapport est d'apprécier la pertinence des informations publiées par les émetteurs faisant appel public
à l'épargne en matière de gouvernement d'entreprise et de contrôle interne. Il a été établi sur la base d’une
analyse documentaire et d’une série d’entretiens informels.
L'échantillon retenu comporte 109 sociétés dont 52% sont cotées sur l'Eurolist A (dont 16 sociétés également
cotées aux Etats-Unis), 13% sur l'Eurolist B (dont une cotée aux Etats-Unis), 29% sur l'Eurolist C, 3% sur
Alternext et 4% sont des émetteurs purement obligataires. L'échantillon compte 38 sociétés appartenant au CAC
40 au 31 décembre 2005.
1.2 Le mode d'analyse
Une grille reprenant les principaux aspects traités par les recommandations de place sur le gouvernement
d’entreprise et le contrôle interne a été élaborée pour servir de base à l’analyse statistique sur pièces, du contenu
des rapports des sociétés comprises dans l’échantillon.
1.3 L'inclusion des rapports dans les documents de référence
Sur les 109 sociétés de l'échantillon, 93% ont publié un document de référence. L'article 221-8 du règlement
général de l'AMF (ci-après « RGAMF ») prévoit que "lorsque qu'un émetteur établit un document de référence
(…), ce document comprend les rapports et les informations mentionnés à l’article 221-6 (…)". La
recommandation1 publiée par l'AMF en mars 2004 précise que "ces informations pourraient figurer dans un
chapitre spécifique consacré au gouvernement d'entreprise et au contrôle interne, étant précisé que l'émetteur
pourra, pour certaines des informations, procéder par renvoi aux informations présentées par ailleurs dans le
document (notamment les facteurs de risque)".
Si la société n'établit pas de document de référence, le rapport du Président fait l'objet d'une publication séparée
selon les modalités de diffusion prévues à l'article 221-7 du RGAMF. De même, les émetteurs qui ne relèvent pas
des dispositions du code de commerce mais de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier publient des
informations équivalentes au rapport du Président dans les conditions fixées par l'article 221-6 du RGAMF.
Pour les sociétés figurant dans l'échantillon et établissant un document de référence, le rapport du Président
figure soit dans le corps du document de référence et est généralement rattaché au chapitre relatif au
gouvernement d'entreprise, soit, plus rarement, à la fin du document de référence ou en annexe. Certains
rapports font des renvois à des chapitres du document de référence. Pour ce qui relève des conditions de
préparation et d'organisation des travaux du conseil, le rapport du Président fait généralement référence au
chapitre "Composition et fonctionnement des organes d'administration2", lorsqu’il y a renvoi. Pour ce qui concerne
1 "Gouvernement d'entreprise et contrôle interne : obligations de publication des émetteurs faisant appel public à l'épargne",
Revue mensuelle de l’AMF, mars 2004, pages 39 à 41.
2 Et notamment aux parties reprenant les exigences des paragraphes 14 à 16 portant respectivement sur les organes
d’administration, de direction et de surveillance et direction générale (14), les rémunérations et les avantages (15), le
fonctionnement des organes d’administration et de direction (16) de l'annexe I du Règlement européen n°809/2004 mettant en
œuvre la directive 2003/71 en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus,
l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère
promotionnel.

5
la partie relative au contrôle interne, les renvois, quand ils existent, sont généralement orientés vers le chapitre
"Facteurs de risques".
Si la recommandation de l'AMF de mars 2004 avait pour objet de donner une plus grande flexibilité aux
sociétés qui produisent un document de référence, il est rappelé que le contenu du rapport du Président
doit être dans tous les cas clairement identifiable dans le document de référence.
1.4 Le respect des règles de publication
Au 1er décembre 2006, 150 sociétés cotées sur un total de 807 n'étaient pas à jour de leurs publications
concernant leurs obligations d'informations relatives au gouvernement d'entreprise et au contrôle interne. Ces
sociétés se répartissent de la manière suivante : 2 sociétés appartiennent au compartiment A d'Eurolist, 11
appartiennent au compartiment B, 57 appartiennent au compartiment C, 62 appartiennent au compartiment
"valeurs étrangères", 7 appartiennent à Alternext, 3 appartiennent au compartiment spécial et 8 au compartiment
obligataire.
Dans le cadre de la transposition de la directive Transparence, le rapport gouvernement d'entreprise et
contrôle interne ne fera plus l'objet d'une diffusion sous forme électronique sur le site de l'AMF. Il sera
simplement déposé auprès de l'AMF. En revanche les sociétés devront mettre le rapport en ligne sur leur
site internet, au même titre que l’ensemble de l’information réglementée.
2 LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE FRANÇAIS
2.1 Le cadre législatif
Aux termes de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, les personnes morales faisant appel public à
l'épargne sont tenues de rendre publiques les informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa
des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, dans les conditions prévues par le règlement général
de l’AMF.
Conformément au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, le président du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance de toute société anonyme rend compte à l’assemblée
générale annuelle des actionnaires, dans un rapport joint au rapport de gestion, des « conditions de préparation
et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la
société ». Le rapport indique en outre les « éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte aux
pouvoirs du directeur général ».
Par ailleurs, en application de l’article L. 225-235 du code de commerce, les commissaires aux comptes
présentent dans un rapport leurs observations sur le rapport du président pour celles des procédures de contrôle
interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Concernant plus spécifiquement la rémunération des dirigeants, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 225-
102-1 du code de commerce, le rapport de gestion doit contenir, de façon individuelle et nominative, le montant
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%