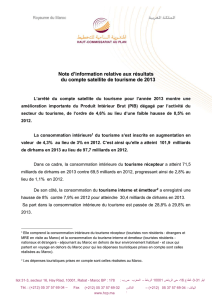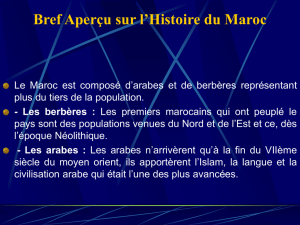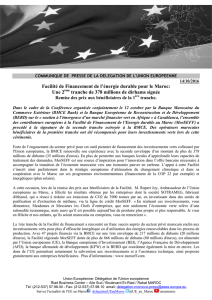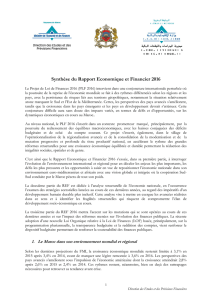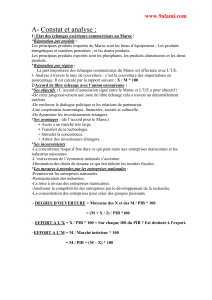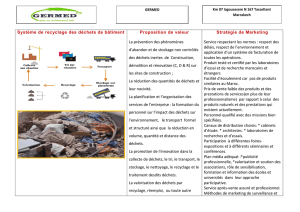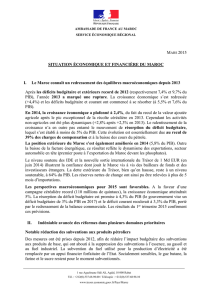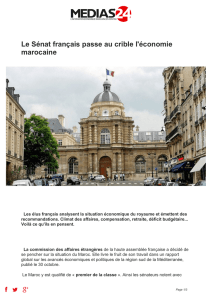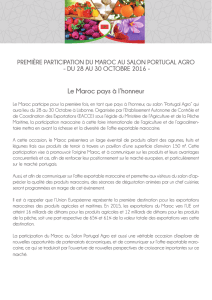Liste des graphiques



i
Table des matières
Introduction générale ................................................................................................................................ 1
PARTIE I. LE MAROC DANS SON ENVIRONNEMENT MONDIAL ET
REGIONAL ................................................................................................................................ 3
1.Ralentissement de la croissance mondiale, avec une multiplication des menaces ...................... 5
1.1.Croissance différenciée selon les pôles de l’économie mondiale ........................................ 5
1.1.1.Zone euro : détérioration des perspectives économiques, sur fond d’aggravation de la
crise de la dette souveraine ................................................................................................................... 6
1.1.2.Etats-Unis : perspectives de redressement graduel de l’activité économique .............................. 7
1.1.3.Japon : reprise de l’activité après le séisme et le tsunami ................................................................ 7
1.1.4.Pays émergents : croissance ralentie mais encore solide, tirée par la demande intérieure ......... 8
1.2.Commerce mondial : ralentissement en 2011, après une croissance record en 2010 ........... 9
1.2.1.Croissance record du commerce mondial en 2010 .......................................................................... 9
1.2.2.Ralentissement de la croissance du commerce mondial en 2011 et 2012 ................................. 10
1.3.Modération des cours des matières premières, après une forte volatilité durant les
dernières années ................................................................................................................. 11
1.4.Principaux risques pour l’économie mondiale et canaux de transmission ....................... 13
1.4.1.Aggravation de la crise de la dette souveraine de la zone euro ................................................... 13
1.4.2.Risques liés à un resserrement budgétaire excessif aux Etats-Unis ............................................ 14
1.4.3.Risque de ralentissement plus rapide dans certains pays émergents .......................................... 15
1.4.4.Volatilité des taux de change et son impact sur les flux de capitaux .......................................... 17
1.5.Rôle du G20 comme principale instance de gouvernance économique mondiale ........... 18
2.Mutations dans la région MENA : surmonter les défis actuels pour mieux saisir les
opportunités d’avenir .................................................................................................................. 19
2.1.Défis actuels et opportunités d’avenir ............................................................................... 19
2.1.1.Ralentissement de la croissance, plus marqué dans les pays importateurs de pétrole de la
région .................................................................................................................................................... 19
2.1.2.Les pays de la région MENA sont menacés par plusieurs incertitudes et défis qui
constituent des risques baissiers pour la croissance à court terme. ............................................ 20
2.1.3.De nouvelles opportunités pour un avenir plus prometteur ....................................................... 21
2.2.Implications pour l’économie marocaine .......................................................................... 22
3.Intégration du Maroc à l’économie mondiale : vers une plus grande diversification des
échanges ..................................................................................................................................... 22
3.1.Renforcement des relations Maroc-Union européenne .................................................... 22
3.1.1.Evolution des échanges bilatéraux Maroc-UE............................................................................... 22
3.1.2.Progrès dans la mise en œuvre du plan d’action Maroc-UE et dans la concrétisation du
Statut avancé ........................................................................................................................................ 23
3.1.3.Accompagnement financier de l’UE ............................................................................................... 24
3.1.4.Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation ....................................................... 24
3.2.Union pour la Méditerranée : Progrès, contraintes et perspectives .................................. 25
3.3.Progrès dans la mise en œuvre des autres accords de libre échange ................................ 26
3.3.1.Rebond des exportations vers la Turquie ....................................................................................... 26
3.3.2.Réorientation positive des échanges avec les pays de l’Accord d’Agadir .................................. 27
3.3.3.Forte progression des échanges avec les EAU .............................................................................. 28
3.3.4.Reprise des échanges avec les Etats-Unis ....................................................................................... 29
3.4.L'Afrique subsaharienne : un important potentiel d’échanges à exploiter ....................... 30
4.Positionnement de l’économie marocaine en termes de compétitivité et d’attractivité ............ 31

ii
4.1.Reprise de l’attractivité des investissements directs étrangers au niveau mondial et
au Maroc ............................................................................................................................ 31
4.1.1.Evolution contrastée des IDE entre les différentes régions du monde..................................... 31
4.1.2.Tendances différenciées entre les secteurs et les composantes des IDE .................................. 32
4.1.3.Reprise des investissements directs étrangers au Maroc .............................................................. 33
4.1.4.Perspectives des IDE au niveau mondial et au Maroc : reprise faible et fragile ....................... 34
4.2.Positionnement mondial du Maroc selon certains rapports internationaux ..................... 34
PARTIE II. CONSOLIDATION DU MODELE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC ............................................................................36
1.Caractéristiques structurelles de la croissance économique nationale ...................................... 38
1.1.Diversification de la base productive et résilience de l’économie marocaine ................... 38
1.2.Rôle moteur des éléments de la demande ......................................................................... 40
1.3.Contribution des régions à la création de la richesse nationale ........................................ 42
1.3.1.Concentration du PIB régional et dynamique plus affirmée de nouvelles régions .................. 42
1.3.2.Régions de plus en plus spécialisées constituant de nouveaux relais de croissance ................. 44
1.4.Emergence de dynamiques sectorielles régionales porteuses de vocations et de
spécialisations locales ....................................................................................................... 44
1.4.1.Concentration sectorielle importante, notamment, pour les industries exportatrices ............. 44
1.4.2.Concentration et spécialisation régionale relativement importante, notamment, pour
Tanger-Tétouan .................................................................................................................................. 45
1.4.3.Surreprésentation de plusieurs secteurs au niveau régional, notamment, ceux intensifs en
main d’œuvre ....................................................................................................................................... 46
1.5.Secteur financier en appui à la croissance ........................................................................ 47
1.5.1.Insuffisance de l’épargne nationale face aux besoins de financement de l’économie ............. 47
1.5.2.Appui de la politique monétaire à l’amélioration des conditions de financement de
l’économie ............................................................................................................................................ 48
1.5.3.Hausse soutenue des crédits à l’économie ...................................................................................... 49
1.5.4.Des crédits bénéficiant essentiellement aux sociétés non financières ........................................ 49
1.5.5.hausse des dépôts en 2011 ................................................................................................................ 50
1.5.6.Une gestion rigoureuse du risque favorisant un financement bancaire sain de l’économie ... 50
1.5.7.Dynamique soutenue des prêts à moyen et long termes .............................................................. 50
1.5.8.Bourse de Casablanca et appel public à l’épargne : forte prépondérance des levées de
fonds effectuées par les banques et le secteur de l’immobilier .................................................... 51
1.5.9.Capital investissement : un mode de financement profitant essentiellement aux
entreprises en expansion .................................................................................................................... 51
2.Consolidation des indicateurs de développement humain ........................................................ 53
2.1.Amélioration du niveau de vie des ménages et recul de la pauvreté ................................. 53
2.2.Résultats encourageants au niveau de la scolarisation et l’alphabétisation ..................... 55
2.3.Elargissement de l’accès aux soins et amélioration des indicateurs sanitaires ................ 56
2.4.L’emploi au Maroc : persistance des dysfonctionnements ............................................... 56
2.4.1.Croissance et emploi .......................................................................................................................... 57
2.4.2.Caractéristiques du chômage au Maroc ........................................................................................... 58
3.Renforcement de la gouvernance : Un impératif pour la viabilité du modèle de
développement marocain ........................................................................................................ .... 60
3.1.La nouvelle Constitution marocaine : un modèle de gouvernance politique et socio-
économique ....................................................................................................................... 62
3.2.La refonte de la Loi Organique relative à la Loi de Finances ........................................... 65
3.3.Evaluation des réformes liées à l’environnement des affaires : avancées réalisées et
efforts à déployer pour améliorer le climat des affaires au Maroc .................................... 65

iii
PARTIE III. POLITIQUES ECONOMIQUE, FINANCIERE ET SOCIALE .....................68
1.Stratégies orientées vers le renforcement des moteurs à l’export ............................................... 70
1.1.Renforcement de la structuration du secteur des pêches par la nouvelle stratégie .......... 70
1.1.1.Un potentiel de développement élevé nécessitant une exploitation optimisée ........................ 70
1.1.2.Avancées significatives dans la mise en œuvre du Plan Halieutis ............................................... 70
1.2.Pacte pour l’Emergence Industrielle : des avancées encourageantes mais persistance
de fragilités structurelles ................................................................................................... 71
1.2.1.Repositionnement stratégique du secteur textile-habillement : les avancées et les gaps à
rattraper ................................................................................................................................................ 73
1.2.2.Dynamique prometteuse de l’industrie automobile marocaine ................................................... 75
1.2.3.Repositionnement du secteur aéronautique sur la carte mondiale des principaux
donneurs d’ordre ................................................................................................................................. 76
1.2.4.Essor remarquable du secteur de l’électronique et des potentialités à explorer ....................... 77
1.2.5.Offshoring : Consolidation des acquis et ouverture sur de nouveaux potentiels de
croissance ............................................................................................................................................. 78
1.3.Poursuite de la dynamique des phosphates et dérivés et consolidation du leadership
de l’OCP sur le marché mondial ....................................................................................... 80
1.3.1.Perspectives prometteuses du marché mondial et meilleur positionnement du Groupe
OCP ...................................................................................................................................................... 80
1.3.2.Positionnement stratégique du Groupe OCP ................................................................................ 81
1.4.Tourisme : réajustement de la «Vision 2020» à la lumière des nouvelles contraintes
imposées par le contexte international, régional et national ............................................. 81
1.4.1.Tendances et perspectives du tourisme national ........................................................................... 82
1.4.2.Mise en œuvre intelligente de la vision 2020 compte tenu du nouveau contexte national,
régional et international ..................................................................................................................... 82
2.Consolidation de la contribution des secteurs orientés au marche intérieur ............................. 84
2.1.Accélération de la mise en œuvre de la stratégie agricole ................................................. 84
2.1.1.Mutation structurelle du contexte mondial et national de l’agriculture marocaine : défis et
opportunités ........................................................................................................................................ 84
2.1.2.Réalisations prometteuses de la mise en œuvre du Plan Maroc Vert ......................................... 85
2.2.Secteur de l’immobilier entre la dynamique de relance et la persistance des enjeux ....... 88
2.2.1.Bilan mitigé du secteur jusqu’à fin 2010.......................................................................................... 88
2.2.2.Relance du secteur de l’immobilier par le segment social confirmée par des résultats
probants en 2011 ................................................................................................................................ 88
2.2.3.Perspectives de développement du secteur .................................................................................... 89
2.3.Commerce intérieur : Quel apport du Plan Rawaj ? ......................................................... 89
3.Modernisation compétitive des réseaux d’infrastructure ........................................................... 90
3.1.La stratégie logistique : Bilan d’étape ............................................................................... 90
3.1.1.Engagement ferme à promouvoir la stratégie logistique… ......................................................... 90
3.1.2.… avec une intégration des solutions logistiques comme objectif ultime des principaux
acteurs ................................................................................................................................................... 91
3.1.3.…mais, manque de visibilité sur le calendrier de la stratégie. ...................................................... 91
3.2.La nouvelle stratégie énergétique : Avancées et défis à relever ........................................ 91
3.2.1.Avancées significatives de la nouvelle stratégie énergétique ........................................................ 92
3.2.2.Enjeux et défis de la nouvelle stratégie ........................................................................................... 93
3.3.Renforcement de la rationalisation de l’usage de la ressource hydrique .......................... 94
3.3.1.Perspectives alarmantes en termes de disponibilités hydriques dans le pourtour
méditerranéen et notamment au Maroc .......................................................................................... 94
3.3.2.Dynamisation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’eau pour le rééquilibrage
de la gestion offre/demande de l’eau .............................................................................................. 95
3.4.Consolidation de la dynamique du secteur des télécommunications au Maroc après
une décennie de libéralisation ........................................................................................... 96
3.4.1.Tendances mondiales du secteur des télécommunications .......................................................... 96
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
1
/
196
100%