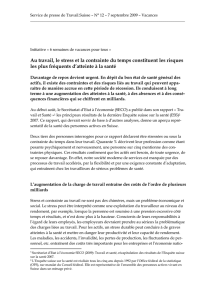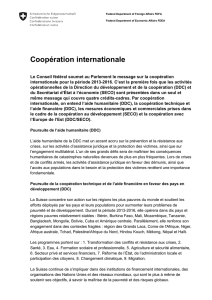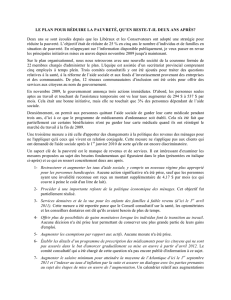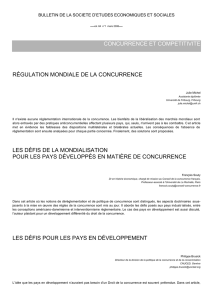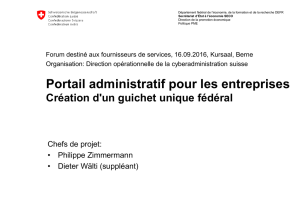La Vie économique - Die Volkswirtschaft

Page 43
La productivité
de la Suisse dans
les années nonante
Page 53
L’assurance-chômage
en 2003
Page 62
Les énergies
renouvelables
8-2004 77eannée CHF 14.90
La Vie économique
Page 3
Thème du mois:
Les stratégies contre
la pauvreté

Sommaire
Thème du mois
3Éditorial
Oscar Knapp
4L’Agenda 2010 de la Coopération économique au développement pour la réduction
de la pauvreté
Brigitte Chassot et Elodie de Warlincourt
9Comment atteindre les Objectifs de développement pour le Millénaire
Zia Qureshi
14 Les stratégies de lutte contre la pauvreté:
une chance pour la coopération suisse au développement économique?
Monica Rubiolo
18 L’impact des fonds de capital-risque sur les petites et moyennes entreprises
Claude Barras
22 Commerce et chaînes de valeurs ajoutées; une stratégie de lutte contre la pauvreté
Hans-Peter Egler
Points de vue politico-économiques
28 Les entreprises contribuent à lutter contre la pauvreté en usant de pratiques
responsables
Klaus M. Leisinger
30 Logique économique et solidarité de la politique de développement
Hans-Balz Peter
32 Le commerce équitable contribue au développement
Sibyl Anwander Phan-huy
34 Promouvoir durablement le secteur privé
Urs Egger
35 Lutte contre la pauvreté: la question essentielle est occultée
Peter Niggli
36 La contribution des banques à la lutte contre la pauvreté
René P. Buholzer
37 Deux exemples de la participation de Nestlé à la lutte contre la pauvreté
Hans Jöhr
Économie suisse
38 Agenda de politique économique
43 De l’évolution de la productivité en Suisse dans les années nonante:
quel était son véritable niveau de faiblesse?
Peter Balastèr et Marc Surchat
46 Mesure et développement de la recherche économique
dans les universités suisses
Miriam Hein et Heinrich Ursprung
49 La trésorerie de la Confédération en 2003
Peter Thomann
53 L’assurance-chômage en 2003
Dominique Babey
International
58 La force insoupçonnée de l’économie colombienne
Andréa Schmid-Riemer
62 Les énergies renouvelables en Suisse et dans le monde
Jean-Christophe Füeg
Données économiques actuelles
67 Sélection de tableaux statistiques
Thème du mois du prochain numéro: Les accords bilatéraux II
43 L’évolution de la productivité dans les années
nonante en Suisse a été évaluée à différents en-
droits. Tandis que l’OCDE arrive à un petit 0,4%
par an, le Rapport sur la croissance du DFE en
2002 parle de presque 1% et d’autres calculs de
1,5%. Ces écarts s’expliquent par la façon dont
les différentes séries de données sont traitées.
Pour éliminer ces différences, les auteurs ont
établi une statistique de synthèse à partir des
données de base existantes, qui renseigne sur
l’évolution réelle de la productivité.
4 Sans croissance économique ni soutien macro-
économique, promotion du secteur privé et in-
tégration dans l’économie mondiale, il ne sera
guère possible de réduire encore la pauvreté qui
gangrène notre planète. Ces éléments sont au
centre de l’Agenda 2010 pour la lutte contre
la pauvreté du Secrétariat d’État à l’économie
(seco). Ce dernier expose, dans le thème du mois,
ses objectifs et instruments pour la coopération
économique au développement. La Banque
Mondiale présente, en outre, son Rapport de suivi
sur les progrès accomplis vers les Objectifs de
développement pour le Millénaire.
62
Bien que la production d’énergies renouvela-
bles aient doublé au niveau mondial depuis les
années septante, sa quote-part dans la production
d’électricité a diminué. À l’initiative de l’Allema-
gne, une conférence internationale sur le sujet
«Renewables2004» s’est tenue à Bonn au début
du mois de juin de cette année. Son but était de
réunir la communauté internationale derrière
un plan d’action destiné à en assurer la promo-
tion.
53
La dégradation du marché du travail, qui
s’observe depuis 2001, a continué en 2003. Au
milieu de l’année, on comptait 145 687 chômeurs,
soit un taux de 3,7%. Le compte ordinaire de
l’assurance-chômage présentait une perte de plus
de 800 millions de francs en 2003. Cette année
a également été celle où la nouvelle loi sur l’assu-
rance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI) est entrée en vigueur.

Impressum
Publication:
Département fédéral de l’Économie (DFE),
Secrétariat d’État à l’économie (seco)
Comité de rédaction:
Aymo Brunetti (président du comité),
Rita Baldegger, Christian Maillard, Manuel
Sager, Eric Scheidegger, Geli Spescha,
Markus Tanner, Boris Zürcher
Rédaction
Effingerstrasse 1, 3003 Berne
Téléphone 031 322 29 39/18
Fax 031 322 27 40
Courriel: kaethi.gf[email protected]
Direction générale: Markus Tanner
Rédacteur en chef: Geli Spescha
Rédaction: Urs Birchmeier,
Simon Dällenbach, Käthi Gfeller,
Christian Maillard, René Sintucci
La teneur des articles reflète l’opinion
de leurs auteurs et ne correspond pas
nécessairement à celle de la Rédaction.
Reproduction autorisée avec l’accord de
la Rédaction, avec indication de la source;
remise de justificatifs souhaitée.
Édition, Production
Zollikofer AG, Fürstenlandstrasse 122,
9001 St-Gall, téléphone 071 272 77 77,
Fax 071 272 75 86,
www.zollikofer.ch
Annonces
Zollikofer AG, Alfred Hähni,
téléphone 01 788 25 78, Fax 01 788 25 79,
Courriel: dievolkswirtschaft@zollikofer.ch
Abonnements/Service aux lecteurs
Zollikofer AG, Lena Yesilmen,
téléphone 071 272 74 01,
Fax 071 272 75 86,
Courriel:
dievolkswirtschaftabo@zollikofer.ch
Prix de l’abonnement
Suisse Fr. 149.–, Étranger Fr. 169.–
Étudiants Fr. 69.–
Vente au numéro Fr. 14.90 (TVA comprise)
Parution mensuelle en français et en alle-
mand (en allemand: Die Volkswirtschaft),
77eannée, avec suppléments de la Commis-
sion pour les questions conjoncturelles et
de la Banque nationale suisse.
ISSN 1011-386X
Centres de congrès et hôtels séminaires
CH-3700 Spiez am Thunersee
Pour des séminaires réussis
Vos hôtes
Rosmarie Seiler-Bigler &
Markus Schneider
Tél.: (033) 655 66 66 Fax: (033) 654 66 33
Tel. 033 226 12 12 • Fax 033 226 15 10
www.seepark.ch • [email protected]
BUSINESS
AS
UNUSUAL
Salles de séminaires
ultra modernes do-
tées d'une infrastruc-
ture complète pour
des formations, expo-
sés, congrès et
cours; chambres
confortables et gastronomie de première fraî-
cheur. Environnement idyllique (réserve naturel-
le). Demandez notre brochure.
L’HOTEL POUR DE SEMINAIRE DANS LE PAYS D’APPENZELL
Idyll Gais, 9056 Gais
Tél. 071 793 11 45, Fax 071 793 31 92
www.idyll-gais.ch

Thème du mois
Éditorial
La coopération économique au développement:
un partenariat pour la réduction de la pauvreté
La nouvelle vague de mondialisation qui s’est imposée à partir des années nonante
a soumis les pays en développement a de fortes pressions; elle leur a aussi et avant tout
ouvert de formidables perspectives. Le Secrétariat d’État à l’économie (seco) intervient
au cœur de cette dynamique en favorisant des conditions-cadres propices à une crois-
sance économique durable dans les pays du Sud et de l’Est. Il encourage leur intégra-
tion dans l’économie mondiale en mettant en œuvre des programmes de soutien ma-
croéconomique, de promotion des investissements et du commerce. La diminution de
la pauvreté dans ces pays demeure notre but principal. Elle ne se réalisera que par leur
participation plus large et mieux adaptée au processus de mondialisation.
Des efforts substantiels sont encore nécessaires pour sortir 1,2 milliard de femmes
et d’hommes de l’extrême pauvreté où ils se trouvent. Ce n’est qu’à ce prix que l’on
pourra renforcer les partenariats économiques et réduire les tensions politiques,
l’insécurité, les flux migratoires et les déséquilibres environnementaux. La coopéra-
tion économique au développement est donc tout à fait compatible avec les intérêts
propres de notre pays.
En adoptant en 2001 sa «Stratégie 2006», la Coopération économique au déve-
loppement du seco s’est engagée dans un processus qui s’intègre dans la politique
économique extérieure de la Suisse. La croissance économique, la mobilisation des
ressources privées et l’intégration des pays en développement dans l’économie mon-
diale sont les piliers sur lesquels repose notre réflexion. Celle-ci se traduit par des
programmes innovants et à forte valeur ajoutée en matière de coopération liée au
commerce, de conseils, d’appui et de financement des
entreprises, ainsi que de développement des infra-
structures publiques. Le seco participe également à
des initiatives majeures telles que le désendettement
des pays les plus pauvres.
Nous adhérons ainsi pleinement au partenariat
global pour la réduction de la pauvreté tel que l’ONU
le définit dans ses Objectifs de développement du Mil-
lénaire. Notre approche a fait ses preuves et s’intègre
dans l’agenda international. A l’avenir, nous
souhaitons faire plus encore. Nous voulons
renforcer l’impact de nos interventions en
affinant les instruments dont nous dispo-
sons et en nous concentrant sur des ob-
jectifs concrets et mesurables. C’est dans
cet esprit, que nous travaillons et voulons
mettre en œuvre l’Agenda 2010 de co-
opération économique au développe-
ment pour la réduction de la pauvreté.
Oscar Knapp
Ambassadeur, chef de la Coopération
économique au développement,
membre du Comité de direction,
Secrétariat d’État à l’économie, Berne

Thème du mois
4La Vie économique Revue de politique économique 8-2004
Lutter contre la pauvreté dans le cadre
d’un partenariat global
Durant la dernière décennie, la pauvreté a
été combattue avec succès dans de nombreux
pays.Ceux qui se sont ouverts aux échanges et
aux investissements internationaux ont géné-
ralement connu une croissance économique
plus forte que dans les pays industrialisés et
leurs exportations ont progressé à un rythme
supérieur à la moyenne mondiale.La pauvreté
y a connu un réel recul.La proportion de la po-
pulation vivant avec moins d’un dollar par
jour a fortement baissé et les indicateurs tels
que la mortalité infantile, l’espérance de vie,
l’alphabétisation et la consommation privée
par habitant ont évolué dans la bonne direc-
tion. Il serait, toutefois, difficile de se satisfaire
de ces résultats. Plus de 1,2 milliard de per-
sonnes – dont 70% de femmes – vivent encore
en-dessous du seuil de pauvreté. Par ailleurs
d’importantes disparités régionales subsistent:
la pauvreté augmente rapidement en Europe
du Sud-Est et en Asie centrale et continue de
croître en Afrique sub-saharienne. En Asie du
Sud, alors que la pauvreté globale a fortement
baissé au cours des deux dernières décennies,
490 millions de personnes vivent toujours
avec moins d’un dollar par jour.
La réduction de la pauvreté demeure le défi
mondial le plus important. Les tensions poli-
tiques, l’insécurité, les flux migratoires et les
catastrophes écologiques sont souvent exacer-
bés par la pauvreté. Ainsi, au-delà de notre
engagement en faveur de la solidarité interna-
tionale, il est également dans notre intérêt de
combattre la pauvreté non seulement pour des
raisons de sécurité et de stabilité internationa-
les, mais aussi parce que les pays en dévelop-
pement et en transition sont nos partenaires
économiques de demain si ce n’est déjà d’au-
jourd’hui. Ce constat est à l’origine des ODM
que l’Assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) a adopté en 2000
pour réduire la pauvreté de moitié,combattre
l’analphabétisme, la mortalité maternelle et
L’agenda 2010 de la Coopération économique au développement
pour la réduction de la pauvreté
D’ici l’automne, le Secrétariat
d’État à l’économie (seco) se do-
tera d’un agenda destiné à ren-
forcer son engagement en faveur
de la réduction de la pauvreté
dans les pays en développement
et en transition à l’horizon 2010.
Cette action est au cœur du man-
dat de la coopération économique
au développement du seco et
s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie basée sur la croissance
économique – soutenue et dura-
ble – dans ces pays ainsi que de
leur intégration dans l’économie
mondiale. Alors que les appro-
ches reposant sur les principes
du marché, l’initiative privée et
la promotion des échanges ont
dans une très large mesure fait
leurs preuves, les progrès enre-
gistrés sont encore insuffisants
pour atteindre les Objectifs de
développement du Millénaire
(ODM). Le seco doit poursuivre
les efforts entrepris en précisant
ses orientations et en affinant
ses instruments, tout en les
traduisant par des engagements
concrets et mesurables.
Brigitte Chassot
Cheffe de la Task Force
Questions stratégiques,
Secrétariat d’État à
l’économie (seco),
Berne
Élodie de Warlincourt
Secteur Controlling,
Secrétariat d’État à
l’économie (seco),
Berne
Par le biais d’une vaste palette novatrice de
services et de financement, le seco est à même
de soutenir les PME dans toutes les phases
d’investissement, de production, de sous-
traitance et d’échange commercial. En illus-
tration: entreprise de crevettes biologiques
au Vietnam soutenue par le seco. Photo: seco
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
1
/
62
100%