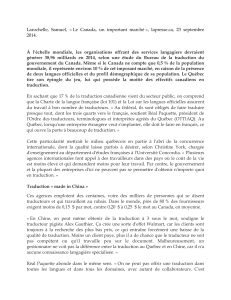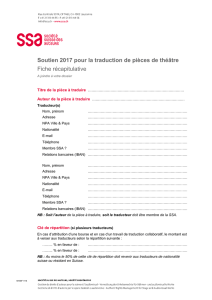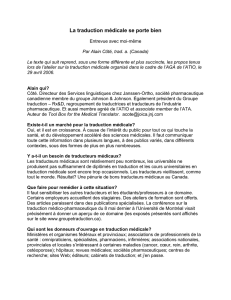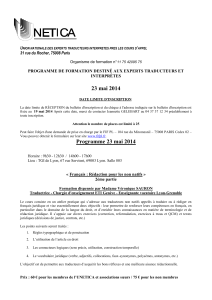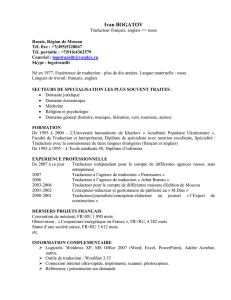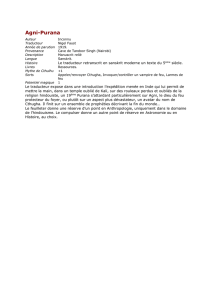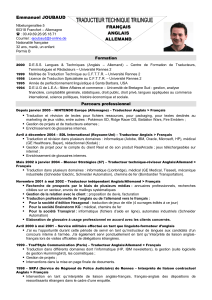lire le magazine - TransLittérature

Revue semestrielle éditée par
l'ATLF
Association des Traducteurs Littéraires de France
www.atlf.org
Tél./Fax : 01 45 49 26 44
et
ATLAS
Assises de la Traduction Littéraire en Arles
www.atlas-citl.org
Tél. : 01 45 49 18 95 – Fax : 01 45 49 12 19
99, rue de Vaugirard, 75006 Paris
Directeur de la publication
Michel Volkovitch
Responsable éditoriale
Laurence Kiefé
Coordination éditoriale
Valérie Julia
Comité de rédaction
Sarah Gurcel, Hélène Henry, Valérie Julia, Laurence Kiefé,
Jacqueline Lahana, Karine Lalechère, Susan Pickford,
Emmanuèle Sandron, Béatrice Trotignon, Michel Volkovitch
Publié avec le soutien du Centre national du Livre
HIVER 2011 / n° 40
ABONNEMENT (1 AN)
FRANCE, EUROPE : 18 €AUTRES PAYS : 20 €PRIX DU NUMÉRO : 9 €
IMPRIMÉ À PARIS PAR BELLE PAGE / GRAPHISME : ET D'EAU FRAÎCHE / DÉPÔT LÉGAL N°110102 – ISSN 1148-1048
ILS TRADUISENT, ILS ÉCRIVENT
ENTRETIEN AVEC ROSE-MARIE VASSALLO
DOSSIER
LA FABRIQUE DES TRADUCTEURS
HIVER 2011 / n° 40
ATLF - ATLAS n°40
couv TL40_Couv TL 18/01/11 19:35 Page1

TL40_TL 18/01/11 15:41 Page1

ILS TRADUISENT, ILS ÉCRIVENT
6 Entretien avec Rose-Marie Vassallo Emmanuèle Sandron
JOURNAL DE BORD
16
Longue Sécheresse
Mona de Pracontal
TRADUIT DU FRANÇAIS
30 Une chanson intertextuelle Elena Lozinsky
POINT DE VUE
38 « Car en effet… » Corinna Gepner
FORMATION
Dossier La Fabrique des traducteurs
42 Introduction Hélène Henry
43 Le creuset idéal Jörn Cambreleng
45 Journal à quatre mains Anne-Marie Tatsis-Botton
et Natalia Mavlevitch
51 De l’écrit à la parole Fanchon Deligne
54 Le régime spécial de l’ESIT Sandrine Détienne
ATELIER
58 « Pousse-en-terre » Lenka Bokova
COLLOQUES
JOURNÉE DE PRINTEMPS 2010 : Traduire la nuit
64 Programme complet
65 La Nuit mélodieuse Jean-Paul Manganaro
75 Nuit d’extase Khaled Osman
78 Nuit romantique Philippe Marty
85 Un bout de la nuit Lenka Bokova
LES ASSISES 2010 : Correspondance
92 Programme complet
94 On nous écrit d’Arles
112 Formation à la traduction : où allons-nous ? Cathy Ytak
3
SOMMAIRE
TL40_TL 18/01/11 15:41 Page3

4
LECTURES
120
Why translation matters
, de Edith Grossman Claire-Marie Clévy
123 Revue
Jeu
Sarah Vermande
128 HOMMAGE
Lettre à Isabelle Perrin Michel Volkovitch
131 BRÈVES
TL40_TL 18/01/11 15:41 Page4

ILS TRADUISENT, ILS ÉCRIVENT
5
ENTRETIEN
AVEC
ROSE-MARIE
VASSALLO
Propos recueillis par
EMMANUÈLE SANDRON
TL40_TL 18/01/11 15:41 Page5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
1
/
128
100%