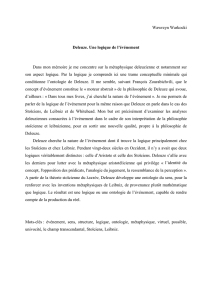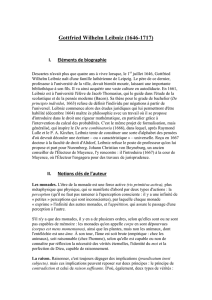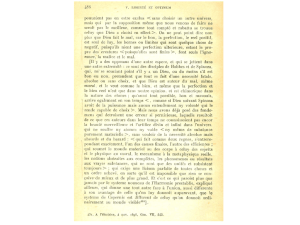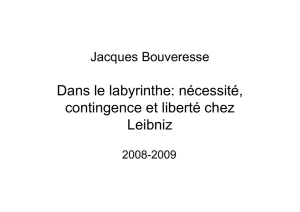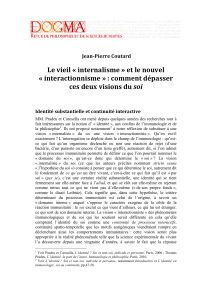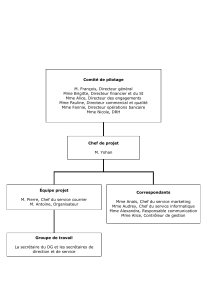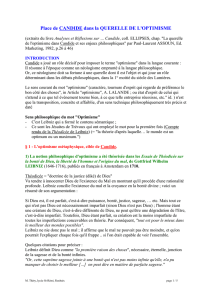Comment choisir ce qui aura été? Réflexions sur l

!"#$%!%&'(")"#*#+%,&%#%)#!(-)%#$%#./(!010./(%#*#(11)#232456789#
):#2#;#274<#*#"!(=%#%>#!%#?(+0(+
166
!
Comment!choisir!ce!qui!aura!été?!
Réflexions!sur!l’optimisme!prométhéen!contemporain!
@AB#"!%C")$%+#D(!10)#
#
#
#
Abstract#
#
?AEF#GAHI#JEHKLIM#NGI#EJGJOJPQ#NGAN#JP#IEMIQJR#KS#NGI#ATI#UI#RAOO#NGI#AENGBK@KRIEI:#VIBEABM#
1NJITOIB#GAP#ABNJRWOANIM#NGJP#PIENJQIEN#XF#GJTGOJTGNJET#GKU#AENGBK@KRIEI#SJOQP#ABI#NF@JRAOOF#EJGJ5
OJPNJRY#SKB# IZAQ@OIY# ,KE# >BJIB[P#!"#$%&'(#)$:#VWN# JS# NGI# ATI# JP# RGABARNIBJ\IM# XF# A# RWONWBAO# @IPPJ5
QJPQ#AXKWN#NGI#SWNWBI#KS#GWQAE#LJEMY#KB#ATAJE#AXKWN#JNP#@KPNGWQAE#PW@IBPIPPJKEY#NGIBI#JP#AOPK#A#
RKQ@OIQIENABF# PFQ@NKQ# NGAN# RKBBIP@KEMP# NK# A# PNBAETI# K@NJQJPQ# XISKBI# NGI# JQ@APPIP# KS# KWB#
ATI:# >GJP# K@NJQJPQY#UI# SJEM# JN# BI@BIPIENIM# JE# AEKNGIB# AENGBK@KRIEI# SJOQ]# )KOAE[P# *%+",-+"##$,:#
>GJP#NKK#JP#A#SJOQ#UGIBI#NGI#@BKNATKEJPNP#ABI#SARIM#UJNG#A#UKBOM#OARLJET#A#SWNWBIY#A#UKBOM#MFJET#
WEMIB# NGI# PNBIPPIP# RAWPIM# XF# NGI# GWQAE[P# IZ@OKJNANJKE# KS# EANWBI:# /IBIY# JEPNIAM# KS# NGI# QAENBA#
^.%/(01)+12')#"1)+1#$-+-3Y#AE#K@@KPJET#QKBAO#JP#BI@IANIM]#^4(%3+15(15"%+#"1)%+(1+'$+15((61%)5'+718$5"71
,$5"1$5$)%-+1+'"160)%51(91+'"1#)5'+:[#(E#NGI#SJOQY#>GKQAP[#@KIQ#JP#A#NBJXWNI#NK#@BKQINGIAEJPQ_#NGI#
MIANG#KS#NGI#IABNG#UJOO#EKN#QIAE#NGI#IEM#KS#GWQAE#OJSIY#JN#MIROABIPY#NGI#GWQAE#UJOO#PWB@APP#AOO#NGI#
OJQJNP#KS#JNP#IRKPFPNIQY#NGI#RKEPNBAJENP#KS#P@ARI5NJQI#JNPIOSY#AEM#XIRKQI#@WBI#GF@IBMJQIEPJKEAO#
JENIOOJTIERI:#>GI#SJOQ#IRGKIP#NGI#PW@IBPNJNJKWP#K@NJQJPQ#JE#NGI#@BKQJPI#KS#NIRGEKOKTF# UI# EKU#
SJEM#AN#NGI#GIABN#KS#RKENIQ@KBABF#QKHIQIENP#PWRG#AP#$&&"#",$+)(%)-;:#>GJP#@A@IB#APPIPPIP#NGI#
HAOJMJNF#KS#NGJP#JENBWQIENAOJ\ANJKE#KS#K@NJQJPQY#MBAUJET#SBKQ#!IJXEJ\[P#RKERI@N#KS#RKQ@KPPJXJOJNF#
AEM#NGI#RKPQKOKTJRAO#AENGBK@JR#@BJERJ@OI#`KXPIBHIB#XJAPa:#
#
#
#
=KQXJIE#O[K@NJQJPQI#MI#!IJXEJ\#IPN#bNBAETI:#
-JOOIP#$IOIW\I#
#
#
%E# EKHIQXBI# 2743Y# c# =AENIBXWBFY# OKBP# M[WE# RKOOKdWI# KBTAEJPb# @AB# )KeNIRGEJRP# c#
O[KRRAPJKE#MIP#27#AEP#MI#OA#@ABWNJKE#MI#<$1+"&'%)=>"1"+1#"1+";?-#@#`4883aY#VIBEABM#1NJI5
TOIB# bHKdWAJN# OI# EJGJOJPQI# RKENIQ@KBAJE# IE# PI# BbSbBAEN# AW# SJOQ# !"#$%&'(#)$#`2744a# MI#
!ABP# HKE# >BJIB:# =I# SJOQ# BI@BbPIENI# XJIE# WE# AP@IRN# MI# OA# PFQ@NKQANKOKTJI# MI#
O[AENGBK@KRfEIY#RABARNbBJPb#@AB#WE#MbRKWBATIQIENY#WE#b@WJPIQIEN#MI#OA#@BKNIENJKEY#WE#
MbPIETATIQIEN# MAEP# OI# @BKgIN# MIP# OWQJfBIPY# WE# MbSAWN# MI# RBKFAERI# IE# O[AHIEJB:# ?AJP#
g[AJQIBAJP#JRJ#QI#@IERGIB#PWB#O[IEHIBP#MI#RI#PFQ@NhQI#MI#O[b@KdWI:#1J#O[b@KdWI#IPN#XIO#IN#
XJIE#NBAQbI#@AB#WE#@IPPJQJPQI#RWONWBIO#PWB#O[AHIEJB#MI#O[GWQAJEY#KW#IERKBI#PWB#PKE#Mb5
@APPIQIEN# @KPN5GWQAJEY# JO# IZJPNI# AWPPJ# WE# AP@IRN# RKQ@ObQIENAJBI# dWJ# RKQ@BIEM# WE#

!"#$%!%&'(")"#*#+%,&%#%)#!(-)%#$%#./(!010./(%#*#(11)#232456789#
):#2#;#274<#*#"!(=%#%>#!%#?(+0(+
167
bNBAETI#K@NJQJPQI# MIHAEN#O[JQ@APPI:# =IN#K@NJQJPQIY# KE#OI# BINBKWHI#RKQQI# QKBAOI#MW#
SJOQ#*%+",-+"##$,#`2743a#MI#=GBJPNK@GIB#)KOAE:#=[IPN#WE#SJOQ#dWJY#RKQQI#!"#$%&'(#)$Y#SAJN#
AWPPJ# @ABNJI# MI# RI# TIEBI# dWI# EKWP# @KWBBJKEP# A@@IOIB# i# AENGBK@KRbEJdWI# jY# RJEbQA# MW#
EKWHIAW# QJOObEAJBI# Kk# O[KE# PI# BINBKWHI# MIHAEN# O[JQ@APPI# M[WE# QKEMI# QKWBAENY# M[WE#
QKEMI#PAEP#SWNWBY#KW#MIHAEN#O[GKBJ\KE#SJEAO#MI#O[GKQJEJPANJKE:#?AJP#JRJY#AW#OJIW#MW#QAENBA#
l%EgKF#JN#UGJOI#JN#OAPNPmY#PKBNI#MI#QKBAOI#MI#!"#$%&'(#)$1*#IN#dWJ#PI#SAJN#Bb@bNIB#MIBEJfBI5
QIEN#@AB#nAQIP#!KHIOKRL#@AB#BA@@KBN#AWZ#RANAPNBK@GIP#ROJQANJdWIP#dWJ#EKWP#ANNIEMIEN#
MAEP# WE# SWNWB# NBfP# @BKRGI# *# EKWP# AHKEP# MAEP# *%+",-+"##$,# WEI# QKBAOI# K@@KPbIY# dWJ# EI#
RIPPI#MI#PI#SAJBI#Bb@bNIB#@AB#O[WE#MIP#@IBPKEEATIP#@BJERJ@AWZ#]#l4(%3+15(15"%+#"1)%+(1+'$+1
5((61%)5'+718$5"71,$5"1$5$)%-+1+'"160)%51(91+'"1#)5'+:m#=[IPN#WEI#@GBAPI#NJBbI#M[WE#RbOfXBI#
@KfQI#MI#$FOAE#>GKQAP#_#WE#@KfQI#dWJ#IZAONI#O[JESANJTAXOI#AWNK@BbPIBHANJKE#MW#HJHAEN#
MIHAEN#OA#QKBNY#MIHAEN#OA#NBAEPJNJKE#MI#@GAPI#SANAOI:#.AB#AJOOIWBPY#c#O[AWXI#MI#O[bOIRNJKE#MI#
1FBJ\A#IE#-BfRIY#oAEEJP#,ABKWSALJP#P[A@@BK@BJAJN#RI#QpQI#@KfQI#MI#>GKQAP#]#OIP#-BIRPY#
MJPAJN5JOY# HIEAJIEN# MI# RGKJPJB# MI# %"1 ?$-1 "%+,",1 $?$)-A-1 6$%-1 &"++"1 B(%%"1 %>)+:1 =[IPN# HBAJ5
PIQXOAXOIQIEN#OI#RBJ#M[WE#IP@KJB#KW#M[WE#IETKWIQIEN#@KWB#OI#SWNWB:#?AJP#MAEP#*%+",-+"#C
#$,Y#O[AMATI#MI#>GKQAP#QKXJOJPI#@OWNhN#WEI#A@KOKTJI#MI#O[AENGBK@KRfEI:#.OWP#@BbRJPbQIENY#
OI# SJOQ# SAJN# O[bOKTI# M[WE# @BKQbNGbJPQI# BIQABdWAXOI# dWJ# MbROABI# ]# O[GWQAJE# Mb@APPIBA#
NKWNIP#OIP#OJQJNIP#MI#OA#XJKOKTJIY#PKE#bRKPFPNfQIY#IN#OIP#RKENBAJENIP#QpQIP#MI#O[IP@ARI5
NIQ@P_#JO#NBAEPRIEMIBA#OA#RKB@KBbJNb#MW#HJHAEN#@KWB# MIHIEJB#@WBI#JENIOOJTIERI#GF@IBMJ5
QIEPJKEEIOOI#IN#RKPQJdWI:#
#
!I# SJOQ# SAJN# MKER# @BIWHI# M[WE# bNBAETI# K@NJQJPQI# @BKQbNGbIE:# "W5MIOc# MI# PKE# Mb5
@OKJIQIEN# MIP# ISSINP# AWMJKHJPWIOP# IN# MW# BFNGQI# NF@JdWI# MW# RJEbQA# M[ARNJKE# GKOOFUKK5
MJIEY#JO#QIN#OI#MKJTN#PWB#WE#AP@IRN#MI#RIN#K@NJQJPQI#dWJ#EKWP#bRGA@@I#NBK@#PKWHIEN:#=IN#
K@NJQJPQI# MIHAEN# O[JQ@APPI# A@KRAOF@NJdWI# PIQXOI# SKEMb# MAEP# WEI# PW@IBPNJNJKEY# MAEP#
WEI#IP@fRI#MI#RKEMJNJKEEIQIEN#PW@IBPNJNJIWZ#MW#SWNWBY#RKQQI#PJ#O[K@NJQJPQI#RKQQI#NIO#
@KWHAJN#AHKJB#WE#ISSIN#PWB#OI#MbEKWIQIEN#MI#O[GJPNKJBI:#0E#BIRKEEAJNBA#O[K@NJQJPQI#JESANJ5
TAXOI#MW#gKWIWBY#MW#5$;B#",Y#dWJ#RBKJN#BbIOOIQIENY#MAEP#PKE#qQI#@BKSKEMIY#IN#c#RGAdWI#
RKW@#MI#MbY#dWI#RINNI#SKJP#PKE#MIPNJE#PIBA#AOJTEb#AHIR#PKE#MbPJBY#dWI#OA#RKENJETIERI#MW#gIW#
PI#PFERGBKEJPIBA#AHIR#PKE#JENIENJKE:#=[IPN#MJBI#dWI#O[GJPNKJBI#P@bRWOANJHI#Mb@OKFbI#MAEP#
*%+",-+"##$,#RKQ@KBNI#WEI#bNBAETI#JEHIBPJKE#MI#OA#@BJKBJNb#RAWPAOI#]#R[IPN#OI#SWNWB#dWJ#RGKJ5
PJN#PKE#@APPb:##
#
.KWB#BbPWQIB#BA@JMIQIEN#]#!I#QANGbQANJRJIE5@GFPJRJIE#RGABTb#MI#PAWHIB#O[GWQAEJNb#
M[WEI#@OAEfNI#QKWBAENIY#MKJN#@KWB#OI#SAJBI#MbEKWIB#OI#@BKXOfQI#MI#OA#TBAHJNb#dWAENJdWI:#
0BY#RI#HJIWZ#PRJIENJSJdWIY#EKWP#O[A@@BIEKEP#NABMJHIQIEN#MAEP#OI#SJOQY#PAHAJN#MI@WJP#OKET5
NIQ@P#dW[JO#PIBAJN#JQ@KPPJXOI#MI#BbPKWMBI#OI#QFPNfBI#MI#OA#TBAHJNbY#PAEP#dWI#EKWP#@WJP5
PJKEP# P[bOIHIB# GKBP# MI# O[IP@ARI5NIQ@P# OWJ5QpQIY# R[IPN5c5MJBIY# PAEP# NBAEPRIEMIB# OA# RKE5
NBAJENI#MIP#NBKJP#MJQIEPJKEP#P@ANJAOIP#IN#MI#OA#NIQ@KBAOJNb#APFQbNBJdWI:#)bAEQKJEPY#RI#
HJIWZ#PRJIENJSJdWI#EI#MJN#BJIE#AWZ#AWNBIP#@BKNATKEJPNIP#MW#SJOQY#IN#OIP#RKEHJEN#MI#PI#OJHBIB#

!"#$%!%&'(")"#*#+%,&%#%)#!(-)%#$%#./(!010./(%#*#(11)#232456789#
):#2#;#274<#*#"!(=%#%>#!%#?(+0(+
168
c#O[IZ@OKJN#M[WEI#NBAHIBPbI#APNBKEKQJdWI#c#NBAHIBP#WE#+,(>"1 6"1 D",-7#WE#2(,;'(#"#*1WE#
@KEN# NGbKBJdWIQIEN# @KPPJXOI# IENBI# MIWZ# @KJENP# MAEP# O[IP@ARI5NIQ@P# *1AHIR# OI# XWN# M[F#
NBKWHIB#WEI#AWNBI#@OAEfNI#Kk#O[GWQAEJNb#@KWBBAJN#PI#BIRBbIB#WE#QKEMI:##
#
?AJP#c#dWKJ#KW#c#dWJ#MIHKEP5EKWP#O[KWHIBNWBI#NBfP#K@@KBNWEI#MI#RI#QFPNbBJIWZ#@KBNAJO#
HIBP#WE#SWNWB#@KPPJXOI#r#0E#PW@@KPIBA#gWPdW[c#OA#SJE#MW#SJOQ#dWI#RI#SWN#OA#RBbANJKE#M[WEI#
RJHJOJPANJKE#IZNBANIBBIPNBI#IZNBpQIQIEN#PK@GJPNJdWbI#IN#XJIEHIJOOAENI:#?AJP#A@BfP#P[pNBI#
AXAEMKEEb#AW#BJPdWI#MI#NBAHIBPIB#RIN#GKBJ\KEY#AHIR#O[IP@KJB#M[F#NBKWHIB#WEI#@OAEfNI#GA5
XJNAXOIY#KE#BbAOJPI#dWI#RI#E[bNAJN#@AP#OI#RAP:#.AB#WEI#PbBJI#MI#RKENJETIERIP#*#MIP#TIPNIP#
M[AWNK@BbPIBHANJKE#AWNAEN#dWI#MI#TIPNIP#M[AONBWJPQI#*#QAJENIEAEN#O[WE#MIP#@BKNATKEJPNIP#
PI#BINBKWHI#c#O[JENbBJIWB#MW#NBKW#EKJB#dWJ#KRRW@I#OI#RIENBI#MI#OA#TAOAZJI#bNBAETfBI:#=[IPN#JRJ#
dWI#O[KE#RKQQIERI#c#MbEKWIB#OI#QFPNfBI:#>KWP#OIP#PJTEIP#dWI#EKWP#AHJKEP#JENIB@BbNbPY#
OIP# RGAJEIP# MI# RKsERJMIERIP# IN# OIP# GIWBIWZ# GAPABMP# dWJ# EKWP# AHAJIEN# RKEMWJNP# c# NBAEP5
TBIPPIB#O[GKBJ\KE#IN#c#EKWP#Mb@APPIBY#E[bNAJIEN#SJEAOIQIEN#@AP#OI#NBAHAJO#M[WEI#RJHJOJPANJKE#
IZNBAQKEMAJEI#PK@GJPNJdWbI#IN#XJIEHIJOOAENI:#=[bNAJN#EKWP5QpQIP#MAEP#OI#SWNWBY#R[IPN5c5
MJBI#O[GWQAJE#c#HIEJBY#KW#@IWN5pNBI#@OWP#@BbRJPbQIEN#WE#@KPN5GWQAJEY#dWJ#EKWP#A@@IOAJN#
MI@WJP#NKWgKWBP# c# EKWP#bOIHIB# GKBP# MI# O[IAWY# c# AMK@NIB#OI# PNAMI# MIXKWNY#c# NBAEPTBIPPIB#
RGAdWI# OJQJNI# BIERKENBbI# AW# RKWBP# MI# O[GKQJEJPANJKE:# =[IPN# WE# K@NJQJPQI# AHIWTOIY# WEI#
RKESJAERI#@BKQbNGbIEEI# dWJ# EKWP# AWBA# QIEbP#gWPdWI# Oc:# 0E#EKWP# A@@BIEM# dW[JO# SAOOAJN#
PWJHBI# OIP# HKJIP# JQ@OJRJNIP# MI# O[AQKWB# _# O[IP@KJB# IPN# EKNBI# TWJMI_# JO# EKWP# IQ@KBNI# MAEP#
EKNBI#@BK@BI# AWNKNBAEPRIEMAERI:#)KNBI# GbBKPY#QAJENIEAEN# AW# PIJE# MI# OA# PJETWOABJNb# MW#
NBKW#EKJBY#P[AFAEN#MKER#OJXbBb#MIP#RKENBAJENIP#MI#O[IP@ARI5NIQ@PY#IN#@KWHAEN#QAJENIEAEN#
RKENBhOIB#OA#TBAHJNb#c#E[JQ@KBNI#dWIO#IEMBKJN#IN#c#E[JQ@KBNI#dWIO#NIQ@PY#NBKWHI#AOKBP#OI#
QKFIE#MI#RKQQWEJdWIB#AHIR#OI#@APPbY#@KWB#BIEMBI#c#PA#SJOOI#*#dWJ#BIQ@OARI#QAJENIEAEN#
OI#HJIWZ#PRJIENJSJdWI#*#RI#PIRBIN#MI#OA#TBAHJNb#dWAENJdWI:#.AB#WEI#bNBAETI#XKWROI#MAEP#OI#
NIQ@PY#OI#SWNWB#AWBA#RGKJPJ#PKE#@BK@BI#@APPb#@AB#OI#XJAJP#M[WE#ARNI#MI#SKJ:#
#
nI#RBKJP#dWI#RINNI#GJPNKJBI#AENGBK@KRbEJdWI#MIPPJEI#XJIE#O[IEHIBP#MW#PFQ@NhQI#MI#!"C
#$%&'(#)$:# ![KE# MJPRIBEI# XJIE# MIWZ# @hOIP# RABARNbBJPAEN# OIP# PFQ@NKQANKOKTJIP# MI#
O[AENGBK@KRfEI#]# O[WE# @IPPJQJPNIY# QbOAERKOJdWI# IN# MbPIP@bBbY# O[AWNBI# K@NJQJPNIY# IENGKW5
PJAPNIY# RBKFAEN:# 0E# BIRKEEAJN# OI# RKESOJN# @IB@bNWIO# IENBI# RIP# SANAOJPNIP# dWJ# A@@OJdWIEN# OI#
PRAO@IO#MW#MKWNI#AEAOFNJdWI#AWZ#GIWBIWZ#GAPABMP#MW#@BKTBfPY#IN#RIP#HKOKENABJPNIP#@KWB#
dWJ#OA#MbNIBQJEANJKE#BIQABdWAXOI#IN#OA#QKNJHANJKE#JEb@WJPAXOI#Mb@IEMIEN#MIP#tJOOfBIP#
dWJ#OIWB#QAPdWIEN#RKQQKMbQIEN#OIP#RKENBAMJRNJKEP#MI#OIWBP#ARNIPY#dWJ#MbTWJPIEN#RGAdWI#
RKERKWBP#MI#RJBRKEPNAERIP#IE#-A,"%6)?)+A:#$[WE#RhNb#i#"%/(01 )+12')#"1 )+1 #$-+-1jY#MI#O[AWNBI#
i#6(%3+15(15"%+#"1)%+(1+'$+15((61%)5'+1j:##
#
(O# F# A# WE# BA@@BKRGIQIEN# c# SAJBI# IENBI# *%+",-+"##$,1 IN# OIP# QKWHIQIENP# NIRGEK5
K@NJQJPNIP# RKENIQ@KBAJEP# A@@IObP# l$&&A#A,$+)(%%)-;"E4:# (O# F# A# WE# K@NJQJPQI# IEHIBP# OI#
1#.KWB#WEI#BIRKTEJNJKE#MI#O[ARRIOIBANJKEJPQIY#RS:#"HAEIPPJAEY#?ARLAF#`IMPa#2743:

!"#$%!%&'(")"#*#+%,&%#%)#!(-)%#$%#./(!010./(%#*#(11)#232456789#
):#2#;#274<#*#"!(=%#%>#!%#?(+0(+
169
NIRGEKRA@JNAOJPQI#RKENIQ@KBAJEY#WE#HKOKENABJPQI#dWJ#JEPJPNI#dWI#OA#PIWOI#SAuKE#M[IE#SJ5
EJB#AHIR#O[GKBBIWB#MW#RA@JNAOJPQI#IPN#MI#O[IZARIBXIBY#M[ARRWIJOOJB#OI#QKEPNBI#dWJ#EKWP#JE5
SIRNIY#IN#M[ARRbObBIB#OI#@BKRIPPWP#MI#EKNBI#MbNIBBJNKBJAOJPANJKE#SJEAOI:#(O#SAWN#MJBI#dWI#RI#
QKWHIQIEN# @BKQbNGbIE# IPN# Eb# MAEP# OIP# AEEbIP# [87# c# DABUJRL# AWNKWB# MW# @GJOKPK@GI#
)JRL#!AEM#IN#MW#=WONWBAO#=FXIBEINJRP#+IPIABRG#&EJN:#nWPNIQIENY#O[WE#MIP#@BJERJ@AWZ#RKE5
RI@NP#PKBNJP#MI#RI#TBKW@I#IPN#RIOWJ#MI#O['0?",-+)+)(%]#PKBNI#MI#SJRNJKE#JEPNBWQIENAOJPbIY#dWJ#
A#@KWB#XWN#MI#SAJBI#AMHIEJB#OI#SWNWB#@AB#JEPJEWANJKE#@ABAPJNAJBIY#@AB#JEPJPNAERI#Bb@bNJNJHI#
IN#JESIRNJIWPI:#=[IPN#AWPPJ#OI#XAPNJKE#dWJ#A#MKEEb#OJIW#AW#EJGJOJPQI#EIK5BANJKEEIO#MI#+AF#
VBAPPJIBY#dWJ#PI#BbROAQI#MW#@BKgIN#MIP#OWQJfBIPY#IN#dWJ#MbSIEM#OI#@BKQbNGbJPQI#RKENBI#
NKWNI#SKBQI#MI#RKEEAJPPAERI#i#QFNGJdWI#j#KW#SKOLOKBJdWIY#NAXKWPY#JMbIP#NKWNIP5SAJNIP#IN#
JQ@OJRJNIP:#(O#SAWNY#MJN5JOY#RKQXANNBI#OI#SANAOJPQI#@AB#OA#BAJPKEY#QAJP#JO#F#A#MAEP#RINNI#@KPJ5
NJKE# IERKBI# OI# BISOIN# M[WEI# PW@IBPNJNJKE# JEPNBWQIENAOJPbI:# 0E# RKQ@BIEMBA# O[JENbBpN# MI#
VBAPPJIB#@KWB#OIP#NBAHAWZ#MI#?IJOOAPPKWZ#`2742a]#JO#@ABNATI#OA#RKEHJRNJKE#dW[JO#SAWN#PI#OJ5
XbBIB#MW#RIBROI#RKBBbOANJKEEIO#@KWB#BIHIEJB#AW#@BKgIN#MIP#OWQJfBIPY#Kk#OA#RKEEAJPPAERI#
BbWPPJI#c#P[ASSBAERGJB#MI#O[JQ@APPI#MI#OA#RJBRWOABJNb#IENBI#KXPIBHANJKE#IN#ANNIENIY#Kk#O[KE#
NKWRGI#HBAJQIEN#AW#BbIO#@WBY#O[KXgIRNJHJNb#c#O[bNAN#XBWNY#EKE#NIBEJ#@AB#OI#BITABM#GWQAJE:#
=[IPN#WE#BbAOJPQI#IZNBpQI#dWJ#RBKJN#@KWHKJB#P[bOIHIB#GKBP#MI#OA#RKEMJNJKE#GWQAJEI1@AB#WE#
ISSIN#MI#MbPWXgIRNJHANJKE#NKNAOIY#@AB#WE#@ABAPJNATI#NIRGEKRA@JNAOJPNI#IZGAWPNJS:#0E#MbSIEM#
O[JMbI#dWI#@KWB#PI#OJXbBIB#MW#@APPbY#JO#SAWN#i#ARRI@NIB#j#EKNBI#@WBI#QARGJEAOJNb#AOTKBJNG5
QJdWI# IN# JESbBIENJIOOI:# 0E# RBKJN# RBbIB# OI# SWNWB# @AB# @WBI# ->?",-+)+)(%1 ?,(+"%+)(%"##"Y# @AB#
@BK@GbNJPQI#@BKQbNGbIEY#@AB#PRJIERI5SJRNJKE#GF@IBPNJNJIWPI:#?AJP#KE#NIEM#c#KWXOJIB#dW[JO#
F#A#@BKNIENJKE#PIWOIQIEN#AWPPJ#OKETNIQ@P#dW[JO#F#A#BbNIENJKE:#=KEPbdWIQQIENY#RI#EKWHIO#
K@NJQJPQIY#PFQ@NKQANJdWI#MI#O[AENGBK@KRfEIY#PI#SKEMI#MAEP#WE#QANbBJAOJPQI#bOJQJEANJS]#
JO#JEPJEWI# dW[JO# E[F#A# @AP#MI# RKERBIPRIERIY#@AP# MI# PFENGfPIY# @AP# M[IZ@bBJIERIY#IN# dWI#OI#
MKEEbY#PWJHAEN#O[ABNJRWOANJKE#MI#DJOSBJM#1IOOABPY#IPN#WE#QFNGIY#KW#dWI#OA#RKEPRJIERIY#PWJ5
HAEN#$IEEINN#KW#?IN\JETIBY#IPN#WEI#)##>-)(%1MKEN#JO#SAWN#P[ASSBAERGJB:##
#
1KJN:#?AJP#JO#SAWN#BIRKEEAvNBI#MAEP#RI#@BKQbNGbJPQI#RKENIQ@KBAJE#WEI#RKESJAERI#MAEP#
OA#@BKQIPPI#KBJTJEIOOI#MI#OA#NIRGEJdWI:#$AEP#OIP#@BKRIPPWP#MI#TBAQQANJPANJKE#IN#MI#MJP5
RBbNJPANJKE#dWJ#RABARNbBJPIEN#OA#NIRGEKTbEfPIY#OI#RKENJEWI#MKEEI#OJIW#AW#MJPRBIN#_#NKWN#PI#
SAJN#EKQQIBY#RKQ@NIBY#dWAENJSJIBY#JEMIZIBY#c#NBAHIBP#WE#MbRKMATI#WEJOANbBAO#MW#QKEMIY#
dWJ# RKEPJPNI# IE# WEI# bRKEKQJI# MW# RGAWM# IN# MW# SBKJMY# KW# MW# QKWHAEN# IN# MW# BI@KP:# .AB#
O[AHAERbI#MI#OA#NIRGEKTbEfPIY#RI#dWJ#IPN#A@@BKZJQb#IPN#@BKTBIPPJHIQIEN#bROJ@Pb#@AB#RI#
dWJ#IPN#BbPKOW#MAEP#NKWP#PIP#MbNAJOP#JESJEJNbPJQAWZ:#![wTI#MI#OA#F)514$+$71@AB#AJOOIWBPY#PI5
BAJN# @IWN5pNBI# OA# PANJPSARNJKE# MI# OA# @BKQIPPI# KBJTJEIOOI# MI# OA# MJPRBbNJPANJKE# ]#OA# RKENJE5
TIERI# PIBA# NBAMWJNI# IE# EbRIPPJNb:# )KWP# @KWBBKEP# NKWN# IEBITJPNBIBY# NKWN# QbQKBJPIBY# IN#
MKER#NKWN#@BbMJBIY#AWPPJ#OKETNIQ@P#dWI#EKWP#@KWBBKEP#IZ@OKJNIB#OIP#SKBRIP#MI#OA#EANWBI#
IE#OIP#QINNAEN#AW#PIBHJRI#MI#PKE#@BK@BI#MbRKMATI:#
#
=I#BpHI#MI#OA#MJPRBbNJPANJKE#NKNAOI#MW#QKEMI#BIEHKJI#AW#RKPQKP#JQATJEb#@AB#.JIBBI5

!"#$%!%&'(")"#*#+%,&%#%)#!(-)%#$%#./(!010./(%#*#(11)#232456789#
):#2#;#274<#*#"!(=%#%>#!%#?(+0(+
170
1JQKE#!A@OARIY#dWJ#IEHJPATIAJN#WEI#JENIOOJTIERI#KQEJPRJIENI:#i#+JIE#EI#PIBAJN#JERIBNAJE#
@KWB#IOOIY#IN#OxAHIEJBY#RKQQI#OI#@APPbY#PIBAJN#@BbPIEN#c#PIP#FIWZ#j#`!A@OARI#4927#]#JJ5JJJa:##
$AEP#O[WEJHIBP#!A@OARJIEY#RGAdWI#bHbEIQIEN#A#PA#@BK@BI#RAWPI#`RKQQI#RGI\#!IJXEJ\aY#IN#
MKER#PJ#OI#MbQKE#AHAJN#RKEEAJPPAERI#MI#NKWNIP#OIP#RAWPIP#MI#NKWP#OIP#ISSINPY#JO#@KWBBAJN#
@BbMJBI#OI#SWNWB#c#@IBSIRNJKE:#%PPIENJIOOIQIEN#JO#E[F#AWBAJN#AWRWEI#MJSSbBIERI#IENBI#O[AHAEN#
IN#O[A@BfPY#@APPb#IN#SWNWB:#!A#RKENJETIERI#PIBAJN#PKWQJPI#c#OA#EbRIPPJNb:#?AJP#RI#BpHIY#EKWP#
OI#PAHKEPY#A#IPPIENJIOOIQIEN#bNb#MbQAENIOb#@AB#/IEBJ#.KJERABbY#dWJ#MAEP#PKE#NBAHAJO#PWB#OI#
@BKXOfQI# MIP# NBKJP# RKB@PY# MbQKENBA# dWI# OA# BbAOJNb# QARBKPRK@JdWI# IPN# EbRIPPAJBIQIEN#
RKQ@KPbI#M[JQ@IBSIRNJKEPY#M[A@@BKZJQANJKEP#MIP#MbNAJOP#QJEWPRWOIP#MW#QKEMI#QJRBKP5
RK@JdWIY#IN#dWI#RIP#AP@IRNP#RARGbP#PKEN#@KBNbP#bHIENWIOOIQIEN#c#P[IZ@BJQIBY#AW#SWB#IN#c#
QIPWBI#dWI#OIP#RKEMJNJKEP#JEJNJAOIP#MW#PFPNfQI#PI#SKEN# AQ@OJSJIB#@AB#OI#NIQ@P:#=[IPN#RI#
dW[KE#A@@IOOI#OI#RGAKP#MbNIBQJEJPNI:#
#
.AB#AJOOIWBPY#OA#PRJIERI#IPN#NKWgKWBP#MJHJPbI#IENBI#RIP#MIWZ#@IBP@IRNJHIP:#$[WE#RhNb#RIWZ#
dWJ#JEPJPNIEN#PWB#WE#QKEMI#AXPKOWQIEN#MbNIBQJEJPNI#IN#OJEbAJBIY#IN#MI#O[AWNBIY#WE#QKEMI#
JENBJEPfdWIQIEN# EKE5OJEbAJBIY# My# c# O[ISSIN# MI# RI# dW[KE# A@@IOOI# IE# "ETOAJP# i# RKABPI5
TBAJEJET#jY#RI#dW[KE#@KWBBAJN#A@@IOIBY#OA#i#TBKPPJABJPANJKE#jY# O[# i#AQXJTWANJKE#jY#R[IPN5c5
MJBI#O[JEbHJNAXOI#A@@BKZJQANJKE#MW#QJRBKPRK@JdWI#dW[JQ@OJdWI#OA#BbAOJNb#QARBKPRK@JdWI:#
$W#@KJEN#MI#HWI#MI#OA#@GFPJdWI#SKEMAQIENAOIY#JO#E[F#A#dW[WEI#BbAOJNb:#(O#E[F#A#@AP#MI#PNBANJ5
SJRANJKEP#IENBI#BbTJQIP#KBTAEJPANJKEEIOPY#@AP#MI#MJPNJERNJKE#IENBI#XJKOKTJI#IN#RGJQJIY#@AP#
MI#PAWN#IENBI#OI#PKWP5ANKQJdWI#IN#O[ANKQJdWIY#@AP#MI#MJSSbBIERI#IENBI#QANJfBI#IN#IP@BJN:#
$AEP#OA#@GFPJdWI#SKEMAQIENAOIY#NKWN#IPN#JESKBQANJKE:#$I#RINNI#@IBP@IRNJHIY#OA#BbAOJNb#QJ5
RBK@GFPJdWI#AXPKBXI#NKWNIP#AWNBIP#@IBP@IRNJHIPY#@ABRI#dW[IOOI#MIQIWBI#JERGAETbI#c#NBA5
HIBP#OIP#NBAHAWZ#IN#OIP#NBJXWOANJKEP#MI#OA#BbAOJNb#QARBKPRK@JdWIP:#=[IPN#gWPNIQIEN#@KWB5
dWKJ#RIBNAJEP#RKPQKOKTJPNIP#@ABOIEN#M[WEI#+'"(,01(91"D",0+')%571RI#dWJ#bHKdWI#IERKBI#OI#
MbQKE#MI#!A@OARI#]#PJ#KE#RKEEAJPPAJN#OI#RKMI#MI#OA#EANWBIY#KE#@KWBBAJN#@BbMJBI#OI#SWNWB#c#
@IBSIRNJKE:#=[IPN#AWPPJY#@AB#AJOOIWBPY#OI#RABARNfBI#MW#MbEKWIQIEN#@KPNGWQAJE#JQATJEb#@AB#
*%+",-+"##$,1]#O[GWQAJE#AFAEN#KXNIEW#OA#SKBQWOI#SKEMAQIENAOIY#NBAEPRIEMI#OA#l@BJPKEm#MW#
RKB@PY#@KWB#MIHIEJB#@WBI#KQEJPRJIERI#@KPNGWQAJEI:##
#
?AJP#O[JMbI#M[WEI#+'"(,01(91"D",0+')%5Y#RKQQI#O[JMbI#M[WEI#@KPNGWQAEJNb#JERKB@KBIOOI#
IN#KQEJPRJIENIY#IPN#SKEMbI#MAEP#O[KWXOJ#dWI#EKWP#EI#HJHKEP#@AP#MAEP#O[JMbAOJNbY#KW#MAEP#OA#
@WBI#@KPPJXJOJNb:#&E#QKEMIY#RKQQI#OI#MJPAJN#!IJXEJ\Y#IPN#NKWgKWBP#RKENBAJEN#@AB#OA#&(;C
?(--)B)#)+A:1 "OKBP# PJ# OA# PRJIERI# HIWN# BbIOOIQIEN# @BbMJBIY# IOOI# MKJN# BIRKEEAvNBI# IN# RKQ5
@BIEMBI#EKE#PIWOIQIEN#OIP#QKEMIP#@KPPJXOIP#dWJ#AWBAJIEN#@W#pNBIY#QAJP#@OWNhN#OI#QKEMI#
dWJ#IPN#ARNWIOOIQIEN#IN#SARNWIOOIQIEN#OI#RAPY#IN#MAEP#OIdWIO#RINNI#GJPNKJBIY#RINNI#RWONWBIY#
RIP#KXPIBHANJKEP#KEN#XIO#IN#XJIE#OJIW:#%N#RI#dWJ#A#OJIW#MAEP#RIN#WEJHIBPY#R[IPN#dW[JO#F#A#MI#
O[AQXJTzJNbY#JO#F#A#MW#@BKXObQANJdWI#dWJ#bQIBTI#MW#@BKRIPPWP#QpQI#MI#PKE#Mb@OKJIQIENY#
IN#dWJ#@ABNJRJ@I#c#PA#RKERBIPRIERIY#c#PA#BbNJRWOANJKE#MIP#bHfEIQIENP#RKQ@KPPJXOIP:##
#
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%