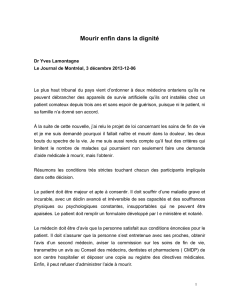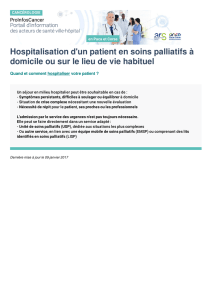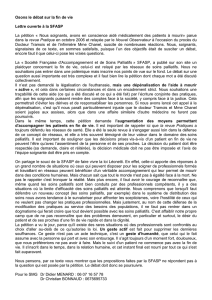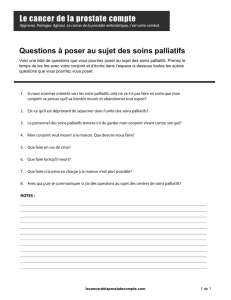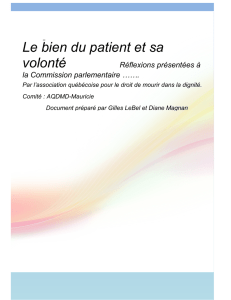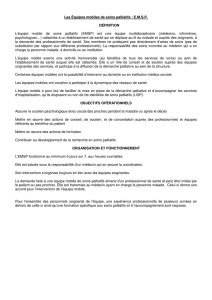La fin de vie - Pratiques, les cahiers de la médecine utopique

JUILLET 2014 66 PRATIQUES
1
De belles rencontres
Début mai se sont tenues à Grenoble des rencontres entre des collectifs, des femmes
et des hommes, des médecins, des internes, des étudiants. Elles ont été co-organisées
par l’association «Santé Communautaire en Chantier» de Grenoble, le Syndicat de
la Médecine Générale et la revue Pratiques.
L’objectif était de réfléchir, de partager des expériences, de mettre en commun des savoirs
autour des problématiques touchant à la santé et aux soins.
Ces rencontres étaient en gestation depuis deux à trois ans. Au travers d’échanges formels et
informels, de moments de convivialité, soignants en formation et « vieux routards » ont eu
l’envie d’agir pour la construction d’un système de santé solidaire et indépendant. Nous
sommes bien forcés de le constater, il semble exister un « trou générationnel » entre ces jeunes
soignants, dont nombre sont encore en formation, et ceux, à l’aube d’une retraite bien « méri-
tée », comme si une génération s’était endormie en oubliant le collectif.
Quatre ateliers ont fait bouillonner les cerveaux autour de la marchandisation de la santé, de
la formation soignante, des inégalités sociales de santé et de la santé communautaire.
L’idée que la population doit, en exprimant ses besoins, se réapproprier le vaste champ de la
santé et des soins a été au cœur des débats avec des interventions fort intéressantes de divers
collectifs comme les groupes LGBT et l’Association européenne de thérapie communautaire
intégrative amies et amis de Quatro Varas.
Avec trente ans d’écart, les réflexions menées se ressemblent, les révoltes et les combats ont le
même goût, même si les manières de faire sont différentes. Il s’agit maintenant de passer le
témoin; non pas pour se mirer dans le rétroviseur, mais pour construire des fondations qui
permettent de continuer à aller de l’avant. Créer des ponts entre les demandes des plus jeunes
qui souhaitent s’inscrire dans une histoire que nulle formation ne leur apporte et l’expérience
des anciens qui se sentent l’envie et le devoir de transmettre. Nombre de ces plus jeunes sont
déjà dans l’élaboration de projets et participent à des actions, se concertent pour réfléchir sur
différents thèmes dont, notamment, les processus de domination qui régissent le monde. Il
nous faut élaborer des stratégies pour soutenir et défendre ces initiatives.
C’est cette envie de sortir du constat et de la déploration, envers et contre tout, dans un monde
marchandisé à outrance et organisé autour d’une déshumanisation générale qui a fait conver-
ger une centaine de participants à ces rencontres.
Chacune, chacun est reparti de ces journées avec de l’énergie et de l’espoir en réserve pour
continuer à cheminer à son rythme en gardant des liens solides.
En prime, un petit clin d’œil à Marine, étudiante en pharmacie qui nous a fait visiter un jardin
botanique en devenir. Elle a su nous communiquer son enthousiasme pour cette initiative por-
tée par le collectif CIDD (Comment imaginer demain différemment) et un professeur, soute-
nue par l’université Joseph Fournier de Grenoble dans un projet qui porte le joli nom « d’uni-
versité buissonnière ». Un partenariat rare entre association et université, une création
originale et pleine de promesses, tout comme ces rencontres!
ÉDITORIAL
Vous disposez ici de la version électronique indexée du N° 66
Page 97 : conseils techniques pour vous en faciliter l'usage
Pages 98 à 99 : Sommaire index des mots clés
Servez-vous des signets pour naviguer plus commodément
Bonne lecture

2
PRATIQUES 66 JUILLET 2014
Claudine Servain
Quelques problématiques du grand âge
A partir d’une expérience de psychologue
dans l’approche du « vécu » de personnes
âgées vulnérables et/ou dépendantes.
Françoise Lagabrielle
L’impensable
Ma mort ? Je suis vivante, c’est
l’impensable.
Anne Perraut Soliveres
Volonté et résignation
Deux façons d’aborder la fin de vie, l’une
debout, l’autre résignée.
Pierre Volovitch
La fin de vie sans maladie
Maintenant, ce sont des petits morceaux
de vie, de plus en plus petits, qui surnagent
dans une soupe de mort et tu voudrais faire
quelque chose, d’utile si possible…
Philippe Lorrain
Tante Marthe
Marc Jamoulle
Aider à vivre, aider à mourir
Voilà quatre décennies que je pratique la
médecine de famille et les accords tacites
entre mes patients et moi ont été
nombreux.
Martine Lalande
Sortie de scène
Judith Wolf
La fabrique sociale de la fin de vie
L’invention de la fin de vie configure un
temps et des relations sociales marqués
par la perspective de la mort à venir.
Didier Morisot
L’obsolescence programmée
Un peu de vitriol pour un système de santé
qui s’éloigne de ses valeurs.
Sylvie Cognard
Testament
Yacine Lamarche-Vadel
Quand la mort est à réanimer
Parfois la mort ne signifie pas la fin…
Philippe Lorrain
Suicide mode d’emploi
Zoéline Froissart
La fin de vie… pour qui ?
Agir sans se poser de question ?
Bastien Doudaine
Tenir la main de Victoire
C’est ce soir-là que j’ai compris ce que
signifie « soigner ».
Anne Perraut Soliveres
La violence n’épargne pas la fin de vie
Quand la fin de vie sert la vengeance.
Jean-Luc Landas
Dien Bien Phu
Prise en charge ou obstination
déraisonnable ?
Marie Kayser
Aide à mourir ?
Les réponses à cette demande sont bien
différentes si la personne habite en France
ou dans certains pays proches.
Denis Labayle
Des vies qui n’en finissent pas
L’affaire Lambert et l’affaire Bonnemaison :
deux victimes d’une idéologie imposée.
Philippe Lorrain
Pierre
Marie Kayser
La fin de vie et la loi
Au moment où une nouvelle loi sur la fin de
vie est annoncée, il est important de
connaître le cadre légal actuel et
les propositions des différentes instances.
Mathilde Boursier
Et si nous nous réappropriions
nos morts ?
La loi ne peut pas tout borner des histoires
humaines.
Yves Demettre
Pêle-mêle
Parcours d’un médecin de famille.
Véronique Bernard
Les ayatollahs des soins palliatifs
Quand la soi-disant « éthique » de vérité et
de respect n’est qu’un paravent de l’abus
de pouvoir médical.
Jean-Marc Grynblat, Irma Bonnet,
Delphine Lombard et Jacques Vilar
Monsieur F. vient de mourir
Respecter le choix du patient, une
discussion et un travail d’équipe.
Martine Lalande
Encore en vie, fin de droits
Anne-Gaëlle Andrieu et Jean Wils
Désigner une personne de confiance
Quand la désignation de la personne de
confiance est – au-delà d’une obligation
administrative – une réelle relation de soin.
Valérie Milewski et David Solub
Gravement malade
et sa vie devant soi ?
Immersion dans une terre où la consolation
scripturaire convole avec la clinique…
Françoise Ducos
Je consens et je désire
Martine Lalande
Où finir sa vie ?
Entourés ou pas, soignés jusqu’à quand,
comment vont mourir nos vieux ?
Martine Lalande
Transmission
Apprendre les soins palliatifs, en suivant
les patients.
SOMMAIRE
La fin de vie
DOSSIER
Comment aider les soignants et la société à accompagner ceux qui sont en fin de vie,
sans dogmatisme, dans la singularité de chaque histoire ?
12
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
40
41
42
44
47
48
50
52
54
55

Sylvie Guitton
La fin de vie : l’affaire de tous
Face à la souffrance spirituelle, le
témoignage d’un chemin de rencontre.
Sylvie Cognard
Accompagner la fin de vie
Chercher la ligne de crête entre l’envie de
vivre et l’envie de néant.
Jérôme Pellerin et Virginie Saury
(Se) soigner (de) la fin de vie des autres
Soigner des personnes en fin de vie en
institution demande une grande vigilance.
3JUILLET 2014 66 PRATIQUES
Christiane Vollaire
Mourir : violence et pacification
« Nous faisons partie les uns des autres »,
écrit Norbert Elias. C’est cette conviction
que la situation du mourant doit réactiver.
Angélique David
Soutenir dans la durée
Je fais au mieux pour que les gens oublient
qu’ils vont mourir. J’essaie de leur apporter
un peu de gaieté, de plaisir.
Séraphin Collé et Brigitte Galaup
C’est plutôt mal barré…
Le réseau de soins palliatifs, un tiers qui
peut apaiser les tensions familiales.
Bernard Vigué
Travailler ensemble à l’hôpital
Pour donner toutes ses chances à
un patient, il faut dépasser les craintes que
son état nous inspire.
Adrian David
Protocole LATA
Difficile de rester « Candide ».
Brigitte Brunel
Le père va mourir… le père est mort
Le père a presque 90 ans, et là, il semble
qu’il arrive au bout… Au bout de quoi,
finalement ? De sa vie ? De son chemin ?
De ses jours ?
Sylvie Cognard
La leçon d’Emma
« Porter la main sur soi ».
Anne Perraut Soliveres
Jusqu’au bout…
Il est très difficile pour le soignant de parler
de la mort avec le patient.
Annie Trebern
Un combat perdu ?
En supprimant la parole, on prive de sens
un travail relationnel qui se trouve réduit à
sa plus simple expression : celle de l’acte
et de son contrôle.
Sophie Crozier
Décider du handicap inacceptable ?
Peut-on décider d’arrêter certains
traitements au nom d’un risque de
handicap « inacceptable » ? Existe-t-il
des vies qui ne valent pas ou plus la peine
d’être vécues ?
SOMMAIRE
MAGAZINE
A
Pour ce dossier la rédaction expérimente une nouvelle forme de communication en partageant ses réflexions qui ponctuent le dossier :
pages 13, 41, 43, 55, 61, 64, 65, 69, 71, 78, 81.
56
59
60
62
65
66
68
70
72
76
79
80
82
6
IDÉES
Entretien avec
Paul Machto
Hommage à Jean Oury
Un psychiatre évoque tout ce qu’il doit à la démarche de Jean Oury, dans sa façon de
mettre en œuvre l’engagement, le climat du soin, le souci du collectif et du politique.
86
ECONOMIE DE LA SANTÉ
Pierre Volovitch
Non recours versus rustine
La question de fond est : comment améliorer le niveau de prise en charge de l’Assurance
maladie ?
87
MÉDICAMENTS
Martine Lalande
Spéculation sur l’hépatite C
Un nouveau traitement pour l’hépatite C, source de profit maximum pour le laboratoire.
88
LANCEURS D’ALERTE
Sylvie Cognard
Les lanceurs d’alerte
Quelle protection pour celles et ceux qui divulguent des faits menaçant le bien commun ?
91
NOUS AVONS LU POUR VOUS
Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir :
La place du sujet
en médecine
par Olivier Maillé,
« Considérant qu’il est plausible que de tels
évènements puissent à nouveau survenir », Sur l’art municipal de détruire un
bidonville
de Sébastien Thiery,
Intelligents, trop intelligents ?
de Carlos Tinoco
et
A Hambourg peut-être
de Denis Labayle, ainsi que l’article «Misfearing » – culture,
identity and our perceptions of health risks, par Lisa Rosenbaum (NEJM).

4
PRATIQUES 66 JUILLET 2014
est né en 1954 à Nantes. Il vit et travaille à Villejuif dans la région pari-
sienne. Après des études médicales et trois ans d’exercice de la
médecine générale, il étudie la photographie à l’École Nationale Supé-
rieure de la Photographie à Arles de 1986 à 1989. Il s’installe ensuite
dans le Nord de la France où il développe un vaste projet photo-
graphique, entamé plus tôt en photographiant des visages de
Vieillards, de Nourrissons et d’Aliénés, ce qui l’amènera à travailler
pendant deux ans à Calais pour réaliser la série Adolescents. Celle-ci
sera suivie de différents autres projets, dans une prison (Détenus), à
l’hôpital public de Maubeuge pour Nés, au Portugal pour Ouvriers. Ce
projet entend ressaisir une idée de notre monde à travers les visages
en transformation et dans les marges de différents groupes de
personnes immergées pour tout ou partie de leur existence dans
différents systèmes institutionnels, politiques et économiques.
Il entame aussi dans les années 1990 une longue série sur les chan-
tiers d’institutions culturelles puis se consacre à divers projets sur des
paysages et différents lieux dont la topologie et l’histoire sont en lien
avec des questionnements relatifs à la société civile : le port de Porto,
les champs de batailles en Écosse, la ligne de démarcation à Chypre,
et trois sites industriels abandonnés par la Chine après la chute des
blocs en 1990 en Albanie. Récemment, John Brown’s Body aux États-
Unis (2010), Dans Paris (2011), Vider les lieux à Istanbul (2013), mettent
en images un état de ses questionnements politiques et esthétiques
en regard des transformations économiques et politiques de notre
temps.
Parallèlement, Philippe Bazin engage un travail vidéo au début des
années 2000 dans une perspective non cinématographique, très
proche de la photographie, fait de plans fixes de longue durée et
concernant aussi bien des visages que des paysages, rendant compte
des intrications esthétiques de ces deux champs de recherche.
Ainsi, le photographe et maintenant vidéaste construit-il un vaste pro-
jet documentaire sur l’état de notre monde à travers divers lieux insti-
tutionnels traversés aussi bien par les visages de ceux qui les habi-
tent, que par les environnements que ces institutions et la vie de la Cité
modèlent et transforment.
Son travail a été présenté récemment aux Rencontres Internationales
de la Photographie à Arles (2012), dans le cadre de Marseille 2013, et
du 3 au 31 juillet 2014 chez l’éditeur-galerie LOCO à Paris.
Plusieurs ouvrages monographiques rendent compte de ses photo-
graphies, notamment Faces publié aux éditions de l’École Nationale
de la Santé Publique à Rennes en 1990, ainsi que La Radicalisation du
monde paru en 2009 avec des textes de Christiane Vollaire et Georges
Didi-Huberman chez LOCO. Sa thèse de médecin a été publiée au
Cercle d’Art sous le titre Long Séjour en 2010 ; son travail commun
avec Christiane Vollaire, Le Milieu de nulle part, en 2012 aux éditions
Créaphis.
Vient de paraître Reconstructions, publié par la Galerie Marcel
Duchamp à Yvetot en mai 2014.
Philippe Bazin a reçu en 1999 le prix Niépce.
www.philippebazin.fr
www.editionsloco.com
Philippe Bazin

5JUILLET 2014 66 PRATIQUES
Philippe Bazin
LA FIN DE VIE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
1
/
102
100%