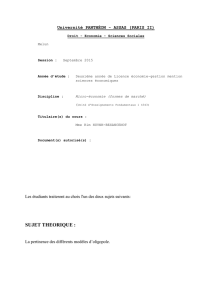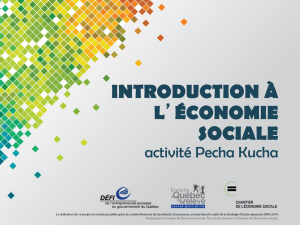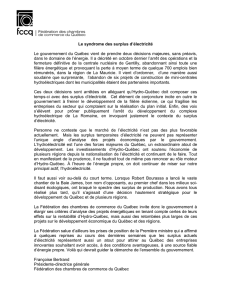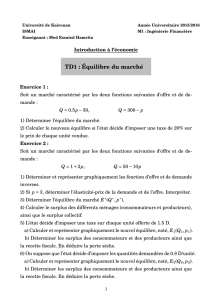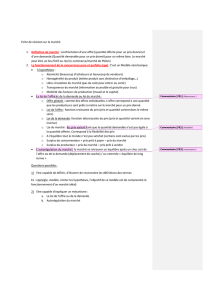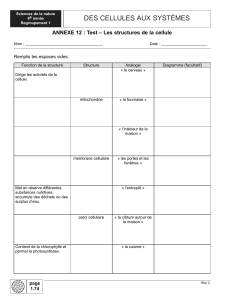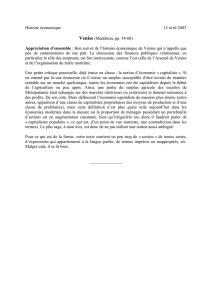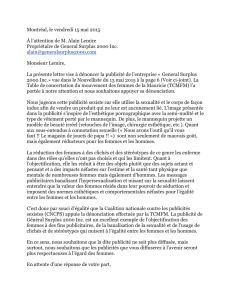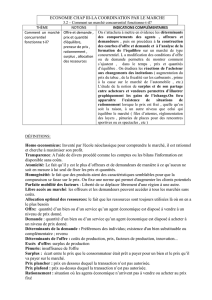la valeur ajoutee economique d`une organisation d`economie sociale

LA VALEUR AJOUTEE
ECONOMIQUE D’UNE
ORGANISATION D’ECONOMIE
SOCIALE
Michel Garrabé
michel.garrabe@univ-montp1.fr
Octobre 2001
GROUPE DE RECHERCHE EN ECONOMIE SOCIALE

2
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : Valeurs économiques sociale, sociétales et principes
d’évaluation.
1- Economie sociale, tiers secteur, économie solidaire et OES
2-Valeur ajoutée économique, sociale et sociétale.
3- Problématique de la valeur en économie sociale.
4-Valeur et évaluation économique et sociale.
5-Méthodes d’évaluation de l’utilité d’une OES.
DEUXIEME PARTIE : Les surplus ou la valeur sociale d’une OES
1- Identification et mesure des surplus directs.
11-Le surplus de solidarité
.
12-Le surplus de flexibilité
13-Le surplus de réversibilité
14-Le surplus d’aménité
15-Le surplus de bénévolat
2- Identification et mesure des surplus directs : Les coûts évités.
21-Le coût public évité
.
22-Le coût social évité
TROISIEME PARTIE : Evaluation du surplus de solidarité, surplus cognitif et surplus
d’aménité : formulation et application à la mesure de la valeur ajoutée d’une
association culturelle.
1-Les variables et la formulation
11-Les variables
12-La formalisation
2-Application au cas d’une association.
21-Calcul de la valeur totale du service pour un bénéficiaire (i)
22-Valeur d’une séance pour un adhérent non militant (j)
23-Valeur d’une séance pour un adhérent militant (z)
24-Les contreparties de la production de valeur.
QUATRIEME PARTIE : Evaluation des coûts publics et coûts sociaux évites : le cas
d’une association intermédiaire.
1-Les variables et la formulation
11-Définition et caractéristiques juridiques d’une A.I.
12-Les variables de la production nette d’une A.I
13-Identification des coûts-avantages du fonctionnement d’une A.I.
14-Identification des composantes de la production d’une A.I.
15-Formulation du coût public évité net complet d’insertion.
151-Les effets de l‘insertion dans le cas du RMI.
152-Les effets de l‘insertion quelque soit la forme d’allocation reçue
16-Les effets du salariat des personnes accueillies

3
17-Formulation du coût social évité.
171-Identification des fonctions d’ASI.
172-Identification des effets et des coûts sociaux évités de l’action d’ASI
173-Formulation
18-Valeur totale de l’action d’une A.I.
2-Application à l’A .I.. PEGASE.
21-Usagers concernés par l’action de l’A.I. en 2000.
211-Les personnes INSEREES
212-Les personnes SALARIES.
213- Les personnes ACCUEILLIS.
22-Conventions, Subventions et Exemptions perçues par l’AI. En 2000.
23-Simulation de base hors CSE.

4
INTRODUCTION.
Le capital démocratique et son patrimoine institutionnel et culturel, sont des actifs précieux
dans nos sociétés. Leur production et leur préservation résultent d’un long processus de
développement dont le coût matériel et humain est incommensurable.
Le secteur de l’économie sociale et solidaire participe de façon décisive de la durabilité du
capital démocratique. Mais l’action de ce secteur va naturellement très au-delà. Son spectre
d’activités est considérable, ce qui en fait un domaine privilégié du développement des
méthodes d’évaluation économique, chargées d’en mesurer les effets collectifs.
Notre objectif dans ce travail est de réfléchir, d’une part, à la pertinence de l’utilisation des
méthodes traditionnelles de l’évaluation économique des activités marchandes et non
marchandes, au domaine de l’économie sociale, d’autre part de proposer quelques
indicateurs d’évaluation et d’en présenter une première formulation.
Il existe trois options d’évaluation classiques, l’une macroéconomique, l’autre
microéconomique, la troisième mésoéconomique
1
. La première ne nous paraît pas permettre
de nous interroger sur la nature et la mesure de la valeur ajoutée sociale. Ne retenant que
des agrégats de la comptabilité nationale et publique, elle permet d’étudier, au mieux, les
modalités et flux de financement ainsi que l’existence d’équilibres financiers d’une partie du
secteur. Par contre l’approche microéconomique renseigne sur les composantes, très
diversifiées, de la production du secteur et autorise le développement de tentatives de
quantification.
Nous retiendrons donc cette dernière approche, en proposant une tentative de
conceptualisation de cette valeur sociale (sociétale) en termes de surplus directs et indirects
enfin de tenter d’appliquer les principes et concepts retenus à des situations complexes
concrètes.
Nous identifierons dans ce document comme surplus directs quatre modalités de variation
de la situation collective, que nous nommerons surplus de solidarité, de flexibilité, de
réversibilité et d’aménité. Le surplus indirect concernera ce que nous avons identifié comme
le coût évité qu’il soit public ou social.
Cette démarche constitue la suite d’une réflexion commencée avec un travail sur la région
Languedoc-Roussillon et poursuivie dans le cadre d’un groupe de recherche sur la valeur
ajoutée sociale (sociétale) à l’Université de Montpellier.
1 Nous avons retenu cette approche dans notre travail : Evaluation économique du secteur de
l’économie sociale en Languedoc-Roussillon Région L.R. Ocobre 1999, (155p).

5
I- VALEURS ECONOMIQUES, SOCIALES, SOCIETALES ET PRINCIPES
D’EVALUATION.
Il nous a paru nécessaire, préalablement à la proposition de nouveaux instruments
d’évaluation, de préciser le sens d’un certain nombre de termes que nous allons utiliser dans
ce travail.
1-Economie marchande, non marchande et non monétaire.
L’économie marchande monétaire correspond à l’espace occupé par le marché, c’est le lieu
des échanges monétaires.
L’économie non marchande monétaire serait identifiée à l’économie de la redistribution
publique et privée
2
.
L’économie non marchande non monétaire serait l’espace de l’économie solidaire et de
l’économie domestique.
Cette typologie ne comprend pas une partie importante de ce que les économistes appellent
le hors marché, qui comprend ce qui relèvent notamment des marchés de substitution.
2- Economie sociale, tiers secteur, économie solidaire et OES.
L’économie sociale est un espace d’activités à lucrativité limitée et à profit non partagé,
producteur de biens et de services collectifs ou privés, marchands ou non, à financement
marchands ou non.
Le tiers secteur est un espace productif, à lucrativité limitée et à profit non partagé délimité
par une production de capital social compensée par des financements hors marché
(exemptions et subventions). Ses unités de production peuvent être privées ou sociales, et
ses productions marchandes ou non.
L’économie solidaire est un espace d’activité sans lucrativité, caractérisé par la mise à
disposition, intra-communautaire de la part de chacun des membres de ses possibilités de
financement et de ses moyens de production.
Une organisation d’économie sociale (OES) : « Une coalition d’individu qui s ‘associent afin
de s’offrir et de fournir à d’autres des biens ou des services qui ne sont offerts de façon
adéquate ni par les organisations lucratives ni par les organisations publiques
3
».
3-Valeur ajoutée économique, sociale, et sociétale.
Nous proposons de considérer que la production nette des OES peut être regroupée en trois
catégories de valeurs ajoutées.
Une valeur ajoutée économique, constituée des flux nets de marchandises et de services
issue des productions marchandes.
2 J.L.Laville (2001): Les raisons d’être des associations in Association, démocratie et société civile : La
découverte/Mauss/CRIDA (pp61-140).
3 Ben-Ner A et Van Hoomissen T (1993) : Non profit organisations in the mixed economy in Ben Ner in
the mixed economy: The University of Michigan Press.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%