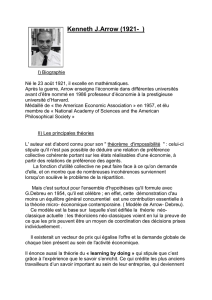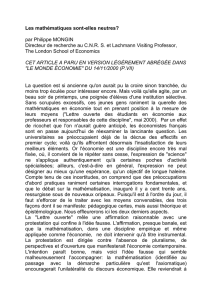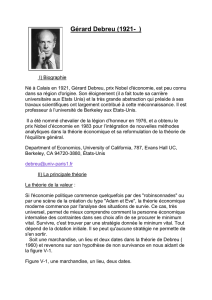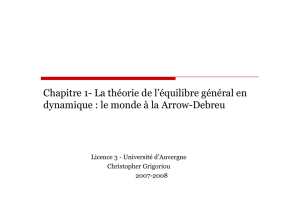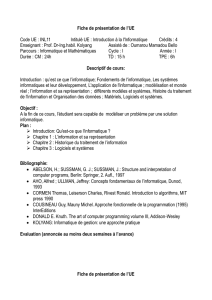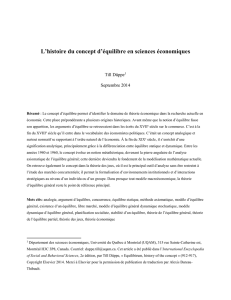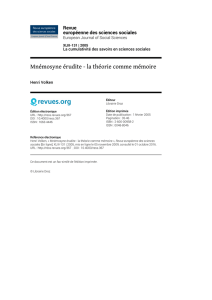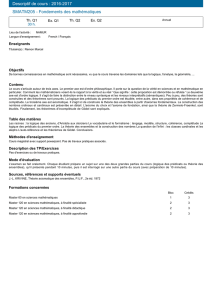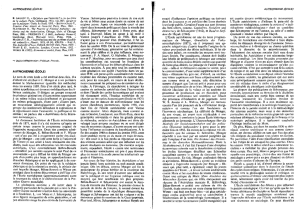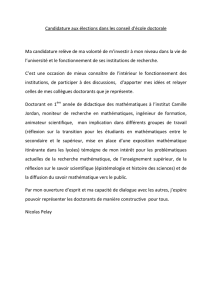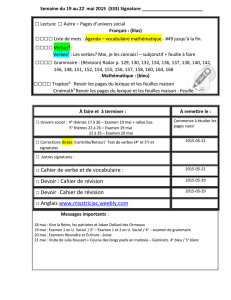L`axiomatique dans les preuves d`existence d`un équilibre général

Université Paris 1
UFR 02 Sciences Economiques
Master THEME (Théorie, Histoire et Méthodes de l’Economie
Spécialité « Economie et Sciences humaines : Epistémologie, Méthodes et Théories »
L’axiomatique dans les preuves
d’existence d’un équilibre général,
chez Arrow et Debreu
Présenté et soutenu par :
Aurélien Goutsmedt Directeur de Recherche :
Juin 2013 Jérôme Lallement

1

2
L’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne n’entend donner aucune approbation, ni
désapprobation aux opinions émises dans ce mémoire ; elles doivent être considérées comme
propre à leur auteur.

3
L’axiomatique dans les preuves
d’existence d’un équilibre général,
chez Arrow et Debreu

4
Table des matières
Introduction générale ............................................................................................................................... 6
Qu’est-ce que l’axiomatique ? ........................................................................................................... 10
Quel cadre épistémologique pour étudier les relations entre économie et mathématiques ? ............ 11
L’étude des critères de justification .............................................................................................. 11
Image du savoir et corps du savoir ............................................................................................... 12
L’apport du concept de Style de pensée ........................................................................................ 15
Objet d’études et problématique ........................................................................................................ 17
Plan et méthodes ............................................................................................................................ 18
Chapitre I : Perspectives épistémologiques de l’axiomatisation ........................................................... 20
I – Genèse et développement de l’axiomatique ................................................................................. 20
A) La rupture d’avec l’axiomatique des Anciens ....................................................................... 21
B) Le développement de l’axiomatique des Modernes ............................................................... 23
C) Du programme de recherche Hilbertien au théorème d’incomplétude de Gödel ................. 26
II – L’axiomatisation des mathématiques : l’émergence d’une nouvelle épistémologie ................... 31
A) La distinction entre contenu logique et contenu interprétatif ............................................... 31
B) Le progrès dans une théorie axiomatisée .............................................................................. 33
C) L’interprétation d’un système axiomatique ........................................................................... 34
Conclusion ......................................................................................................................................... 35
Chapitre II : Le développement de la méthode axiomatique, en économie ........................................... 38
I – Le rôle de Vienne, dans les années 1930, dans le développement de la méthode axiomatique en
économie ........................................................................................................................................... 38
A) Le colloque mathématique de Karl Menger .......................................................................... 39
B) Vers le développement de la théorie des jeux ........................................................................ 45
II – La « révolution formaliste » aux Etats-Unis à partir des années 1940 ....................................... 50
A) Un mouvement général vers une plus grande « rigueur » logique et mathématique ? ......... 51
B) La Cowles Commission, vecteur du changement .................................................................. 53
III – Les caractéristiques de la méthode axiomatique en économie .................................................. 57
A) Quel héritage de Hilbert ? ..................................................................................................... 57
B) Les axiomatiques ensemblistes de la science économique .................................................... 59
C) La cohabitation de deux points de vue divergents ? .............................................................. 61
Conclusion ......................................................................................................................................... 64
Chapitre III : Arrow-Debreu (1954), un article révélateur .................................................................... 66
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
1
/
113
100%