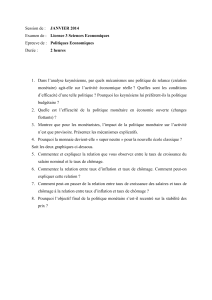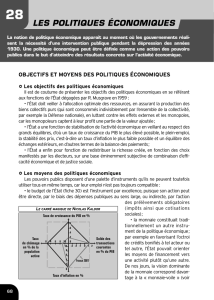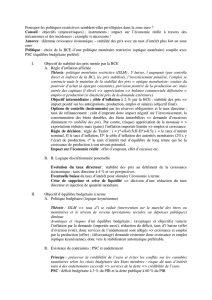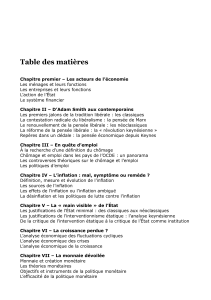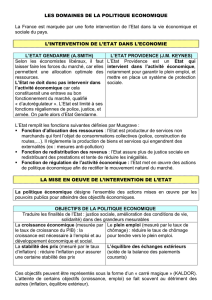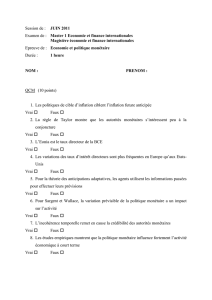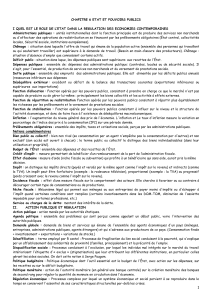Résumé Module 4 Partie 2 chapitre 3

ESH ECE2 Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
1
Résumé Module 4 Partie 2 chapitre 3
Les politiques des stabilisations du cycle économique
Introduction (rappels)
En introduction du chapitre sur l’allocation des ressources, nous avons vu, à partir de la présentation
de Musgrave, que l’on pouvait distinguer trois domaines d’intervention de l’Etat :
- Lorsque l’Etat intervient dans l’allocation des ressources nous savons que la justification
économique s’appuie sur le concept de défaillances de marché. Nous savons aussi qu’il faut
expliquer cette intervention parce que les AE sont victimes de biais cognitifs ou de schizophrénie
temporelle, que l’Etat peut également endosser le rôle « d’Etat paternaliste », mais aussi parce que la
société exprime des préférences pour la production publique de certains biens ou services (par
exemple, l’éducation pourrait être produite par la sphère marchande de manière totalement dérégulée,
mais cela n’est jamais le cas dans les PDEM où l’on observe toujours une organisation scolaire
publique).
Si l’on se focalise sur la réponse aux défaillances de marché, l’intervention de l’Etat sur l’allocation
des ressources doit donc permettre de mieux utiliser ses ressources (ses facteurs de production) : on
s’attend donc à ce que l’allocation des ressources se rapproche de l’optimum grâce à l’intervention
publique. Mais on sait aussi qu’il est nécessaire de discuter de la capacité de l’Etat à être efficace et à
agir pour l’intérêt général, car il existe des défaillances de l’Etat.
- Lorsque l’Etat intervient pour réguler le cycle économique, il cherche à réduire l’écart entre la
production réelle et la production potentielle (entre ce que l’activité de l’économie à un moment
donnée et ce qu’elle serait susceptible de réaliser si elle utilisait pleinement tous ses facteurs de
production).
Comme le rappelle Bénassy-Quéré dans son manuel Politique Economique, il est possible de
distinguer ces deux types d’intervention : en intervenant sur l’allocation des ressources on s’attend à
une meilleure allocation des ressources, et donc à une hausse de la croissance potentielle. L’horizon
temporel de cette intervention est plutôt le long terme. En intervenant sur les fluctuations, l’objectif
est avant tout de réduire l’écart de production. L’horizon temporelle de cette intervention est plutôt le
court terme.
Par ailleurs, l’intervention sur l’allocation des ressources porte notamment sur les incitations
(incitation à innover, incitation à investir, …), elle s’adresse donc plutôt aux producteurs, c’est-à-dire
à l’offre. L’idée étant finalement que la croissance potentielle d’une économie dépend de ce qu’elle
est capable de produire (offre). Du côté de la stabilisation par contre, le point de départ est de
constater que l’économie n’utilise pas toujours tous ses moyens de production (situation de sous
utilisation des capacités de production / de chômage par exemple) parce que la demande est
insuffisante. Réguler le cycle économique consiste donc à stimuler (ou freiner) l’activité (la demande)
pour que l’écart de production soit toujours le plus faible possible.
Cette première manière de présenter ces deux domaines de l’intervention de l’Etat conduit donc à
séparer assez nettement ces deux types d’approche. Pourtant, nous verrons à la fin de ce chapitre
qu’établir une frontière entre ces deux politiques n’a pas de sens, et que l’augmentation de la
production potentielle dépend en partie de la situation de l’écart de production au cours du temps.
Sans rentrer dans les détails, l’idée est simple : plus l’écart de production est important, qu’il dure
longtemps, plus cette situation s’accompagne de faibles incitations à investir, à innover et donc à
accumuler du capital physique et technologique, et plus le chômage de longue durée détruit du capital
humain. Au final, ne pas agir à court terme pour réduire l’écart de production conduit à plus long
terme à réduire le potentiel de croissance.
- Lorsque l’Etat intervient dans la répartition des revenus, il le fait pour réduire la pauvreté ou les
inégalités. Son intervention s’appuie sur une définition de la justice sociale. On peut alors discuter sur
la relation entre inégalités et croissance économique, en se demandant s’il existe un dilemme
efficacité/inégalités ou si, au contraire, il est possible d’avoir en même temps davantage d’efficacité
économique et d’avantage de justice sociale.

ESH ECE2 Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
2
On distingue deux types de politiques de régulation du cycle économique : la politique monétaire et
la politique budgétaire.
Ce domaine de l’intervention publique prend racine dans la révolution keynésienne des années 1930
en réaction aux politiques menées durant la Grande dépression. Au lendemain de la seconde guerre
mondiale émerge un consensus selon lequel l’Etat doit intervenir davantage dans l’économie en
empêchant des situations de chômage de masse et de spirale déflationniste.
L’économie néoclassique se met à intégrer certains éléments de la pensée keynésienne, ce qui aboutie
au développement du keynésianisme de la synthèse (P.Samuelson ; R.Solow).
Ce keynésianisme s’appuie sur l’idée « néoclassique » selon laquelle les marchés peuvent être à
l’équilibre, mais que dans certains cas cet équilibre peut être atteint grâce à des interventions
monétaires ou budgétaires de l’Etat. Ce dernier peut en effet stimuler ou freiner l’activité économique
grâce à des politiques macroéconomiques conjoncturelles.
C’est véritablement le point de départ de cette problématique de la régulation du cycle économique.
1. L’intervention conjoncturelle de l’Etat : la politique monétaire
Etudier le rôle de la politique monétaire comme instrument de régulation des cycles économiques
conduit à séparer plusieurs périodes.
On peut distinguer :
- une première période, durant laquelle les pouvoirs publics s’appuient sur les politiques de
stop and go pour « rythmer » la croissance économique en évitant à chaque fois soit la
surchauffe, soit une récession trop marquée. Le but de cette politique est de permettre à la
croissance de rester sur « le fil du rasoir ». L’arbitrage inflation / chômage est central durant
cette période, ce qui signifie que la politique monétaire a deux objectifs, mais qu’elle ne peut
pas les atteindre en même temps. elle doit choisir soit l’un, soit l’autre.
- une seconde période s’ouvre avec les années 1970. L’entrée dans la stagflation (M.Friedman)
conduit à une remise en cause radicale des politiques d’inspiration keynésienne. L’arbitrage
inflation/chômage disparaît, car ces deux « maux » sont désormais simultanés. Face à la
montée inexorable du chômage, les gouvernements essaient de stimuler l’activité mais cette
stratégie conduit à davantage d’inflation sans aucun effet sur le chômage qui continue de
progresser. Le monétarisme devient alors la théorie économique dominante et conduit à une
rupture : la politique monétaire n’a plus désormais qu’un seul objectif, maîtriser l’inflation ;
- une troisième période apparaît alors à la fin des années 1980/début des années 1990.
L’inflation galopante des années 1970 a été vaincue et peu à peu l’augmentation du niveau
général des prix devient faible et stable. sous l’influence des travaux de la nouvelle économie
keynésienne, la politique monétaire retrouve un double objectif (contrôler l’inflation et
contrôle le chômage). Cette NEK fait cependant aussi la synthèse entre keynésianisme et
NEC : si l’arbitrage inflation/chômage est possible, il ne l’est qu’à CT et à condition qu’il
existe un chômage conjoncturel. A long terme, la flexibilité des prix et des salaires fait
disparaître cet arbitrage.
- Une quatrième période s’ouvre progressivement dans les années 1990. Elle part d’un constat
simple : lors d’un retournement d’un cycle économique, la politique monétaire devient
expansionniste (pour faire baisser le chômage et réduire l’écart de production) mais ce faisant
elle développe une dynamique de cycle financier qui abouti inexorablement à un « moment
Minsky » (le nom du retournement donné par M.Aglietta). La politique monétaire qui est une
réponse au cycle devient donc aussi l’élément déclencheur du cycle suivant. Pour le dire plus
simplement : en jouant son rôle de réponse au cycle conjoncturel, la politique monétaire
« fabrique » un nouveau cycle (cf la conséquence de la politique monétaire menée par
A.Greenspan en réaction à la crise de 2001 et qui va alimenter le cycle des subprimes). Ce
constat conduit à s’interroger sur les objectifs conjoncturels de la politique monétaire : doit-
elle simplement surveiller l’évolution du NGP des biens ou bien doit-elle aussi surveiller
l’évolution du NGP des actifs financiers ? Faut-il que la politique monétaire assure également

ESH ECE2 Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
3
la stabilité financière en plus de la stabilité des prix et de la réduction de l’écart de
production ? Cette question se pose dans un contexte de « disparition » de l’inflation : après
la période d’inflation faible des années 1990/2000, nous sommes aujourd’hui à la porte de la
déflation. Cela a une conséquence importante sur la politique monétaire : la création de
monnaie centrale ne se traduit plus par une hausse de l’inflation, mais par l’apparition de
bulles sur les actifs financiers. Ce constat renforce donc la question du la redéfinition des
objectifs de la politique monétaire aujourd’hui.
a. Première période : la politique monétaire dans le cadre des politiques de stop and go
La politique monétaire qui se met en place au lendemain de la seconde guerre mondiale s’appuie sur
les travaux de Samuelson.
Avec Phelps, il réinterprète la relation de Phillips qui relie variation des salaires et variation du taux
de chômage pour en faire la « courbe de Phillips » qui corrèle variation du NGP (donc inflation) et
variation du taux de chômage. Ce qui ressort ce cette courbe de Phillips, c’est que moins de chômage
se paie de plus d’inflation tandis que moins d’inflation conduit à davantage de chômage. Or, la
politique monétaire a la capacité de stimuler l’activité et en cela elle va impacter le chômage et
l’inflation (par le biais de la demande). Les autorités monétaires peuvent donc agir sur la conjoncture
en alternant stimulation puis freinage de l’activité.
Plus qu’une simple régulation du cycle, la politique de stop and go encadre l’évolution du rythme de
croissance en produisant des phases d’accélération puis des phases de freinage. La politique
monétaire, accompagnée de la politique budgétaire, ne se contente pas de « lisser » le cycle lorsque
des écarts apparaissent, elle est véritablement à l’origine des fluctuations économiques. On dit que la
politique conjoncturel est sur « le fil du rasoir » : elle doit éviter d’un côté la surchauffe et l’apparition
de l’inflation, et de l’autre, la récession et la montée du chômage. Cette gestion au fil du rasoir de la
conjoncture économique s’appuie sur un arbitrage inflation – chômage. Il n’est pas possible d’avoir à
la fois peu d’inflation et peu de chômage ; il faut donc alterner entre plus de chômage pour réduire
l’inflation et plus d’inflation pour réduire le chômage.
Chesney Martin Jr, gouverneur de la Fed durant les années 1950, comparait le Banque central a un
barman de soirée : il faut d’abord fournir de punch pour stimuler les convives, puis le retirer pour
éviter qu’ils ne soient souls.
1.2 Deuxième période : la politique monétaire, un unique objectif
A partir de la fin des années 1960, l’inflation a tendance non pas à fluctuer mais à croître ; nous
entrons dans l’ère de l’inflation galopante. Elle fini par atteindre 15% par an aux Etats-Unis à la fin
des années 1970 (22% en Italie). Cette accélération continue de l’inflation s’accompagne par ailleurs
d’une hausse du chômage. La situation macroéconomique est donc très différente de celle des années
1950/1960, puisque les autorités doivent faire face à plus de chômage et plus d’inflation en même
temps. Les politiques de stimulation qui sont menées pour freiner le chômage n’arrêtent pas sa hausse
tout en produisant de l’inflation, et les politiques de freinage ne stoppent pas l’inflation alors que le
chômage continue de croître. Bref, l’arbitrage inflation-chômage disparaît.
On doit à l’école monétariste une explication de cette période, que Friedman a appelé la stagflation.
Le schéma explicatif s’appuie sur l’idée que les AE découvrent peu à peu que la politique monétaire
expansionniste produit de l’inflation (l’illusion monétaire de départ disparaît progressivement). Ce
faisant ils modifient leur comportement, ce qui conduit à annuler l’effet sur l’activité qu’avait eu dans
un premier temps la politique monétaire. En renouvelant leur politique expansionniste pour lutter
contre le chômage, les banquiers centraux font augmenter la masse monétaire au-delà des besoins de
l’économie « réelle », ce qui provoque de l’inflation (théorie quantitative de la monnaie).
Par ailleurs, les autorités monétaires commettent une erreur d’analyse : elles cherchent à lutter contre
un chômage qu’elles analysent comme conjoncturel, alors que c’est le chômage structurel qui

ESH ECE2 Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
4
augmente sur cette période. Conséquence de cette erreur, la politique monétaire est totalement
inefficace pour faire baisser le chômage.
L’explication des monétaristes de la stagflation est donc la suivante : la politique monétaire
« fabrique » de l’inflation alors que le chômage structurel ne cesse de croître. Il y a donc bien à la fois
inflation et hausse du chômage.
Le raisonnement monétariste conduit à présenter une courbe de Phillips « augmentée des
anticipations » : une première période de court terme durant laquelle la relation inflation / chômage
est bien négative, mais la fin de l’illusion monétaire fait sortir l’économie du court terme, la politique
monétaire n’a alors plus qu’un seul effet : faire monter l’inflation. La courbe de Phillips devient
verticale à un niveau de taux de chômage naturel donné. Le fait que la monnaie n’a pas d’impact sur
le niveau d’activité et le chômage à LT conduit à la qualifier de « monnaie neutre ». Chez les auteurs
de la nouvelle économie classique, les anticipations étant « rationnelles », le temps d’illusion
monétaire disparaît : les agents anticipent immédiatement l’inflation dès l’annonce de la politique
expansionniste : ils cherchent tout de suite à se protéger de la perte de pouvoir d’achat. Ce
changement de comportement rend la politique monétaire totalement inefficace à court terme (puisque
la période d’illusion monétaire n’existe plus). C’est pourquoi chez les nouveaux classiques, on parle
de « monnaie super-neutre ».
La pensée monétariste va alors influencer les politiques monétaires qui vont s’attacher à « vaincre »
l’inflation. Pour cela, il faut vaincre les anticipations d’inflation (croyances que les AE ont sur
l’évolution future du NGP). Les monétaristes pensent qu’il suffit de s’appuyer sur une règle de
croissance monétaire pour empêcher les dérapages inflationnistes : le BC annonce un taux de
croissance de M1 et s’y tient durant la période. Mais le décloisonnement des marchés de capitaux
durant les années 1980 rend les frontières entre M1 (monnaie totalement liquide) et M2 et M3
(monnaie détenue sous des formes de moins en moins liquides) de plus en plus poreuses, et donc cette
technique peu efficace. Résultat, la capacité de la banque centrale à contrôler strictement la masse
monétaire est remise en cause. C’est pourquoi les BC vont plutôt s’appuyer sur la cible d’inflation
pour maîtriser l’inflation. Il s’agit de rapprocher les anticipations d’inflation de l’inflation qui est visée
par la banque centrale de manière à ce que le taux directeur (fixée par la BC à court terme) soit égal au
taux d’intérêt de long terme qui découle des anticipations des agents. Lorsque les deux taux divergent
c’est que les anticipations des agents ne correspondent pas à l’inflation visée par la banque centrale ;
par exemple, si le taux de long terme est supérieur au taux directeur de court terme, cela signifie que
les AE anticipent une inflation supérieure et qu’ils rajoutent donc au taux de court terme une prime
équivalente à l’inflation qu’ils anticipent. Comment arriver à contrôler ces anticipations d’inflation ?
La première possibilité consiste à faire ce que P.Volcker fera à la tête de la Fed au début des années
1980 ou J.C.Trichet quelques années plus tard à la tête de la Banque de France : adopter une politique
monétaire et ne pas en changer, quoi qu’il en coûte (en terme de croissance et de chômage), tant que
les anticipations d’inflation n’ont pas disparu. La seconde possibilité consiste à institutionnaliser
l’indépendance de la banque centrale. Cette indépendance permet à la BC d’éviter les décisions
politiques qui relèvent de ce que Nordhaus appelle le cycle politico-économique.
La période du début des années 1980 marque donc un tournant dans le fonctionnement de la politique
monétaire. La politique monétaire « keynésienne » est discréditée. On passe d’une d’un arbitrage
permanent inflation / chômage à un objectif unique pour la politique monétaire ; suivant en cela le
principe de Tinbergen : un seul objectif par politique économique. Cet objectif, c’est celui du
contrôle de l’inflation. La lutte contre le chômage est désormais confiée à la politique de l’emploi.
1.3 Troisième période : le retour de l’arbitrage inflation/chômage dans un contexte de
faible inflation
La fin des années 1980 marque une nouvelle inflexion dans les objectifs et le fonctionnement de la
politique monétaire. L’inflation galopante a été vaincue et les idées des économistes qualifiés de
nouveaux keynésiens s’imposent. Les économistes de la NEK (nouvelle économie keynésienne)
proposent un dépassement à la fois des idées keynésiennes des années 1950/1960 mais aussi des
travaux des monétaristes et de la nouvelle économie classique.

ESH ECE2 Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
5
Ils s’appuient sur la courbe de Phillips augmentée des anticipations pour montrer qu’il faut
effectivement distinguer ce qui se passe à court terme de ce qui se passe à long terme. Ils ne
remettent pas en cause l’idée de monnaie neutre à long terme, (c’est-à-dire qu’à LT, l’inflation est
toujours un phénomène monétaire et que la politique monétaire n’a pas d’impact sur le niveau
d’activité). Par contre, sur le court terme, ils renouent avec Keynes. A partir du concept de NAIRU
(Tobin), ils distinguent le taux de chômage structurel et le taux de chômage conjoncturel. Ils
considèrent qu’il est possible grâce à la politique monétaire de faire baisser le taux de chômage
conjoncturel : en réduisant l’output gap à zéro. Lorsque la croissance réelle est égale à la
croissance potentielle, c’est qu’il ne reste que du chômage structurel et que le chômage conjoncturel a
disparu.
Le raisonnement est donc le suivant : il existe un output gap négatif (croissance réelle inférieure à
croissance potentielle), la politique monétaire mise en place est expansionniste, la création monétaire
stimule les échanges, mais les prix et les salaires sont rigides à court terme ; durant cette période de
rigidité, les agents économiques ne subissent donc pas l’inflation, le surplus d’activité fait baisser le
chômage conjoncturel, qui se rapproche peu à peu du chômage structurel. Progressivement tout en se
rapprochant du chômage structurel, l’inflation apparaît. Durant cette période de transition, moins de
chômage signifie plus d’inflation. C’est le cas keynésien traditionnel. Mais dès que le taux de
chômage atteint son niveau structurel, le taux de chômage ne baisse plus. Continuer la politique
monétaire ne peut alors que se traduire par plus d’inflation. On retrouve le cas monétariste.
Finalement, on distingue trois moments : celui durant lequel, le taux de chômage baisse mais cela a
peu d’impact sur l’inflation (la partie presque horizontale de la courbe de Phillips), puis celui où cette
baisse provoque davantage d’inflation (la courbe de Phillips devient de plus en plus négative) et enfin
celui où la baisse du chômage est nulle mais l’inflation est forte (la courbe de Phillips est verticale).
L’intérêt de cette analyse de la NEK est finalement de montrer que les autorités monétaires doivent
arbitrer entre réduction de l’output gap et contrôle des anticipations d’inflation. Elles savent que
plus l’output gap se réduit plus les anticipations d’inflation vont augmenter.
Si la baisse du chômage se paie par peu d’inflation au départ lorsque le chômage conjoncturel est
élevé, ce n’est plus le cas lorsqu’il diminue et que ne reste plus que du chômage structurel.
La NEC réhabilite l’arbitrage inflation-chômage jusqu’au moment où le chômage conjoncturel a
complètement disparu. A partir de ce point, seule la maîtrise de l’inflation compte (il faut éviter que
les anticipations d’inflation dérapent) ; et vouloir diminuer le chômage structurel nécessite une
politique de l’emploi.
En conséquence, les années 1990/2000 voient se développer une politique monétaire qui combinent
réduction de l’écart de production et contrôle de l’inflation (par le contrôle des anticipations des
agents). Il est possible de « vérifier » à postériori ce type de stratégie des banques centrales en utilisant
« la formule de Taylor ». Cette formule de Taylor permet de calculer un taux d’intérêt « théorique »
qui serait le taux optimal découlant d’un arbitrage entre l’écart de production et l’écart entre les
anticipations d’inflation des AE et la cible d’inflation désirée par la BC. Par exemple, si l’écart de
production est faible mais que les AE ont des anticipations d’inflation qui s’écartent de la cible visée
par la banque centrale, cette dernière sera amenée à remonter son taux directeur, et le taux directeur
« théorique » doit augmenter.
En comparant ce qu’auraient du faire les banques centrales, compte tenu des circonstances et de leur
objectif de cible d’inflation, et ce qu’elles ont choisi de faire réellement, Taylor constate qu’en réalité
le taux « théorique » et le taux réellement utilisé sont très proches.
Cela montre bien que les banques centrales ont continué sur cette période à arbitrer de la manière
suivante : réduire l’output gap (faire baisser le chômage conjoncturel) nécessite de réduire le taux
directeur, mais cela fait augmenter les anticipations d’inflation qui s’écartent de la cible, ce qui
conduit la BC à resserrer ses taux, les anticipations se callent sur la cible mais au prix d’un output gap
croissante (hausse du chômage) ; la banque centrale réagit alors en faisant baisser son taux, etc …
cf le document 12 du cours qui montre que la Fed suit bien la règle de Taylor de 1998 à 2008. La Fed
détermine son taux d’intérêt en fonction de la position de l’écart de production et de l’inflation,
sachant que les deux varient en sens inverse. On retrouve bien l’arbitrage inflation/chômage.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%