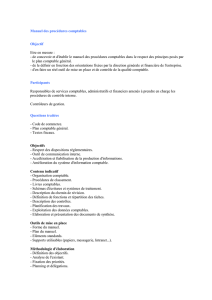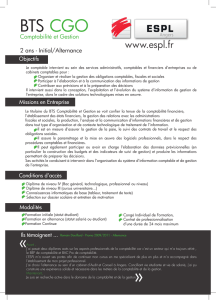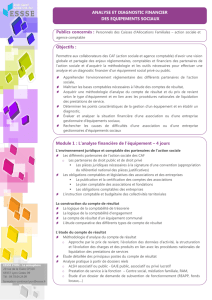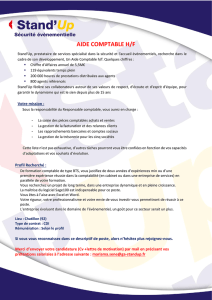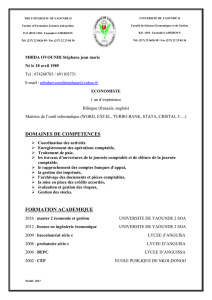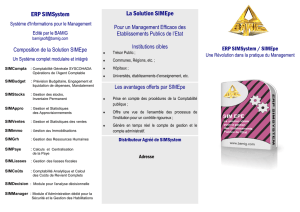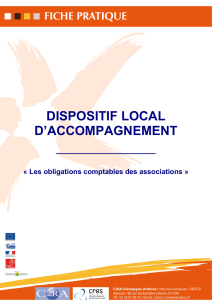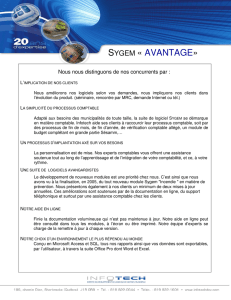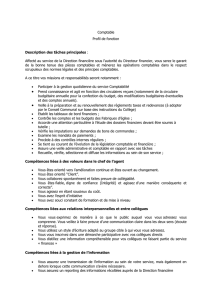FINANCES PUBLIQUES

Cours de Claude Wittebroodt, SGASU, pour le bureau de la formation des personnels de l'administration centrale DPMA C3,
2005
1
1
FINANCES PUBLIQUES
COURS N° 2 : L’EXECUTION BUDGETAIRE
Plan du cours n° 2
I. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
II. Les ordonnateurs et les comptables : définition et responsabilités
III. Les phases de la dépense et de la recette
IV. Les documents comptables
I. Le principe de séparation
des ordonnateurs et des comptables
Ce principe, de droit public, se trouve énoncé à l’article 20 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : il indique que
"les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles" ; c’est pourquoi
les opérations de la comptabilité publique (dépenses et recettes) se trouvent exécutées
par 2 catégories d’agents publics qui ont des missions et des responsabilités différentes
et se contrôlent les uns les autres.
Ce principe connaît des dérogations (les régies de dépenses et de recettes que nous
étudierons ultérieurement) et des aménagements, plus particulièrement au sein des
établissements de l’éducation nationale où il est courant que ces 2 fonctions soient
confiées à la même personne.
Il s’agît alors néanmoins de 2 fonctions différentes, même si elles sont confiées au
même agent :
● Celui-ci est dans la première fonction ordonnateur délégué, chef des services financiers
situé hiérarchiquement sous la responsabilité de l’ordonnateur dont il prépare le budget
et en suit l’exécution. Il n’est dans cette fonction que titulaire d’une délégation de
signature à titre personnel et n’agît pas en son nom propre.
● Il est dans sa deuxième fonction agent comptable à part entière. Il se trouve alors en
responsabilité directe, nommé avec l’accord du ministre des finances ; il n’est plus
soumis à l’autorité de l’ordonnateur qu’il assiste et contrôle.

Cours de Claude Wittebroodt, SGASU, pour le bureau de la formation des personnels de l'administration centrale DPMA C3,
2005
2
2
II. Les ordonnateurs et les comptables
7 questions sur les définitions relatives aux
ordonnateurs et aux comptables et à leurs
responsabilités
QUESTION II. 1 : Les ordonnateurs, qui sont-ils, que font-ils ?
● Ils prescrivent traditionnellement l’exécution des recettes et des dépenses
● constatent les droits des organismes publics,
● liquident les recettes
● engagent et liquident les dépenses (art 6 du décret du 29/12/1962).
Ce sont donc eux qui jugent de l’opportunité de la dépense et décident de la recette.
La LOLF, du fait de la globalisation des crédits et de leur fongibilité
au sein des programmes et des actions introduit de véritables
libertés de gestion en contrepartie d’une responsabilisation accrue
des gestionnaires et de l’obligation de rendre compte de la qualité
de leur action.
Des modifications dans les processus d’exécution des dépenses et des recettes
pourraient donc intervenir au fur et à mesure de l’application de la nouvelle
réglementation.
Ils sont :
● ordonnateurs principaux (les ministres, les élus - les maires, les présidents des
collectivités territoriales - les chefs d’établissements, …)
● ordonnateurs secondaires (le préfet, le recteur)
● ou ordonnateurs délégués (agents publics ayant reçu une délégation de signature).
Ils ne manient pas les fonds publics sauf dérogations très encadrées (les régies).
QUESTION II. 2 : les comptables, qui sont-ils, que font-ils ?
Ils sont chargés traditionnellement :
● de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes émis par les
ordonnateurs
● du paiement des dépenses
● de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
● du maniement des fonds
● de la conservation des pièces justificatives des opérations
● et de la tenue de la comptabilité.
La LOLF va leur donner de nouvelles attributions qui vont les
rapprocher de l’ordonnateur.

Cours de Claude Wittebroodt, SGASU, pour le bureau de la formation des personnels de l'administration centrale DPMA C3,
2005
3
3
Les nouvelles modalités de la gestion des crédits vont en effet les rendre responsables de
la qualité de la comptabilité. Ils devront désormais en conséquence :
● comptabiliser les recettes et les dépenses non seulement par nature mais également
par destination
● compléter l’enregistrement des flux d’investissement par la mesure du patrimoine
● et constater la dépréciation des actifs en liaison avec les procédures d’amortissement
(voir ci-dessous).
Ils sont :
● comptables principaux (cela signifie qu'ils rendent leurs comptes à la Cour des
comptes ou aux chambres régionales des comptes)
● comptables secondaires (leurs opérations sont centralisées par un comptable
principal)
● comptables délégués (ce sont des agents publics qui bénéficient d’une délégation de
signature ; ils prennent en général le nom de fondé de pouvoir).
Les comptes des comptables principaux sont jugés par la Cour des comptes ou les
chambres régionales des Comptes. Ils sont responsables des écritures passées par les
comptables secondaires dont ils centralisent les opérations.
QUESTION II. 3 : quelles sont les responsabilités des ordonnateurs et des
comptables publics ?
Ces 2 catégories de personnel supportent des responsabilités différentes, portant plus
particulièrement :
● sur la régularité des comptes pour les comptables
● et sur la qualité de la gestion pour les ordonnateurs.
Cette distinction pourrait se réduire du fait de l’intervention de la LOLF qui réintroduit la
notion de responsabilité individuelle concernant la qualité de la gestion publique.
a) Les responsabilités des ordonnateurs
● Les ministres, les membres du gouvernement, les élus, ont une responsabilité
politique devant les électeurs et les citoyens (celle-ci est prévue dans la Constitution
pour les ministres). La Constitution prévoit en outre (article 68-1) que les membres du
gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de
leurs fonctions et sont jugés par la Haute Cour de justice.
● Les ordonnateurs autres que les ministres ont une responsabilité disciplinaire , civile,
pénale et sont responsables de leurs fautes de gestion devant la Cour de discipline
budgétaire et financière. Lorsqu’ils sont constitués comme comptables de fait
1
, ils
peuvent être traduits devant la Cour des Comptes et les Chambres Régionales des
comptes.
b) Les responsabilités des comptables
1
Est comptable de fait l’agent qui, sans avoir la qualité de comptable public, s’est comporté, volontairement ou non, comme un
comptable, maniant les fonds publics en recettes ou en dépenses. Il est alors contraint de tenir une comptabilité retraçant très
précisément les mouvements de ces fonds, d’apporter la preuve qu’il n’y a pas eu de malversations, … Même dans ce cas il est
passible de sanctions prononcées par la Cour des comptes ou la Chambre régionale des comptes compétente.

Cours de Claude Wittebroodt, SGASU, pour le bureau de la formation des personnels de l'administration centrale DPMA C3,
2005
4
4
Quel que soit le lieu où ils exercent, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables, sur leurs biens propres et ceux de leur conjoint
(hypothèque légale) :
● du recouvrement des recettes
● du paiement des dépenses
● de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’Etat,
aux collectivités locales et organismes publics
● du maniement des fonds
● de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité
● ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.
Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics et des régisseurs
2
placés sous leur autorité ; elle peut être mise en jeu, concernant la gestion de leurs
prédécesseurs, pour les opérations prises en charge, dès lors qu’ils n’ont pas émis de
réserves lors de leur installation.
Les comptables publics dont la responsabilité pécuniaire est engagée (arrêt de mise
en débet pris par la Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes) ont
l’obligation de verser de leurs deniers personnels une somme égale au montant de la
perte subie par l’organisme.
Toutefois leur responsabilité ne peut être mise en cause pour des questions concernant
l’opportunité de la dépense, mais uniquement pour celles concernant la régularité de
celle-ci.
Outre cette responsabilité pécuniaire, les comptables publics peuvent également encourir
des sanctions disciplinaires et être mis en cause civilement ou pénalement en cas de
malversations.
QUESTION II. 4 : quels contrôles doit faire le comptable public ?
Nommés par, ou avec l’accord du ministère des finances, le comptable public est tenu,
avant de payer les dépenses ou d’encaisser les recettes, d’effectuer les contrôles suivants
(article 11 du décret de décembre 1962). Il doit :
● pour les recettes, vérifier la régularité des ordres de recettes, de leur annulation ou
de leur réduction, conformément aux textes et aux règlements en vigueur pour
l’organisme dans lequel il est nommé ;
● pour les dépenses, contrôler
- la qualité de l’ordonnateur (à un ordonnateur donné correspond obligatoirement un
comptable qui lui est assigné d’où la mention de "comptable assignataire")
- la présence des pièces justificatives
- la disponibilité des crédits
- la bonne imputation de la dépense
- la validité de la créance (justification du service fait, exactitude des calculs)
2
Lorsqu’un établissement public ne dispose pas d’un comptable sur place et afin de faciliter son fonctionnement quotidien,
l’ordonnateur peut, en accord avec le comptable et si son statut d’établissement en prévoit la possibilité, créer une régie : de
recettes s’il s‘agit de collecter des fonds (tickets de cantine par exemple), d’avance s’il s’agit d’effectuer de menues dépenses,
de régler de petits frais (papeterie par ex).
Cette tâche est confiée à un agent de l’ordonnateur qui est investi personnellement de cette fonction de régisseur sous la
responsabilité directe du comptable. L’agent doit alors se comporter comme un comptable public, tenir des écritures retraçant
les mouvements des fonds, … Il peut être soumis à un cautionnement, peut prendre une assurance et perçoit en contrepartie
de la responsabilité qui devient la sienne, une petite indemnité.

Cours de Claude Wittebroodt, SGASU, pour le bureau de la formation des personnels de l'administration centrale DPMA C3,
2005
5
5
- le caractère libératoire du règlement (qui doit solder entièrement la créance : un agent
comptable ne paye pas à tempérament !).
Il doit également s’assurer que les règles de prescription et de déchéance quadriennale
3
ne s’appliquent pas, qu’il n’y a pas d’opposition de la part d’un créancier du bénéficiaire
(liquidation judiciaire de l’entreprise ; nantissement du marché) ainsi que de
l’intervention des contrôles requis (contrôleur financier, TPG, …).
● pour le patrimoine, l’agent comptable doit s’assurer de la conservation des droits,
privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient le recueil et la
comptabilité matière.
QUESTION II. 5 : quelles sont les sujétions qui pèsent sur un comptable public ?
Compte tenu de l’importance de ses responsabilités, l’agent comptable, qui est
personnellement et pécuniairement responsable des opérations qui lui sont confiées, est
astreint à la constitution de garanties : il est soumis à un cautionnement qui doit garantir
l’établissement en cas de défaillance et à une prestation de serment. Il supporte
également une hypothèque légale sur ses biens propres et ceux de son conjoint.
Il peut souscrire une assurance pour des faits qui ne seraient pas de sa responsabilité.
L’agent comptable constitué en débet (c'est-à-dire à qui il manque de l’argent dans sa
caisse) peut obtenir, de la part du ministre des finances, une remise gracieuse de tout ou
partie des sommes dues, s’il peut prouver qu’il n’est pas responsable de ces
manquements.
QUESTION II. 6 : quelle est la différence pour un comptable public entre un
cautionnement et une assurance?
● Le cautionnement des comptables publics est obligatoire si le comptable n’en est pas
expressément dispensé (dans l’acte constituant la régie par exemple). Il sert cependant à
couvrir l’établissement contre les fautes de gestion imputables à l’agent comptable et non
sa personne.
● Par contre la prise d’une assurance par le comptable est facultative et sert à le couvrir
des pertes financières éventuelles s’il n’est pas responsable des difficultés rencontrées
(en cas de cambriolage par exemple).
QUESTION II. 7 : peut-on réquisitionner un comptable public ?
Lorsqu’un comptable public refuse de payer une dépense ordonnancée ou mandatée par
l’ordonnateur, il notifie à cet ordonnateur sa décision de refus en la motivant.
Si ce dernier maintient sa décision, il peut réquisitionner le comptable qui exécutera alors
l’opération, sauf :
● s’il y a insuffisance des crédits disponibles
● ou si les crédits sont irrégulièrement ouverts
● ou si l’imputation budgétaire ne correspond pas à l’objet de la dépense
● ou encore s’il constate une absence de service fait ou de caractère libératoire de la
dépense (le destinataire des fonds n’est pas le bon, par exemple).
3
Les dettes de l’Etat sont prescrites (c’est-à-dire éteintes), sauf en ce qui concerne les impôts, 4 ans après l’année au cours de
laquelle elles sont dues, lorsqu’il n’y a pas eu d’interruption par relance écrite du créancier, c’est ce que l’on appelle la
déchéance quadriennale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%