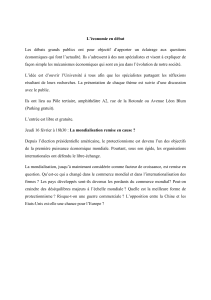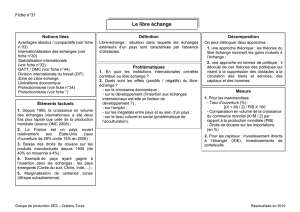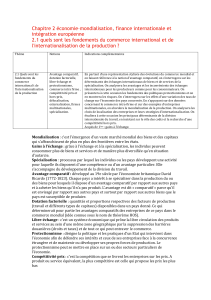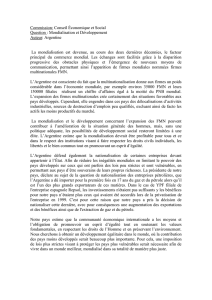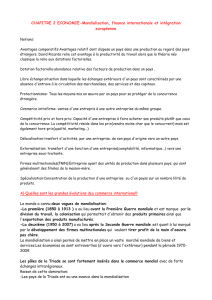CHAP.2 Economie : Mondialisation, finance internationale et

CHAP.2 Economie : Mondialisation, finance internationale et
intégration européenne
2.1 Quels sont les fondements du commerce international et
l’internationalisation de la production ?
Thème
Notions
Indications complémentaires
2.1 Quels sont les
fondements du
commerce
international et de
l’internationalisation
de la production ?
Avantage
comparatif,
dotation factorielle,
libre-échange et
protectionnisme,
commerce intra-
firme, compétitivité
prix et hors prix,
délocalisation,
externalisation,
firmes
multinationales,
spécialisation
En partant d’une présentation stylisée des évolutions du commerce mondial et en
faisant référence à la notion d’avantage comparatif, on s’interrogera sur les
déterminants des échanges mondiaux de biens et de services et de la spécialisation.
On analysera les avantages et inconvénients des échanges internationaux pour les
producteurs comme pour les consommateurs. On présentera à cette occasion les
fondements politiques protectionnistes et on en montrera les risques. On
s’interrogera sur les effets d’une variation des taux de change sur l’économie des
pays concernés. En s’appuyant sur des données concernant le commerce intra-firme
et sur des exemples d’entreprises multinationales, on abordera la mondialisation de
la production. On analysera le choix de localisation des entreprises et leurs
stratégies d’internationalisation. On étudiera à cette occasion les principaux
déterminants de la division internationale du travail, en insistant sur le rôle des
coûts et la recherche d’une compétitivité hors prix.
Acquis de première : gains à l’change
Définition des notions :
Avantage comparatif : Théorie développée par l'économiste David Ricardo qui consiste pour un
pays, à se spécialiser dans la production d’un bien pour lequel il dispose un avantage relatif par
rapport aux autres pays. Il va alors se concentrer sur le bien où il est le plus efficace.
Dotation factorielle : Ensemble des facteurs de production (capital, travail, ressources naturelles)
dont un pays dispose (théorème HOS)
Libre-échange : Théorie économique et politique commercial qui représente les avantages de la
libre circulation internationale des marchandises et des capitaux. Cette théorie est soutenue par
Adam Smith puis par David Ricardo. Elle pousse les pays à supprimer toutes les barrières tarifaires
et non tarifaires qui empêchent les échanges internationaux.
Protectionnisme : théorie économique et politique commerciale qui consiste protéger la production
nationale de la concurrence étrangère par ces obstacles tarifaires et non tarifaires
Commerce intra-firme : Partie du commerce international qui se déroule entre les filiales d'une
FMN.
compétitivité prix et hors prix : La compétitivité-prix désigne le fait qu’une entreprise chercher à
attirer les consommateurs en réduisant ses prix de vente. Alors que la compétitivité hors prix n’est
pas basée sur le prix mais surtout la qualité du produit, sa marque, son caractère technologique,
son design…
Délocalisation : Transfert de capital, d’activités et d’emplois par une firme multinationale vers un
autre pays.
Externalisation : Réalisation d'une partie des activités d’une entreprise dans une autre entreprise
située sur le territoire national ou à l'extérieur. Cela permet alors de se concentrer sur son métier
d'origine et de confier le reste à plus compétent et donc moins cher.
Firmes multinationales : Désignent une société qui détient plus de 10% du capital d’une autre
entreprise située dans un autre pays. Une firme détient au moins une unité de production en dehors
de son territoire d’origine.

Spécialisation : consiste à se concentrer dans une activité pour laquelle l’entreprise dispose
d'une compétence ou d'un avantage particulier.
Gains à l'échange : surplus tiré de l’échange marchand après spécialisation, supérieur à la
situation d’autarcie.
A) Quelles sont les grandes évolutions du commerce international ?
Document 1 : Les différents aspects de la mondialisation
La mondialisation est l’émergence d’un vaste marché mondial de biens et services, de capitaux et de main d’œuvre
qui s’affranchit des frontières des Etats et qui accentue l’interdépendance entre les pays.
La mondialisation a connu deux grands bouleversements. En effet, on peut distinguer deux grandes vagues de
mondialisation : la première avec la première révolution industrielle et la deuxième à partir de 1950 a nos jours.
La première mondialisation correspond à la division traditionnelle du travail. Les pays Européens importaient
essentiellement les produits primaires et exportaient leurs produits manufacturés.
La deuxième repose sur le développement des firmes transnationales. Et beaucoup plus de pays sont rentrés dans
cette mondialisation comme les EU et les pays émergents à partir de 1970 comme l’Inde, Taiwan. Cette
mondialisation est également marquée par une très grande interdépendance des pays.
Cependant, la crise de 29 entraine une baisse des échanges internationaux et favorise une montée du
protectionnisme. Et lorsqu’une crise touche un pays, il y aura des répercussions sur d’autres pays.
On repère la mondialisation avec la croissance du commerce international, les flux de capitaux, les IDE.
IDE : flux de capitaux des multinationales pour créer une filiale dans un pays étranger ou pour contrôler une société
étrangère.
On repère aussi avec les migrations et les taux d’ouverture qui mesurent le degré d’ouverture d’une économie sur le
marché extérieur. Calcul (exportations+importations )/2/PIB
Document 2 : Evolution de l’ouverture des économies depuis 1970
(exportations+importations sur PIB)
Le taux d’ouverture a progressé dans tous les pays : la France par exemple est passée de 31,3% en 1970 à 48,5% en
2009.
Les économies sont de plus en plus tournées vers l’extérieur. Le taux d’ouverture est en général inversement
proportionnel à la taille du marché national (un petit pays a besoin de taux d’ouverture élevé). Par exemple pour les
USA le commerce mondial représente 10% du PIB alors que pour l’Irlande, il représente 50% du PIB
Document 3 : Part des biens et services dans le total des exportations mondiales (en%)
La structure des échanges a évolué depuis les années 1910. En effet, la part des produits primaires dans la part totale
des exportations a beaucoup baissé et a même été divisé en deux, alors que ces produits primaires étaient les
produits les plus exportés avant. Cela s’explique par le fait que les produits manufacturés sont de plus en plus
exportés et les services commerciaux ont progressé mais plus faiblement.
Document 4 : Commerce mondial de marchandises, 2010
On peut repérer trois zones qui sont fortement insérées dans le commerce mondial : Asie, l’Amérique du Nord et
l’Union Européenne, ce sont les 3 pôles de la Triade. Ces zones sont rentrées plutôt dans la révolution industrielle.
On peut également caractériser les différents secteurs d’exportations favorisés par les différentes régions : par les
pays de la tripolarisation exportent plus de produits manufacturés, les pays tels que l’Afrique ou le Moyen Orient
exportent beaucoup de combustibles, et l’Amérique du Nord favorise plutôt la production agricole.

La Chine, pour augmenter le poids de la richesse nationale, utilise la stratégie de remontée de filière : commencer
avec un produit bas de gamme puis meilleur produit, car la Chine était rentrée plus tardivement dans la
mondialisation.
Elle utilise également la stratégie mercantiliste : favoriser LES X et limiter LES M
On peut également repérer des zones qui connaissent un excédent commercial comme l’Asie le Moyen Orient et
les UE, ou un déficit commercial comme les EU.
Document 5 : Echanges interbranches et échanges intra-branches
On peut distinguer deux types de commerce. Le commerce interbranche désigne les échanges de biens différents
entre des pays qui ont des spécialisations différentes. Il s’agit d’un commerce complémentaire car ce sont des
échanges de biens qu’un pays n’a pas. Il concerne donc les pays qui ont des niveaux de vie différents et l’ancienne
division internationale du travail.
Le commerce intrabranche désigne l’échange de produits similaires qui se fait entre des pays qui ont un niveau de
vie comparable. Mais ces produits se distinguent par leur qualité, leur utilisation, leur technologie, leur marque. Et
il concerne la nouvelle division internationale du travail où on échange des produits comparables.
L’ancienne division du travail concerne l’échange de produits manufacturés contre les produits primaires dans les
pays du Sud (notion de complémentarité) alors que la nouvelle division désigne la diversification des produits et
permet aux entreprises d’avoir un monopole en différenciant les produits et un pouvoir de marché et on peut
éviter la concurrence sur les prix.
Synthèse :
Le monde a connu au moins deux vagues de mondialisation marquées par une intensification des échanges
commerciaux et une augmentation du degré d’ouverture des économies.
Le commerce mondial actuel se caractérise par trois points marquants : la domination commerciale des pays
développés regroupés dans la triade (Europe, Amérique du Nord, Japon) ; l’insertion accélérée de l’Asie,
principalement la Chine et l’Inde ; la marginalisation de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Europe de l’Est.
Le commerce mondial de marchandises concerne les produits les agricoles, les produits des industries extractives,
mais surtout les produits manufacturés qui sont la catégorie la plus dynamique. Au sein du commerce des
produits manufacturés, les échanges intra-branches se développent au détriment des échanges interbranches.
Les échanges de services progressent également de manière importante et représentent aujourd’hui 20% du
commerce mondial total.
B) Quels sont les déterminants de l’échange et de la spécialisation ?
Document 6 : La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo
Tout d’abord, un gain à l’échange désigne le gain que l’on retire après un échange marchand après spécialisation (
il est utilisé pour faire la comparaison avec l’autarcie).
Selon la théorie des avantages comparatifs, les nations doivent se spécialiser là où elles sont les plus efficaces,
c'est-à-dire par rapport à soi même ( là où on est le moins désavantagé)
Le coût d’opportunité (où le cout de renoncement) c’est lorsqu’on renonce à une quantité de bien pour un autre
bien => permet de comprendre les avantages comparatifs.
Adam Smith avait déjà montré l’intérêt du commerce fondé sur la spécialisation où l’on le plus efficace, car cela
permet de faire des gains de productivité.
La condition pour que cela marche : instaurer le libre-échange et ouvrir le marché => hausse de la productivité
dans certains pays et baisse des prix, abondance, qualité
Limite : si on n’a pas d’avantage absolu, on n’a pas intérêt à participer à l’échange.
Ricardo (Principe de l’économie politique et de l’impôt, 1817) reprend la théorie d’Adam Smith mais avec un
exemple de pays qui dispose tous les avantages absolus et un pays qui en a aucun. Si le pays qui n’a aucun
avantage absolu, se spécialise relativement où il est le efficace dans le domaine ou il est le moins désavantagé, il a
intérêt à participer à l’échange. Mais le pays qui a tous les avantages absolus, il va se spécialiser là où il et le
meilleur et de gagner des gains importants.

Il y a 3 avantages à la spécialisation et à l’échange :
- La productivité globale va augmenter dans chaque pays qui pratique car il va pouvoir économiser du temps
de travail en renonçant au produit où il est le moins efficace. Ce temps économisé va être utilisé pour produire
davantage des biens dans lesquels on est efficace.
- On va acheter moins cher les produits auxquels l’entreprise a renoncé (produits importés), ce qui va donc
permettre d’augmenter le pouvoir d’achat.
- En plaçant le facteur où il est le plus efficace, il y aura une bonne allocation des ressources
(chez smith et ricardo : raisonnement sur un seul facteur qui est le travail)
Document 7 : La dotation en facteurs de production
Selon le théorème HOS, crée par Ohlin, Heckscher et complété par Samuelson en 1933 (néoclassiques), les
nations doivent exporter des produits qui incorporent une forte quantité du facteur production qu’elles
détiennent en abondance et à importer des produits qui incorporent une forte quantité du facteur dont elles sont
peu dotées.
Ce théorème, plus moderne, qui raisonne sur les deux facteurs, permet d’approfondir l’analyse de Ricardo qui, lui,
raisonnait uniquement sur le facteur de travail.
Les pays où le facteur travail coûte cher, se spécialisent dans des produits qui incorporent beaucoup de capital. Et
les pays où on accumule beaucoup de facteur travail, notamment les pays en développement où le facteur travail
n’est pas cher, ont intérêt à se spécialiser dans ce facteur.
Donc les pays doivent se spécialiser en fonction de leur abondance.
Par conséquent, on pourrait remarquer une convergence des économies car il devait se produire une égalisation
du cout des facteurs de production. En effet, dans les pays du Sud, le cout du capital augmente peu à peu. Donc
l’écart entre les deux facteurs baisse, et ils vont se tourner vers des produits qui demandent plus de capital et
moins de travail. On dit alors qu’ils montent en gamme.
Les pays du Nord, où le capital est trop cher, sont victimes des rendements décroissants puisque les profits sont
en baisse. Le facteur travail devient plus intéressant.
Il faut donc participer à l’échange international et il faudrait alors supprimer toutes les politiques protectionnistes
qui empêchent les importations ou les exportations, comme la politique mercantiliste par exemple.
Document 8 : La spécialisation de la France
Les avantages comparatifs de la France sont l’aéronautique, les produits pharmaceutiques, produits de toilettes
en 2008.
Les avantages comparatifs disparus sont produits raffinés du pétrole.
Ceux des Etats Unis sont les nouvelles technologies, l’automobile, l’armement, ceux de l’Allemagne sont
l’automobile et les machines et ceux de la Chine, le textile, les produits électroménagers.
Document 9 : Une répartition égale des gains à l’échange ?
Selon Paul Krugman, les échanges mondiaux sont largement dominés par l’échange de produits similaires entre
les pays qui ont un niveau comparable.
Ces échanges s’expliquent par la défaillance des marchés et une concurrence imparfaite qui règne. Et les
échanges se font par concurrence entre grands oligopoles ou grands monopoles qui le sont devenus sur le marché
intérieur et qui cherchent des débouchés sur le marché extérieur.
Mais si on veut comprendre les échanges, il faut analyser la stratégie des firmes et non des pays. En effet, les
firmes chercher un pouvoir de marché, et donc une situation de monopole sur le marché intérieur, où elles
peuvent fixer le prix. La concurrence sur le marché intérieur se développe et petit à petit il y aura un phénomène
de concentration, c’est-à-dire elles vont acheter d’autres entreprises et vont donc éliminer les concurrents,
augmenter les débouchés et faire des économies d’échelles ( baisse du coût unitaire ou moyen quand la
production augmente). Elles vont alors se tourner vers les marchés extérieurs.
Donc le monopole se fait grâce à une différenciation des produits mais il s’agit d’une défaillance car c’est
contraire à l’atomicité des agents.

Sur le marché extérieur, l’arrivée des concurrents internationaux permet la diversité des produits pour les
consommateurs. De plus, il y a un rétablissement de la concurrence puisqu’en situation de monopole, il y avait
une concentration des entreprises et donc une élimination des concurrents. Cette diversification des produits
permet d’éviter la concurrence sur les prix puisque les produits sont différents et incomparables.
Selon Krugman, la répartition des gains à l’échange n’est pas équitable car il peut y avoir des perdants à
l’échange, il y a des pays qui ont une mauvaise spécialisation. On parle alors de piège à l’ouverture du marché
international. On peut alors prendre l’exemple des pays du Sud qui sont enfermés dans la mauvaise spécialisation
comme les produits primaires et dont leurs exportations ne permettent pas de financer les importations.
Il peut même y avoir des perdants à l’intérieur d’un pays, lorsqu’une entreprise disparait.
Document 10 : La différenciation des productions
Il y a deux types de différenciation des produits. La différenciation horizontale des produits désigne les produits
qui sont de même qualité mais qui se différencient par leur marque, le design… Et la différenciation verticale
désigne les produits qui n’ont pas la même la qualité.
La différenciation horizontale concerne les produits de même niveau et s’explique par le goût pour la diversité du
consommateur. Elle explique ainsi le commerce interbranche. Et la différenciation verticale s’explique par le
niveau moyen des revenus d’un pays.
Document 11 : Couts des transports et des communications en dollars constants de 1990
Le développement des échanges peut aussi s’expliquer par la baisse des coûts de transports et de
communication.
Document 12 : Le développement du libre-échange a favorisé l’ouverture des économies
Le développement du libre-échange peut également être favorisé par des politiques de libéralisation avec la
mise en place d’accords. En effet, le GATT, accord signé en 1948, repose sur deux principes : le libre-échange et
le multilatéralisme. Le premier principe interdisant les restrictions quantitatives qui limitent les importations,
baisse également les droits de douane, mais aussi les subventions de l’Etat et le dumping. Le multilatéralisme
consiste à assurer que les négociations faites à un pays soient étendues à tous les autres. Cette libéralisation
du commerce a permis de développer les échanges internationaux puisqu’on peut voir que les tarifs douaniers
ont été divisés par 4 depuis 1960.
Le GATT, qui était signé par 23 Etats en 1948 devient l’OMC avec 160 pays en 1994.
Aujourd’hui, avec 160 pays dont les intérêts sont très divergents, notamment entre les pays du Nord et les pays
du Sud, il est plus difficile de mettre en place des accords. On met alors en place des accords régionaux, comme
la TAFTA qui a pour but de créer une zone d’échange entre l’Union Européenne et les USA, en baissant les
barrières douanières et la réglementation. Mais cet accord n’est encore défini.
Synthèse :
Le commerce mondial reflète la division internationale du travail : aujourd’hui les pays développés restent
spécialisés dans les produits sophistiqués alors que les pays en développement se spécialisent plutôt dans des
productions qui nécessitent une main d’œuvre abondante et peu rémunérée.
La structure des échanges et la spécialisation trouvent leur origine dans l’avantage comparatif qui conduit les
individus et les pays à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ils sont relativement les plus
efficaces. Ricardo fonde au début XIXe siècle la théorie libérale de l’échange international en montrant que
chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions dans lesquelles il détient l’avantage le plus grand et le
désavantage le moins grand, en fonction du coût d’opportunité. Cet avantage comparatif peut être donné ou
construit. Après spécialisation, l’échange engendre un surplus, cependant la répartition de ce gain à l’échange
peut être inégale.
Puis au cours du XXe siècle, trois économistes : Hecksher, Ohlin et Samuelson, montrent que les spécialisations
proviennent des différences de dotation des pays en facteurs de production. Chaque pays doit se spécialiser
dans les productions qui utilisent le facteur de production qu’il possède en abondance (théorème HOS).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%