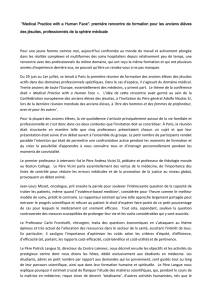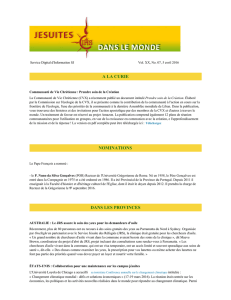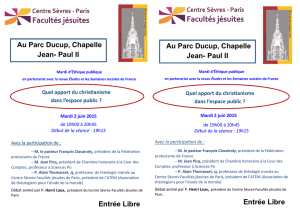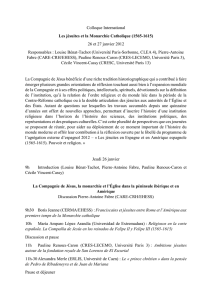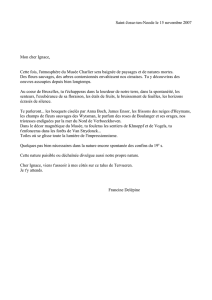1. Le fondateur: Ignace de Loyola (1491-1556)

JÉSUITES
Avec un peu moins de 24 000 membres (au 1er janvier 1993), la Compagnie de Jésus
constitue numériquement la deuxième famille religieuse de l’Église catholique (aussitôt après
l’ensemble des différentes branches franciscaines). Pour comprendre son importance
passée et présente, il est utile de connaître d’abord son fondateur, Ignace de Loyola, qui fut
à la fois un mystique et un homme d’action; par là, il a marqué fortement non seulement ses
premiers compagnons mais, de son temps même et au cours des siècles suivants, des
hommes très nombreux et souvent influents. Par le gouvernement de son ordre et par ses
écrits, en premier lieu les Exercices spirituels et les Constitutions , il a façonné un ordre fort
et original, qui fait encore aujourd’hui la preuve de son dynamisme. Un aperçu historique du
développement de la Compagnie permettra donc de suivre les répercussions de l’élan initial
au long de plus de quatre cents ans. Il est relativement facile d’y relever au moins quelques
grands événements extérieurs, étudiés par les historiens.
Pour une pleine intelligence des faits, il faudrait encore rendre compte d’autres écrits, en
particulier de l’abondante littérature spirituelle laissée par des jésuites, dont plusieurs ont été
canonisés par l’Église; il serait nécessaire enfin – mais il est sans doute trop tôt pour le faire
– d’analyser l’évolution actuelle de la Compagnie de Jésus, spécialement le mouvement qui,
avec le IIe concile du Vatican, la conduit à revoir certains modes de gouvernement (dans le
sens de la démocratisation), à modifier bien des aspects de la formation de ses membres, à
envisager et entreprendre de nombreux changements dans le choix de ses activités
traditionnelles.
Par les attaques violentes ou par les solides amitiés, par les réussites qu’elle a connues
comme par les crises qu’elle a traversées, la Compagnie de Jésus intéresse l’histoire du
christianisme.
1. Le fondateur: Ignace de Loyola (1491-1556)
La vie d’Ignace de Loyola se divise en trois grandes périodes. Né en 1491, dans le manoir
familial proche de la petite ville d’Azpeitia, ce fils de hobereaux basques est, pendant trente
ans, jusqu’à sa blessure lors du siège de Pampelune en 1521, un jeune noble comme tant
d’autres, «adonné aux vanités du monde, avec un grand et vain désir d’y gagner de
l’honneur». Sa convalescence est marquée par une «conversion». Pendant treize ans,
Ignace devient une sorte de «pèlerin de Dieu». Il vit en ermite à Manresa (1522-1523) et y
commence la rédaction des Exercices spirituels , se rend à Jérusalem (1523), fréquente
successivement les universités d’Alcalá, de Salamanque et de Paris. Dans cette ville, il
réunit autour de lui quelques étudiants de valeur, le Savoyard Pierre Favre, le Navarrais
François-Xavier, Jacques Laínez... Les nouveaux amis décident de ne plus se séparer. Par
le vœu de Montmartre (15 août 1534), les membres du groupe s’engagent à la pauvreté, à la
chasteté, et à partir dès que possible à Jérusalem pour y convertir les infidèles. Si le voyage
se révèle impossible, ils se mettront à la disposition du pape. Dès lors se dessinent la figure
et la carrière du fondateur d’ordre. Ordonné prêtre à Venise en juin 1537, Ignace célèbre sa
première messe à Noël 1538 dans la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure. L’année
suivante, il rédige la Formula instituti , première ébauche des constitutions définitives de la
Compagnie. La création de celle-ci est acceptée par Paul III en septembre 1540 et, sept
mois après, Ignace est élu général à l’unanimité. Lorsqu’il meurt en 1556, l’ordre s’étend déjà
sur douze «provinces», compte soixante-douze résidences, soixante-dix-neuf maisons et
collèges, et un millier de membres.
Les jugements d’Edgar Quinet sur saint Ignace, reflétant un état d’esprit largement
répandu au XIXe siècle, sont restés célèbres. Évoquant «cette vie puissante où la chevalerie,

l’extase, le calcul dominent tour à tour», il affirmait: «Il y a en lui du saint François d’Assise et
du Machiavel.» L’historiographie actuelle est revenue à plus de compréhension à l’égard du
fondateur des Jésuites, qu’il s’agit moins de juger que d’expliquer.
Le mystique
Il faut d’abord rattacher Ignace de Loyola à l’Espagne du XVIe siècle, pays où la longue lutte
contre les musulmans avait engendré la piété ardente d’un peuple justement fier de son
Église. Celle-ci avait entrepris sa propre réforme, grâce au cardinal Cisneros, à une époque
où le nom de Luther était encore inconnu. Tout au long du XVIe siècle, la solidité théologique
de l’Espagne face à la Réforme, la vigueur de l’élan mystique qui se manifesta dans le pays
de Thérèse de Jésus, la netteté des interventions espagnoles au concile de Trente
témoignèrent de la vitalité de l’Église ibérique – vitalité qui n’allait pas sans beaucoup
d’intolérance. Ignace fut l’un des plus authentiques représentants de la ferveur catholique de
l’Espagne. On a trop souvent décrit l’organisateur méthodique et longtemps oublié l’homme
qui, dans sa jeunesse, fut, comme la sainte d’Ávila, passionné par les romans de chevalerie.
La lecture, au cours de sa convalescence, de la Légende dorée lui donna le désir de
réaliser des prouesses religieuses et de devenir un chevalier de Dieu. D’où les mortifications
surhumaines qu’il s’imposa au cours des années héroïques de Manresa. Il y renonça par la
suite et ne songea jamais à les prescrire à ses disciples.
Tempérament exigeant, il était ouvert aux joies de l’amitié et savait à l’occasion faire
preuve d’humour. Sans être un humaniste, il était loin d’être inaccessible à la beauté et, s’il
avait suivi ses seules préférences, il aurait maintenu le chant choral et la musique religieuse,
qu’il affectionnait, dans la vie quotidienne de la Compagnie. Il était sensible aussi à la
souffrance d’autrui, visitait fréquemment les malades, n’oubliait jamais les absents. Dans la
prière, cette sensibilité extrême se manifesta par le «don des larmes» (phénomène qu’on
rencontre chez d’autres mystiques, mais qui fut particulièrement intense chez lui). Il faillit en
devenir aveugle. Il crut longtemps que, s’il cessait de pleurer, les consolations spirituelles
dont il était favorisé disparaîtraient aussi. Il reçut, dès l’époque de Manresa et ensuite tout au
long de sa vie, de nombreuses illuminations, révélations et «visions». Toutefois, il ne
prétendait pas apercevoir ces «visions» avec les yeux de la chair, mais avec les yeux
intérieurs, c’est-à-dire avec ceux de l’entendement. Son compagnon Pierre Canisius déclara
à ce propos: «Jamais je ne dirai absolument: il a eu des illuminations, mais plutôt: il a eu de
remarquables et nombreuses connaissances des choses divines.» Ces grands élans de
ferveur accompagnés d’une extraordinaire allégresse l’empêchaient parfois de parler, de
dormir, de faire oraison et de se livrer à toute forme d’activité, au point qu’à la fin de sa vie il
se fit dispenser de la lecture du bréviaire.
La spiritualité ignatienne
Ce mystique, qui tenait dans son Journal spirituel la comptabilité de ses visions et de ses
larmes, était un lucide qui sut passer de la piété chevaleresque de la Légende dorée à la
spiritualité à la fois très méthodique et très affective de la devotio moderna dont il subit
l’empreinte à Montserrat. Les Exercices spirituels , dont Ignace fut l’architecte, se situent
dans la droite ligne de la spiritualité issue de Jean Ruysbroek et de Gérard Groote. Ils sont
un livret pour guider la recherche de la volonté divine, à travers la méditation, la
contemplation et le discernement des mouvements intérieurs de l’esprit. Aucun détail n’est
négligé pour y parvenir, telles les sept doubles lignes sur lesquelles le pénitent marque ses
fautes par des points, tels les conseils sur la manière de prier, telle la place faite au procédé
qui consiste à accorder le rythme de la prière à celui de la respiration, etc. Méthode
diabolique qui dissout la personnalité du retraitant, pensèrent Quinet et Michelet. Surtout

patiente pédagogie qui voulait rendre le fidèle indifférent à tout ce qui n’est pas Dieu, et
s’avéra éminemment capable d’aider les âmes d’élite encore hésitantes à se consacrer à
l’apostolat. Le retraitant est appelé à «choisir le Christ pauvre de préférence à la richesse,
les opprobres avec le Christ plein d’opprobres plutôt que les honneurs».
Fortifié et confirmé par les Exercices spirituels , le chrétien n’abandonnera plus son
sauveur. Éprouvé de même par de longues années de formation, le jésuite n’abandonnera
pas son ordre ni l’Église. Ignace a compris beaucoup mieux que la plupart de ses
contemporains que la Réforme protestante avait été surtout le fait d’hommes d’Église
– Luther, Zwingli, Bucer, Knox... Il voulut constituer un corps d’élite, une troupe de choc
disponible pour tout service et toute mission. Ainsi s’expliquent et la règle d’obéissance des
jésuites au préposé général, qui a été si souvent critiquée hors de la Compagnie, et le vœu
spécial d’obéissance au pape émis par les profès. Il serait trompeur de voir en cette
obéissance un souvenir de la discipline des armées. Ignace ne fut militaire que huit jours et
les armées de la Renaissance n’étaient pas précisément disciplinées. Le fondateur des
Jésuites ne commandait jamais sans expliquer – et souvent longuement – les motifs de ses
décisions, mais il exigeait des membres de l’ordre une obéissance comprise comme une
véritable mortification et qui parut lourde à un vieux et fidèle compagnon tel que Bobadilla.
Par un paradoxe qui n’est qu’apparent, cette obéissance ne fut, en fait, exigée que de fortes
personnalités, celles qui étaient capables d’accepter la longue probation de la Compagnie.
Ignace avait ainsi créé une milice singulièrement homogène, où néanmoins les individualités
marquantes furent plus nombreuses, sous l’Ancien Régime, que dans n’importe quel ordre
religieux catholique.
2. La Compagnie de Jésus
Les débuts
Le terme de «jésuite» est antérieur à la fondation de la Compagnie de Jésus. Pour les
théologiens du Moyen Âge, le chrétien, après sa mort, deviendrait un jesuita , c’est-à-dire un
autre Jésus. Mais dès le début du XVIe siècle, le mot avait pris dans les pays germaniques
une coloration péjorative. Appeler quelqu’un jesuita équivalait à le traiter de «faux Jésus»,
donc d’hypocrite. Quatre ans après la création de l’institut d’Ignace de Loyola, Canisius
écrivait qu’en Allemagne lui-même et ses disciples étaient qualifiés de «jésuites» dans un
esprit de médisance. Le mot devint bientôt d’usage courant en Europe et il parut alors se
vider de son intention malveillante. Il fut une façon commode et rapide, mais qui était restée
inconnue d’Ignace de Loyola, de désigner les membres de la Compagnie de Jésus. Au
concile de Trente, le P. Laínez, en 1562, était déjà habituellement appelé generalis
Jesuitarum . Cependant, l’acception péjorative ne disparut pas complètement de l’usage et
refit surface à chaque fois – et la chose fut fréquente – que des campagnes furent lancées
contre la Compagnie de Jésus. En France notamment, pour beaucoup d’anticléricaux du
XIXe siècle, «jésuite» était synonyme de fourbe et de bigot.
Au début de leur histoire, les Jésuites, institués officiellement en 1540, ne furent qu’un – et
pas le premier en date – des groupes de clercs réguliers ou «prêtres réformés» qui se
créèrent en Italie dans la première moitié du XVIe siècle. Il faut donc les rapprocher des
Somasques de Girolamo Miani, des Barnabites de Benedetto Zaccaria et des Théatins
fondés par Gaetano da Tiene et Giovanni-Pietro Carafa, le futur Paul IV. Les uns et les
autres, comme plus tard les Oratoriens de Bérulle en France, voulaient réformer l’Église du
dedans en menant au milieu du peuple chrétien une vie sacerdotale exemplaire. Ces prêtres
refusaient de se couper du monde. Ils ne désiraient pas vivre protégés par une clôture, ni
couler leur activité dans un horaire strict et invariable. Leur existence devait se dérouler dans

le siècle et leur règle être surtout intérieure.
Pourquoi la Compagnie de Jésus éclipsat-elle rapidement les autres sociétés de «prêtres
réformés» nées à peu près en même temps qu’elle? La raison première de son essor réside
certainement dans les Constitutions de l’ordre, dont le fondateur avait rédigé une première
ébauche dès 1539 et qui furent promulguées – mais sous une forme encore provisoire – en
1551. Elles prévoient pour le futur jésuite une formation extraordinairement longue, pouvant
s’étaler sur une dizaine d’années ou plus. Dans cette ligne, la vie de l’étudiant jésuite en
France comporte actuellement deux ans pour le noviciat que suivent les vœux perpétuels,
puis deux ou trois ans de philosophie – avec souvent une spécialisation en sciences
humaines ou exactes –, un stage de vie active (par exemple dans l’enseignement), quatre
années de théologie – l’ordination sacerdotale intervenant au cours de la troisième année de
théologie –, enfin un «troisième an», dit de probation, qui renoue par-delà les années de
formation intellectuelle avec celles de noviciat, d’où son nom. Alors seulement sont
prononcés les «grands vœux» qui intègrent le jésuite à la Compagnie, comme profès ou
comme coadjuteur spirituel suivant qu’il est admis ou non à prononcer le quatrième vœu,
spécial à l’ordre, d’obéissance au pape. La societas professa est le noyau de la
Compagnie. En imposant aux novices une mise à l’épreuve aussi longue, Ignace de Loyola
avait évidemment voulu assurer une formation solide, une intégration progressive et éviter
autant que possible de futures défections. Il rompit d’autre part avec le système décentralisé
et démocratique des ordres religieux du Moyen Âge. Bien que l’élection n’y ait pas été
abandonnée, la Compagnie de Jésus fut plutôt organisée comme une monarchie centralisée.
Certes, le supérieur général est élu par l’assemblée des pères provinciaux dont chacun est
assisté par deux pères profès, eux-mêmes élus par les religieux de la province. En outre, la
congrégation générale ainsi constituée nomme des assistants et un admoniteur chargés
d’aider le préposé général dans sa mission, mais aussi de le surveiller. Il existe encore une
autre assemblée, dite des procureurs – eux aussi sont élus par les congrégations
provinciales –, qui se réunit de droit régulièrement et décide s’il y a lieu de convoquer une
congrégation générale, celle-ci ayant pouvoir de déposer le préposé général. Il reste que
l’ordre est gouverné selon un principe monarchique par l’élu d’une aristocratie. Car le
préposé général est élu à vie et n’a en fait jamais été déposé. Il nomme les provinciaux qui,
eux, ne demeurent en fonctions qu’un temps limité. Impitoyable pour les inaptes, Ignace de
Loyola exigea de tous ceux qui étaient agrégés à la Compagnie l’obéissance la plus totale.
Assurément le fondateur était de tempérament autoritaire. Mais ce qu’il voulut obtenir de ses
disciples comme de lui-même, c’était une disponibilité totale à la volonté de Dieu. Ainsi mit-il
sur pied une milice qui, depuis le XVIe siècle, n’a pas cessé d’étonner amis et adversaires
par sa solidité et la solidarité interne de ses membres.
Le succès des Jésuites s’explique par la durable fortune des Exercices spirituels , guide
du directeur de retraite, que Pie XI proclama en 1922 le code spirituel «le plus sage et le plus
universel pour diriger les âmes sur le chemin du salut et de la perfection». Les
Exercices furent pour beaucoup de pénitents un moyen d’approfondir leur religion, mais ils
furent aussi une des voies d’accès à la Compagnie. Ignace de Loyola, dans les premiers
temps de l’ordre, songeait surtout à lui donner des activités missionnaires en Terre sainte ou
en pays protestant. Il envisageait aussi, comme autre tâche, l’éducation religieuse des
enfants et des illettrés. La demande des notables de Messine, qui sollicitèrent du fondateur
la création d’un collège dans cette ville (1548), modifia la vocation de la Compagnie de
Jésus. «On peut dire qu’à partir de cette année 1548 toute nouvelle implantation importante
de la Compagnie dans le monde se traduisit de manière concrète par la fondation d’un
collège» (A. Guillermou). Celui de Rome, le célèbre Collège romain, fut inauguré dès 1551.
Les Jésuites devinrent la principale congrégation enseignante du monde catholique.

Une histoire mouvementée
Les historiens de la Compagnie divisent généralement son histoire en trois périodes: la
première va de 1540 à la suppression par Clément XIV en 1773; la seconde couvre les
années de survie clandestine 1773-1814, Pie VII ayant rétabli l’ordre à cette dernière date; la
dernière s’étend de 1814 à nos jours.
De l’âge d’or à la suppression de la Compagnie
L’âge d’or
À l’intérieur de la première période, un «siècle d’or» s’est écoulé de 1540 à 1640, année de
la publication, un peu ostentatoire, par les jésuites des Pays-Bas espagnols de l’Imago primi
saeculi . À la mort d’Ignace de Loyola en 1556, la Compagnie comprenait 1 000 membres et
administrait quelque 150 fondations (résidences, noviciats, maisons professes et collèges).
Cent ans plus tard, on comptait plus de 15 000 jésuites et 550 fondations. Certes les
missionnaires de l’ordre avaient déjà connu échecs et martyres au Japon, en Éthiopie et au
Canada. Mais ils détenaient une position importante en Chine et mettaient sur pied les
«réductions» du Paraguay. Les jésuites étaient devenus les confesseurs habituels des
souverains catholiques. Leurs collèges, dont l’organisation et l’enseignement étaient les
mêmes dans le monde entier, groupaient quelque 150 000 élèves. En 1773, les jésuites
étaient 23 000, répartis entre 39 provinces; leurs fondations étaient au nombre de 1 600,
avec 800 collèges où professaient 15 000 enseignants.
Depuis 1773, la Compagnie a connu, en divers coins du monde, une trentaine de
suppressions et d’expulsions. Néanmoins, elle compte 23 244 membres en 1993 et constitue
numériquement le deuxième ordre catholique, après l’ensemble des familles de franciscains.
Elle est le plus important des ordres missionnaires. Congrégation enseignante, les jésuites
comptent près de 8 000 pères qui se consacrent à des tâches scolaires dans quelque 1 840
établissements.
La cohésion de la Compagnie, le secret dont elle s’entourait, son ultramontanisme militant,
son indépendance vis-à-vis des hiérarchies ecclésiastiques locales, le succès de ses écoles,
son influence auprès des souverains suscitèrent très tôt jalousie et animosité dans le clergé
séculier, chez les autres ordres religieux, dans les milieux universitaires et chez tous ceux
qui désiraient défendre contre les empiétements de Rome les prérogatives de l’État. À la fin
du XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe, les avocats Étienne Pasquier et Antoine
Arnauld exprimèrent en France cette hostilité des milieux gallicans et universitaires. À Paris,
la Sorbonne assista avec aigreur à l’essor du collège de Clermont et refusa toujours de
conférer les grades académiques de philosophie et de théologie aux candidats issus de ce
collège. Quant à l’accusation de fourberie, elle fut alimentée dès 1614 par un faux, les
Monita secreta , dû à un ancien jésuite polonais. Le supérieur général y était censé donner
les meilleures méthodes pour s’insinuer auprès des grands et capter les testaments des
riches veuves. Réédité en France en 1761, ce pamphlet de médiocre qualité contribua à
accroître l’aversion envers les jésuites.
Les débats sur la grâce
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, trois grands débats opposèrent la Compagnie de Jésus
à ses adversaires.
Le premier porta sur la grâce, donc sur la gravité du péché originel. Pour les nombreux
augustiniens de l’âge classique – les jansénistes n’étant que les extrémistes de ce camp –,
«ce n’est pas en vertu de nos mérites que la grâce de Dieu est donnée aux enfants et aux
personnes en âge de raison... Elle n’est pas donnée à tous les hommes, et ceux à qui elle
est donnée ne l’obtiennent pas d’après le mérite de leurs œuvres ni d’après celui de leur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%