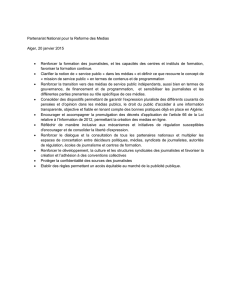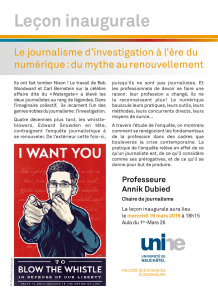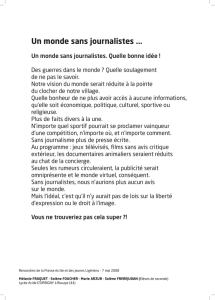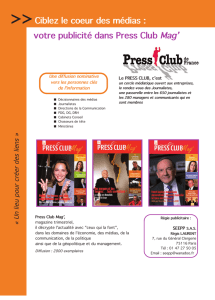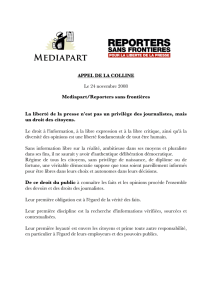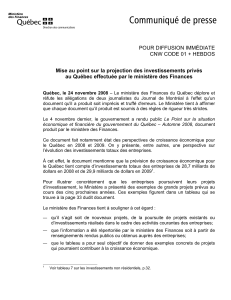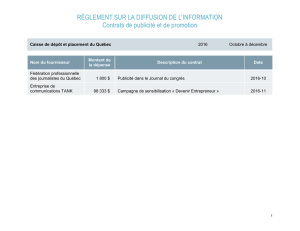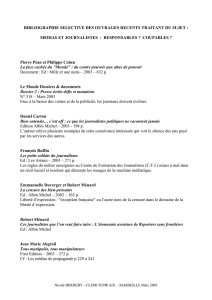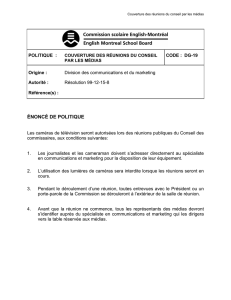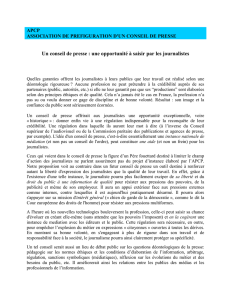Arles 2003 Filière 7 Cours 1

Université d’été Attac Arles 2003
Filière 7 : les Médias, auxiliaires du néolibéralisme et cibles de sa contestation – 7a : Cours
Prises de notes par Stéphane (stephane_heinrich@hotmail.com), exactitude des propos respectée dans la mesure du possible.
Filière 7 : Les Médias, auxiliaires du néolibéralisme et
cibles de sa contestation.
Cours : Informer sur l’information : la
concentration des médias, les mutations du
journalisme et leurs effets sur l’information.
Avec : Patrick Champagne, Michel Diard, Christian
Pradié et François Ruffin.
Introduction : présentation de la filière, des cours et ateliers et des
intervenants.
1. Christian PRADIE
Maître de conférence en sciences de l’information et de la communication à l’Université de
Vincennes.
La concentration des médias :
Le journalisme par rapport à cette concentration ?
Une autre information est-elle possible ?
Deux aspects
importance de la technologie
secteur mixte Etat/marché
Nous sommes dans une société de l’information, mais y a t-il variété d’expression ? On
peut constater que, à la télévision, les trois chaînes quasi uniques dans le débat sur les
élections présidentielles en 2002 étaient TF1, France 2 et France 3. La seule différence
avec le début des années 80 est que TF1 a été privatisée …
Qui possède ces médias ?
1. médias côtés en bourse : financiarisation, avec une logique de servir un
rendement financier ; il n’y a plus de propriétaires uniques comme une famille
(Hersant, Hachette …) ou un patron.
2. médias partiellement côtés en bourse : existe surtout en France ; leur
financement est certes dicté par des rendements financiers, mais pas seulement,
il y a aussi d’autres influences. Dans la presse écrite, Lagardère et Dassault sont
aussi des entreprises d’armement. A la télévision, Bouygues (TF1), Vivendi (C+)
et Suez (M6) sont des services urbains, dépendant des marchés publics, donc des
collectivités locales.
3. médias appartenant à leurs journalistes : très minoritaire, on y reviendra.
Ce caractère privé permet-il l’indépendance de ces médias privés ?
Le problème, à la limite, n’est pas que les médiaux soient commerciaux. Il existe de
petites maisons : Marianne, le Canard Enchaîné et des journaux appartenant à leurs
journalistes, en partie : Le Monde, Libération.
autogestion de la presse et de la radio possible. Il y a là un début de contre modèle
évident.

Université d’été Attac Arles 2003
Filière 7 : les Médias, auxiliaires du néolibéralisme et cibles de sa contestation – 7a : Cours
Prises de notes par Stéphane (stephane_heinrich@hotmail.com), exactitude des propos respectée dans la mesure du possible.
Mais Le Monde s’apprête à passer de média indépendant à média côté en Bourse, avec
le passage d’obligations en actions. Pour l’instant, 20% sont privatisés. Comment ce
journal restera-t-il indépendant par rapport aux marchés financiers et à leurs logiques ?
Attac a ici un rôle à jouer.
2. Patrick CHAMPAGNE
Sociologue, Centre de Sociologie Européen
La critique des médias a toujours existé.
C’est consubstantiel à l’existence des médias et au poids de l’économie. Et il y a eu pire !
Par exemple, la presse de l’entre deux guerres.
Les critiques depuis toujours sont :
la dénonciation d’une dérive économique
la critique partisane
Pour autant, n’y a-t-il rien de nouveau ? Si, car il existe des formes nouvelles, une
intensité plus forte.
Un peu d’histoire :
1918 : les dérives de la presse pendant la guerre 14-18 entraînent la mise sur pied de
la charte des journalistes.
1945 : mise à l’abri de la production de l’information du grand capital (mouvement
général dans l’économie française).
Il s’agit donc de faire une critique en posant les limites au sein desquelles se tient le
journalisme, et il faut évidemment plus réfléchir sur le système que sur des personnes
précises.
La production de l’information a 3 caractéristiques :
1. l’information est une propriété de l’esprit, qui se rapproche d’une activité
intellectuelle.
2. c’est une production intellectuelle qui doit être VENDABLE, il y a une dimension
économique inévitable : pas de public pas d’info.
3. dimension politique : l’information alimente le jeu et les luttes politiques.
Il y a donc un triangle des contraintes de la production journalistique. Selon les époques,
les journaux, les rubriques …, la production journalistique se déplace dans ce triangle.
Exemple : Le Monde, période Hubert Beuve-Méry. La dimension politique dominait, le
journal se voulait l’encyclopédie du temps. Il existait donc un journal de faits et
d’opinions affichées, de commentaires de ces faits. Tout en étant un journal qui se vend.
Le succès du livre de Péan/Cohen, « La Face Cachée du onde », montre qu’il y a bien eu
un changement au Monde, et un malaise évident.
Le danger est que, si un journal réussit trop bien, il tend à devenir une machine
économique, dépendant donc de lois économiques. Et ça peut entraîner des erreurs
économiques, comme le Monde au début des années 90, voire tendre vers des journaux
purement économiques et vers la presse marketing, où le seul objectif est de vendre
(Voici, Gala … par exemple).
Quels changements par rapport aux situations précédentes ?
1. La publicité : un journal se vend aux annonceurs, en plus des lecteurs (ou des
auditeurs, ou des téléspectateurs).
2. les années 80 : concentration, groupes étrangers entrent en concurrence avec la
presse française « il faut concentrer pour pouvoir résister », voir le cas Vivendi.
Conséquence : arrivée du néolibéralisme dans la presse et, concrètement,
faire cracher ce qu’on veut aux journalistes, car les emplois sont précarisés

Université d’été Attac Arles 2003
Filière 7 : les Médias, auxiliaires du néolibéralisme et cibles de sa contestation – 7a : Cours
Prises de notes par Stéphane (stephane_heinrich@hotmail.com), exactitude des propos respectée dans la mesure du possible.
enquêtes marketing pour déterminer la stratégie
Qui produit l’information ?
Il s’agit d’un produit collectif dont le journaliste et l’entreprise de presse sont les portes
plumes.
Mais il y a aujourd’hui 10 fois plus de communicateurs que de journalistes.
Le public est « ciblé » et les journaux grands publics savent sur quoi titrer pour faire
vendre (exemples pour les hebdomadaires : la vie sexuelle des Français, le prix des
logements dans les grandes villes, les secrets de la franc-maçonnerie, le salaire des
cadres …).
3. François RUFFIN
Ancien élève du CFJ (Centre de Formation des Journalistes, Animateur de « Fakir »)
On parle beaucoup d’économie, mais celle-ci est quasi invisible pour le journaliste qui
travaille à la base. Le journaliste apprend des techniques, des « évidences », par
exemple la gestion du temps : 20 secondes maxi pour un lancement en radio, sonore de
plus de 15 secondes impossible dans un reportage …
« L’Ethique » et « la Déontologie » sont très importants et très prisés : exemple à un
colloque sur ce thème au centre de Sèvres, avec Pierre-Luc Séguillon, à l’éthique
rigoureuse … : « on fait 2 fois plus court, car on a 2 fois plus d’infos et d’évènements
qu’il y a 20 ans ».
Exemple : proposition de Une sur la condition ouvrière, pour un journal interne de l’école
de journalisme. « Non », dit un responsable de Libération, car « il faut voir dans
l’actualité … Parfait, il y a PSG-OM la semaine prochaine.»
Le travail de journaliste n’est pas présenté dans les faits quotidiens comme une
recherche de rentabilité financière.
Les rapports sont « plus complexes » entre les journalistes et les publicitaires, dixit une
directrice du CFJ (Centre de Formation des Journalistes, là où est passé F. Ruffin),
directrice qui est une ancienne d’un service de communication …
Exemples effarants, tirés du livre de F. Ruffin, de ses expériences et de ses stages :
Un nouveau journal est-il « lancé » ? Non, car il s’agit « d’un nouveau produit
éditorial ».
le cahier multimédia de Libé, un mois avant le krach de la Net Economie
journal étudiant interne, intitulé « Combat », car « ça permet une visibilité dans la
profession ». Car utilisation de l’héritage de la Résistance.
Les dérives :
Le Monde : depuis 50 ans ?
Le CFJ : depuis 30 ans.
Libé : depuis 10 ans.
Le nouvel Obs. : en train …
La logique économique bouffe insidieusement le journalisme
4. Michel DIARD
Secrétaire général du Syndicat des Journalistes - CGT
Il y a un problème de concentration dans les médias, c’est la situation actuelle. Mais il y
a toujours eu une double influence politique/économique.
Héritage de la résistance : après 39-45, 300 quotidiens (nationaux ou
régionaux), alors qu’aujourd’hui, une cinquantaine seulement. Au sortir de la
guerre, chaque groupe de résistants a voulu lancer son journal. Pas possible
concentrations.

Université d’été Attac Arles 2003
Filière 7 : les Médias, auxiliaires du néolibéralisme et cibles de sa contestation – 7a : Cours
Prises de notes par Stéphane (stephane_heinrich@hotmail.com), exactitude des propos respectée dans la mesure du possible.
1972 : Rachat de « Paris Normandie », de la famille Wolf, par Hersant ;
scandale car mariage économique entre un ancien résistant et un ancien collabo
(Hersant). Un tabou est brisé.
1974 : Casse de l’ORTF en 7 sociétés (début de la privatisation ?). PLUS
Lagardère envoyé à la tête d’Europe 1 (poil à gratter relatif) pour y remettre de
l’ordre. Il y nomme Etienne Mougeotte …
1980 : Hachette ne va pas bien (quasi faillite) début de la réflexion des
industriels sur la rentabilité d’envoyer de l’argent dans un journal ou une
entreprise de presse. Début de la réflexion sur tuyaux + contenu des tuyaux.
Aujourd’hui : SYSTEME HYPERCONCENTRE
Hersant – DASSAULT
Hachette – LAGARDERE
Havas – CGE/VIVENDI, mais démantelé à présent (JM Messier)
+ le groupe Le Monde, mais fuite en avant vers un système capitalistique, tout en
affirmant le contraire.
Donc 2 groupes hégémoniques, mais pas concurrents : ils se partagent le marché
en toute connivence.
Il existe 3 types d’infos :
1. à faible valeur ajoutée. Ex. : l’info régionale. Spécialité Hersant/Dassault
2. à haute valeur ajoutée. Ex. : presse professionnelle, économique, spécialisée.
3. loisir, « entertainment », qui véhicule une publicité énorme. Spécialité
Hachette/Lagardère.
Nouveaux capitaux insufflés, il faut donc dégager des marges bénéficiaires :
baisse du coût de fabrication de l’info ( journaliste),
recherche de l’émotion et du scoop,
précarisation des salariés,
IL FAUT VENDRE, peu importe si le citoyen est bien informé.
Conséquences :
Désaffection du public
Diminution du nombre de lecteurs
Diminution du nombre de téléspectateurs satisfaits
Baisse de la crédibilité de la profession
En résumé : audience > intelligence et publicité > information
Exemple : TF1 ne vit QUE de la publicité.
A-t-on atteint un point de non retour ?
Conclusion : des médias de + en + produits, mais l’information n’est un produit
comme les autres.
5. Echanges avec la salle
Points abordés :
Pages de pub du gouvernement et de l’Unedic dans la presse au printemps
Situation de l’Huma (pas brillante financièrement et 5% à Lagardère)
Certaines pubs destinées aux annonceurs …
Quels journaux d’info reste-t-il ?
Emprise du numérique sur la fabrication de l’info
Accueil des journalistes sur le Larzac (chaud !)
Témoignage « Paris – Normandie »
La liberté de ton sur France Culture !
Droit de refus de répondre aux journalistes
Peur de réformer les médias par un pouvoir politique dépendant des élections …
Citoyenneté des auditeurs/lecteurs. Censure de l’écoute/achat.

Université d’été Attac Arles 2003
Filière 7 : les Médias, auxiliaires du néolibéralisme et cibles de sa contestation – 7a : Cours
Prises de notes par Stéphane (stephane_heinrich@hotmail.com), exactitude des propos respectée dans la mesure du possible.
Marge de manœuvre du Diplo % au Monde.
Le choix du public influe-t-il les Médias ? Ou l’inverse ?
Avantages fiscaux des journalistes pas remis en cause
Idéologie actuelle du Monde ? (économie sociale de marché et 8 titres en Une
sur Loft Story en 2001)
Voyeurisme à la TV
Hexagonalisme du questionnement sur les médias dans les exposés précédents
Fonctionnement de l’AFP (voir autres CRs de la filière)
Barbarie douce ou le nouveau totalitarisme du bombardement publicitaire
Education populaire : que faire face aux discours des médias ?
Ne pas négliger l’esprit critique des citoyens !
Nouvel individu : l’homo mediaticus
Réception du livre de François Ruffin dans le « milieu » ?
Luttes au quotidien dans les rédactions. Résistance d’autant plus efficace en
interne qu’elle existe aussi en externe.
Ecoles de journalisme : 10% des journalistes seulement.
1
/
5
100%