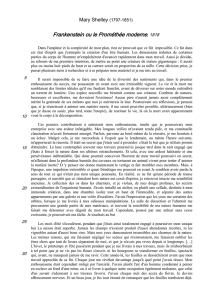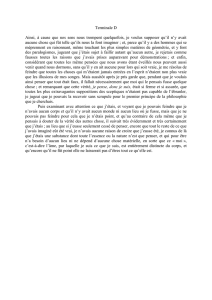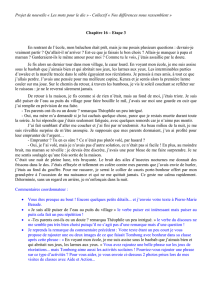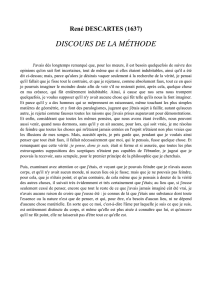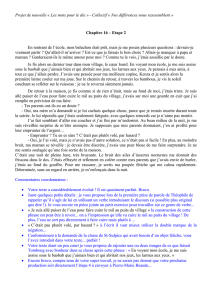Feuilleton autobiographique de Pierre Parlier

Le
roman
d’un
homme
heureux
(68)
(Feuilleton
autobiographique
de
Pierre
Parlier)
Les Trois Masques préparaient fébrilement le fameux récital de poésie qui devait avoir lieu au Foyer
International.Le grand salon s'y prêtait à merveille : piano à queue, fenêtres à croisillons, chaises cannelées…
une atmosphère intime, chaleureuse, style château victorien. Lorsque le grand jour est arrivé nous avions
l'impression de jouer notre carrière. Mes parents étaient là, heureux de voir enfin ces nouveaux camarades avec
qui je passais tant de temps et dont j’avais tant de mal à parler devant eux. Ils ne parvenaient pas à se
convaincre que mes relations fussent aussi brillantes que je le disais. « - Pourquoi ne fréquentes-tu pas des
jeunes gens de ton milieu ? me répétait ma mère. Pourquoi ne profites-tu pas de tes diplômes pour aller dans le
monde ? Nous, nous en avons été rejetés parce que ton père n'avait pas de situation mais toi, on t'accueillerait
avec plaisir... » Et elle se promettait d'écrire à ses cousines, les fameuses épouses de polytechniciens, pour
qu'elles m'invitent à dîner. Je répondais qu’il n’en était pas question et que je me débrouillais très bien tout seul
mais elle n’en semblait pas persuadée. Mon père alors perdait son sang-froid, il entrait dans des colères noires :
« - Tu n’es qu’un bon à rien ! hurlait-il. Quand donc comprendras-tu que la vie ce n’est pas une rigolade ! » Et
il finissait par partir en claquant la porte... Mais ces scènes d'empoignades étaient finalement les meilleurs
moments entre nous parce que c’étaient les seuls où nous communiquions. Toute l'équipe était donc là ce
jour-là, joyeuse, effervescente. Je les revois encore : Danièle, avec son grand nez, ses lunettes de myope, son
rire en cascade et son allure à la Gaby Morlay, rappelant à chacun l’ordre dans lequel il devait passer (c'est elle
qui avait la charge du programme) faisant les ultimes raccords, Christian accordant sa guitare dans un coin les
yeux au ciel, l’air inspiré, la grosse Annie répétant une dernière fois ses poèmes avec la certitude d’obtenir un
triomphe parce qu’elle avait une haute idée de son talent d’actrice, Paul courant de l'un à l'autre, reconnaissant
des gens dans l’assistance, allant les accueillir, offrant à tous le sourire éclatant de ses dents blanches, le petit
Bob relisant une dernière fois, avec application, la page de Céline qu’il avait apprise par cœur, Louise-Marie, la
fille de la directrice de Fénelon, toujours aussi demoiselle de bonne famille, prenant possession du grand piano
à queue et Françoise délicate et précieuse comme un petit Saxe, retouchant son maquillage et Jacques, avec son
profil à la Jean-Louis Barrault, irréprochable, élégant, allant de l’un à l’autre, distribuant les encouragements,
s'efforçant de résoudre les problèmes matériels – transport de chaises, réglages des lumières - avec une
attendrissante et totale inefficacité. Nous avions recruté en outre, quelques semaines auparavant, un jeune
garçon qui devait assurer la deuxième partie du spectacle dans un monologue de Courteline intitulé Théodore
cherche des allumettes. Je ne me souviens plus aujourd’hui des circonstances dans lesquelles il était arrivé
parmi nous, sans doute était-ce encore une des conquêtes de Paul (et rappelons au passage que c’était l’époque
où le parti communiste excluait certains de ses membres pour homosexualité) mais en ce temps-là je ne me
posais pas de questions. Je n’avais aucune idée des rapports qui unissaient les gens les uns avec les autres,
j’étais au dessus de tout ça, moi, j’étais le chef, le directeur, j’avais d’autres préoccupations ! Ce jeune garçon
avait l'allure d'un grand collégien dégingandé dont la mollesse apparente était contredite par une lueur de
malice dans son regard. Il parlait sans articuler, d'une manière absolument inaudible, ce qui posait quelque
problème mais il était d’une irrésistible drôlerie. Il venait d'arriver et repartit, après cette unique prestation, sans
que nous n'entendions plus jamais parler de lui, gardant d'un bout à l'autre ce même sourire un peu timide et
ironique de Pierrot tendre et désabusé.
Du récital lui-même je ne me rappelle rien, sinon le numéro de Paul qui avait choisi un poème surréaliste de
Ribemont-Dessaignes que j’avais apporté un jour un peu par hasard car je n’y comprenais rien et qui, à ma
grande surprise l’avait enthousiasmé. Il arriva devant le public une grande fleur à la main qu'il brandissait
comme un cierge et dont il avait remplacé le pistil par une saucisse de Strasbourg. Il distilla son texte avec une

préciosité affectée, faisant un sort à chaque mot puis au dernier croqua la saucisse d’un coup de dent. Ma mère
fut enthousiasmée par sa prestation dont elle garda un souvenir extasié. Elle l’avait trouvé étincelant de drôlerie
et tellement distingué ! Pendant des années ensuite elle me demandait de ses nouvelles. Malheureusement,
accaparé par la vie qu’il menait par ailleurs, il ne tarda pas pas à s'éloigner de nous et la dernière fois que je le
vis ce fut aux funérailles de son père - en uniforme, car il faisait alors son service militaire - marchant derrière
le corbillard en compagnie de sa mère et de son frère, à la tête d’un immense cortège de plus d’un million de
personnes chargées de fleurs rouges qui faisaient tout le long du boulevard Magenta comme un gigantesque
tapis dont on ne voyait pas la fin.
Au Foyer International après la représentation, parmi tous les gens qui étaient venus nous féliciter il y avait une
étudiante qui nous fit part de son admiration avec une conviction particulièrement chaleureuse et exprima son
désir d’entrer dans la troupe. Elle était brune avec des cheveux très courts, pas très belle mais assez grande et
bien faite. Comme elle avait l'art de flatter je trouvai son commerce agréable et lui proposai de venir à la
prochaine réunion où nous devions décider de la suite de nos activités. Elle arriva escortée d’un « fiancé », un
jeune homme aux teint mat, correct et effacé, originaire de Corse et d’un ami à l'allure discrète lui aussi, qui
parlait avec un léger accent du sud-ouest et se cachait derrière d'épaisses lunettes teintées. C'est ainsi que
Claudie, Alain et Jean-Marie firent leur entrée dans notre groupe.
La décision fut prise ce jour-là de mettre en chantier une pièce de Musset, Il ne faut jurer de rien, que j'avais
envie de monter depuis longtemps car j'étais fasciné par le personnage de Cécile, la petite jeune fille à la fois
rouée et naïve qui parvient à se faire épouser par Valentin. Or il se trouvait que Françoise était idéale pour le
rôle. Je rêvais, comme toujours, d’être le metteur en scène de cette créature délicate dont je saurais exalter le
charme. Depuis quelques temps d'ailleurs elle se transformait, forçant sur son maquillage, portant des
vêtements de plus en plus provocants et des talons qui accentuaient la cambrure de ses reins. Quand elle me
parlait elle posait parfois la main sur mon bras et cela me faisait frissonner. Je lisais donc et relisais la pièce de
Musset avec passion, l’imaginant se déplaçant, tournant la tête, se déhanchant sur mes indications. Je
connaissais par cœur le moindre de ses gestes. Pour moi, la mise en scène c’était cela : jouer avec mes acteurs
comme je le faisais jadis avec mes soldats de plomb. Le reste ne m’intéressait pas. Et les personnages de la
pièce, en l'occurrence, correspondait exactement aux acteurs dont je disposais : Outre Françoise dans le rôle de
Cécile, Danièle serait la baronne, Paul un superbe oncle Van Buck - il en avait le poids et la prestance - quant à
Christian, il était l'incarnation même du héros de Musset, avec son visage fin et son charme un peu féminin.
Notre nouvelle recrue, l’étudiante brune qui s’appelait Claudie, ne se sentait pas encore de taille à tenir un rôle
mais elle nous servirait de souffleuse. Son fiancé pourrait faire le maître à danser, quant à l’ami, Jean-Marie, il
composerait une figure amusante d'abbé avec ses petits yeux bleu acier dissimulés derrière des lunettes fumées.
La recherche des costumes fut l'occasion de nombreuses sorties aux Puces. Françoise en profitait pour essayer
des chapeaux qui lui allaient toujours à ravir, Jean-Marie trouva une véritable soutane qui fit pousser à Paul des
cris d’enthousiasme ; « - Une folle ! c’est une folle !… » Danièle trouva une robe à perles plus belle-époque
que romantique mais qu'importe ! Nous partions dans de grands fous-rires, nous étions heureux d'être
ensemble, heureux de faire du théâtre, nous avions projeté de partir en tournée pendant l'été. En attendant nous
jouerions au Foyer International qui possédait, outre le salon dans lequel nous venions de faire notre récital, une
véritable petite salle de théâtre.
Ma vie se déroulait donc comme dans un rêve : j'étais entouré d'amis, de jolies filles, de gens intelligents. Il y
avait les répétitions au Théâtre Antique, aux Trois Masques, au Groupe de Lettres Modernes, il y avait les nuits
dans les cabarets !… Mes parents ne me voyaient plus guère : « - Tu vas tomber malade ! » me disaient-ils. Ils
auraient voulu me retenir dans le cocon qu'ils avaient reconstitué en y accumulant tout ce qu'ils avaient enfin
retrouvés après l’avoir sorti du garde-meuble : les tableaux de mon grand-père, les Gallé, la commode Louis
XV, le buffet arlésien, l’armoire en acajou. C'était un amoncellement de cristaux, de porcelaines, de moulures
encaustiquées, de dorures anciennes, de vases orientaux, de coupes de cristal, de chandeliers en bronze, de
plateaux en cuivre. Les deux Gallé, glauques et monstrueux, avaient trouvé leur place de part et d’autre de la
cheminée.
Mes parents, eux aussi, avaient réalisé leur rêve : ils s'en étaient sortis. Un petit héritage providentiel leur
permit de payer l'appartement qu’ils venaient d’acheter. Bientôt mon père partirait à la retraite, il n'aurait plus à
supporter ses collègues. Une seule chose mettait ma mère en fureur, c'était les arabes quand elle en voyait dans
la rue : « - Pourquoi viennent-ils nous poursuivre jusqu'ici ! on leur a rendu leur pays, qu'ils y restent ! » Parfois
au contraire elle s'attendrissait sur un ouvrier algérien travaillant dans un chantier : « - Comme il doit avoir
froid ici ! Est-ce qu'il est d'Alger lui aussi ? » Et puis comme toujours c’était les mêmes litanies : « - Tu ne nous
racontes jamais rien, tu nous considères comme des étrangers !... Qui est cette Danièle que tu vois tout le temps
? Tu ne songes pas à l'épouser au moins ! Mais pourquoi ne fréquentes-tu donc pas des jeunes gens de ton
milieu ? Ton père n'a pas fait d'études mais toi, ce n'est pas pareil... » Mon père compulsait des guides pour
chercher ce que je pourrais faire plus tard. Il comparait l'indice d'un sous-préfet, avec celui d'un colonel et il
avait vu que celui d'un professeur de faculté correspondait au grade de général...

Leur bonheur venait buter contre cette incompréhension qui s'était installée entre nous. Nous qui nous étions
tellement aimés ! je me souvenais des matins d'autrefois, lorsque je sortais de l'école de la rue Roland-de-Bussy
et que je me jetais dans les bras de ma mère. J'étais déchiré aujourd'hui par cette insatisfaction, cette demande si
pressante dont j'étais l'objet et qu'il m'était impossible de satisfaire. Je me sentais coupable de ne pas leur rendre
ce qu'ils m'avaient donné. Je les aimais au point de ne pouvoir rien aimer d'autre et je sentais bien que ce que je
vivais par ailleurs reposait sur une illusion : je comptais sur le génie de mes camarades pour réussir, je faisais
semblant d'être leur chef mais en réalité je n'étais rien. Je me rendais compte que l'équilibre de la troupe était
fragile. Paul en effet s'éloigna de nous, il avait d'autres sollicitations, il était futile et capricieux. Il renonça au
vieil oncle Van Buck que je dus jouer à sa place. Je le revis un jour, des années plus tard, dans le foyer d’un
théâtre. Il était en grande conversation avec Pierre Cardin et me fit signe de loin, à sa manière mondaine et
dédaigneuse, puis vint me dire quelques mots et me demanda si j’avais des nouvelles de Christian. Je n’en avais
plus aucune depuis longtemps. Il avait toujours son oeil pervenche et ses cheveux blonds, mais son visage
s'était comme parcheminé en vieillissant et plus que jamais il me fit penser au baron de Charlus.
Après l'éloignement de Paul, ce fut au tour du petit Bob qui partit faire son service militaire. Nous le
rencontrâmes pour la dernière fois au Flore, le matin de son départ. Chacun lui avait apporté un petit cadeau
d'adieu et il s'en alla rejoindre son régiment les bras chargés de savonnettes parfumées et de flacons d’eau de
Cologne. Il avait toujours l'air d'avoir dix-sept ans avec ses grands yeux noirs et nous remercia de tout ce que
nous avions fait pour lui. Il ne nous connaissait que depuis quelques mois mais cette rencontre avait changé sa
vie. Combien d'autres par la suite purent en dire autant ! Françoise nous quitta elle aussi. Depuis quelques
temps je la rencontrais souvent avec des garçons dans la cour de la Sorbonne. Derrière sa grâce diaphane
transparaissait quelque chose de rebelle. Elle portait des jupes de plus en plus courtes et entourait ses yeux d'un
trait charbonneux. Il me fallut la remplacer et le rôle de Cécile échut à la grosse Annie qui ne pourrait en faire
qu'une caricature grotesque mais je n’avais personne d’autre sous la main. Enfin l’important c’était que la
troupe continuât d’exister vaille que vaille. Danièle en était toujours l'âme. Jean-Marie, toujours aussi discret
derrière ses lunettes fumées, prenait de plus en plus d’importance. Outre le rôle de l'abbé il s’était chargé de
construire les décors et se révéla dans ce domaine remarquablement efficace. Il était le seul d'entre nous à
savoir régler les problèmes matériels. D’ailleurs on sentait en lui une maturité supérieure à la nôtre ce qui lui
faisait garder à notre égard une certaine distance bien que sa complaisance fût inlassable. Il m’aimait tout
particulièrement je ne sais pour quelle raison, peut-être parce que je venais d’Algérie car il professait des
opinions d’extrêmes droite et établit ainsi avec moi une complicité qui nous opposait aux autres bien que les
dissensions politiques n’aient eu aucune incidence sur les rapports que nous entretenions entre nous. Danièle,
par exemple, se déclarait fervente communiste. Or, un matin que j’étais allé la trouver chez elle, je ne sais plus
pour quelle raison, je fus stupéfait de la trouver au lit avec Jean-Marie. Le tableau me laissa perplexe : d’une
part parce que je n’en avais rien soupçonné, d’autre part parce que je me demandais bien ce qu’il pouvait lui
trouver car je l’avais définitivement catalogué pour ma part dans la catégorie des femmes laides avec lesquelles
aucune relation de ce genre n’était envisageable. Mais ils ne semblaient nullement gênés ni l'un ni l'autre que je
les aie surpris. Décidément il fallait bien me résoudre à l’évidence. Tout ce qui concernait les relations entre les
hommes et les femmes me demeurait impénétrable.
Alain, l’ami de Jean-Marie professait les mêmes opinions que lui. Je crus d’ailleurs savoir que son père avait
été ministre sous Vichy. Il habitait avec sa mère un splendide appartement boulevard Raspail et nous y fûmes
reçus un jour. La mère nous accueillit avec beaucoup d'amabilité (en lui demandant discrètement de remonter
sa cravate). Claudie, la fiancée, était là, toujours aux petits soins pour lui. Bien que peu jolie, comme je l’ai dit,
elle avait un certain charme et surtout elle était avide de plaire. Elle me fit donc beaucoup d'avances qui me
flattaient. Lorsque nous sortions le soir et que je l'invitais à danser, elle se serrait contre moi. C'est ainsi qu'elle
prit peu à peu la place de Danièle dans le rôle de confidente. Mes parents ne doutèrent pas qu’ils tenaient là ma
future épouse. Ils en étaient ravis d'ailleurs car ils avaient appris que son père était directeur de l’École des
Beaux-Arts. Mais comment pouvais les détromper ? comment pouvaient-ils comprendre que pour moi il n’en
était pas question parce que je la trouvais laide. C’était pourtant la seule raison mais elle était rédhibitoire. Et
attendant je m’en étais fait une camarade, faute de mieux. Nous allions ensemble au cinéma, au restaurant, et je
pouvais me donner l'illusion ainsi d’avoir une « petite amie ».
NB: Si vous avez raté un épisode, vous pouvez reprendre le feuilleton dans son déroulement depuis le début en
cliquant sur la rubrique: "Le roman d’un homme heureux" (Feuilleton autobiographique de Pierre Parlier)
Vous pouvez lire les commentaires et ajouter le votre sur le format parchemin du site internet.

1
/
4
100%