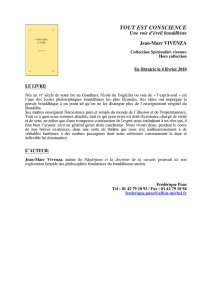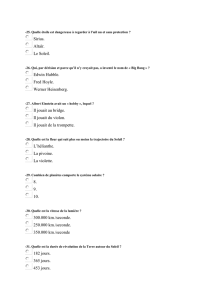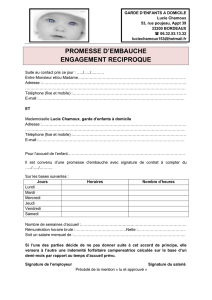Rideau (25) - Le Château d`Avanton

Rideau
(25)
roman
de
Pierre
Danger
Le lendemain elle téléphone à Mme Pons, un peu avant l’heure où celle-ci vient la chercher d’ordinaire, pour
l’avertir qu’elle est revenue et qu’elle l’attend.Mais à sa grande surprise, au lieu de manifester sa satisfaction de
la revoir, Mme Pons lui semble toute décontenancée : « - Comment, déjà ! mais je croyais que vous étiez partie
! – Je suis rentrée. Je vous raconterai. Vous venez me chercher tout à l’heure, n’est-ce-pas, comme d’habitude ?
– C’est-à-dire… notre ami Paolo m’a proposé d’aller avec lui à l’opéra ce soir. Sa femme doit chanter dans la
Bohême et je crains que nous ne puissions trouver une troisième place, c’était déjà complet. » Lucie la rassure
aussitôt, lui affirmant que cela n’a aucune importance et qu’elle se verront demain. Le soulagement de Mme
Pons est manifeste : « - Eh bien, c’est parfait, alors à demain, et pardonnez-moi. » Elle n’a même pas songé à
me demander ce que j’ai fait ! songe Lucie avec dégoût. Ainsi il ne lui a fallu s’éloigner qu’une seule journée
pour que l’autre en profite. Après tout la chose serait plutôt comique si elle n’était pas triste. Mme Pons avait
donc des vues sur cet homme ! Mais Paolo ne pense qu’à sa femme. Qu’espère-t-elle ? Décidemment encore
aujourd’hui Lucie continue à ne rien comprendre aux autres. Il faut croire que chacun est prêt à n’importe quoi
pour échapper à sa solitude. Elle, elle ne cherche rien, par manque d’imagination peut-être ou par manque
d’élan. Les choses ne prennent leur sens que beaucoup plus tard, quand elle se sont transformées en souvenirs.
Sur le moment elle est incapable d’en saisir la portée, incapable d’en jouir. Cette avidité au plaisir qu’elle
observait chez les autres elle en avait toujours été une spectatrice étonnée. C’est peut-être la raison pour
laquelle elle ne parvenait pas comprendre non plus comment elle pouvait constituer elle-même un objet de désir
pour les autres. Cela lui était proprement inconcevable. Elle le constatait simplement et tentait plus ou moins
maladroitement d’en profiter. C’est ainsi qu’après le départ de ses parents lorsqu’elle s’était retrouvée seule à
Paris et quelle s’était inscrite dans un cours de théâtre pour tenter de débuter dans la carrière, elle s’était vite
rendue compte que quelque chose en elle attirait le regard des hommes et lui ouvrait comme par magie les
portes auxquelles ses camarades frappaient en vain. Elle était belle, elle ne savait pas exactement ce que ça
voulait dire mais elle ne pouvait en nier l’évidence. Cette beauté s’augmentait peut-être de sa propre absence de
désir pour les hommes à laquelle s’ajoutait maintenant la connaissance de ces choses qu’elle avait acquise
auprès de Richard. Elle était exactement capable en ce domaine de faire tout ce qu’il convenait de faire pour
servir son intérêt, moins par ambition que par indifférence. En un mot elle couchait. Elle le faisait autant qu’il
fallait, mais ce n’était qu’un jeu. Des dizaines d’autres autour d’elle étaient prêtes à en faire autant, mais Dieu
sait pourquoi c’est avec elle que ça marchait. En quelques mois elle passa des figurations aux seconds rôles
puis au rôle principal dans la reprise d’une pièce d’Édouard Bourdet qui avait été créée jadis par Yvonne
Printemps. Elle jouait le personnage de la Reine Margot dans une histoire trouble d’amours incestueux qui lui
donna d’entrée une réputation quelque peu sulfureuse. La critique la remarqua. Elle ne pensait qu’à Richard.
Tout le reste lui était indifférent. Richard n’avait pas répondu à sa lettre, c’était maintenant un fait avéré,
plusieurs mois étaient passés et il n’y avait plus rien à espérer de ce côté-là, elle ne le reverrait plus. Elle n’avait
aucune nouvelle des autres non plus. Ce n’est que bien plus tard qu’elle apprendrait que Philippe publiait des
livres, quant à Mathilde, elle avait réalisé incidemment, un jour, ce que signifiait ces pansements qu’elle avait
aux poignets la dernière fois qu’elle l’avait vue. Elle en avait eu l’illumination comme ça, en soupant avec des
camarades. On parlait d’une jeune comédienne qui avait fait une tentative de suicide en s’ouvrant les veines
dans sa baignoire parce qu’on lui avait refusé un rôle et elle s’était écrié tout à coup : « - Mais mon Dieu, que je
suis bête ! » Et comme on lui demandait pourquoi elle disait ça, elle avait expliqué qu’elle avait une amie
autrefois qui avait tenté elle aussi de se suicider en s’ouvrant les veines et quand elle l’avait vue avec ses
pansements elle avait cru qu’elle était allé donner son sang. On bien ri, on s’étaient moqué d’elle. Au fur et à
mesure que sa carrière se développait cette indifférence s’aggravait. Elle jouait mécaniquement et le succès lui
était indifférent. La plus grande partie de l’année se passait en tournées dans les villes de province où elle était
reçue comme une reine par les notabilités locales qui organisaient pour elle des réceptions après le spectacle et
s’enorgueillissaient de la recevoir chez eux car elle commençait à avoir une certaine notoriété. Les hommes la
dévoraient des yeux, lui faisaient la cour ou parfois carrément du genou sous la table. En général tout ceci ne
prêtait pas à conséquences, le lendemain elle était ailleurs. Ses amants, elle les choisissait plutôt parmi ses

camarades, dans d’autres soirées, celles qu’on organisait entre soi, plus chaleureuses, plus débridées. Elle
évitait les jeunes gens de son âge, elle préférait les plus vieux, ceux qui avaient vingt ans de carrière derrière
eux et qui n’avaient plus rien à espérer, qui seraient éternellement des seconds rôles et qui pourtant continuaient
à avoir le « feu sacré » comme ils disaient. Ils vivaient en général en célibataire, dans les modestes pied-à-terre
que leurs cachet leur permettait de s’offrir à Montmartre ou à Montparnasse ; ils se prenaient suivant le cas
pour de grands séducteurs, de grands aventuriers ou de grands intellectuels, et se faisaient la tête de l’emploi.
Au lit, ils étaient émouvants comme des enfants, émerveillés de l’avoir conquise, elle, cette jeunesse, belle
comme l’aurore, ils en perdaient leurs moyens, qui ne devaient pas être bien grands. Alors elle savait y faire,
elle la leur jouait canaille. C’est à ce moment-là que les leçons de Richard lui profitaient. Dans les petites
cochonneries dont elle les régalait c’est à lui qu’elle pensait. C’était sa façon de lui rendre hommage, de
racheter la petite oie blanche qu’elle était quand il l’avait découverte et dont maintenant elle avait un peu honte.
Inutile de dire que ses amants en demeuraient baba. Cette fille si belle et dont le visage à la scène comme à la
ville incarnait une sorte d’innocence rebelle leur tombait dans les bras, et sans s’inquiéter de leur médiocrité, de
leurs insuffisances, de leurs petites infirmités, leur donnait à pleines brassées tout ce qu’ils n’avaient jamais osé
espérer, flattait leurs vices secrets, les petites envies honteuses qu’ils n’avaient jamais pu satisfaire jusqu’ici. Ils
étaient dans le même état que s’ils avaient pour une fois décroché un rôle avec un grand metteur en scène. Et
elle, elle les aimaient parce qu’ils étaient soumis comme des chiens, ne demandant rien, ne se plaignant de rien,
supportant ses infidélités, ses départs, ses retours, n’ignorant rien des succès de leur rivaux. Ils avaient fini par
former entre eux une sorte de confrérie. Un seul, qui passait pour fou ou faisait semblant de l’être parce qu’il
avait joué Hamlet sur la scène du Palais des Papes, l’avait emmenée un jour dans une auberge de campagne et
avait sorti de sa poche une dague dont il voulait la transpercer pour la punir de l’avoir trompé. Elle avait dû
s’enfuir dans les couloirs au milieu de la nuit, poursuivie par le jaloux qui voulait la tuer. Les semaines
suivantes il lui écrivait des lettres pathétiques pour se faire pardonner, auxquelles elle n’avait jamais répondu.
La carrière de Lucie se poursuivait ainsi de spectacle en spectacle. Elle triompha dans la Chapelle Ardente de
Gabriel Marcel au Gymnase et Liebelei d’Arthur Schnitzler. On parla d’elle un moment pour la Comédie
Française, ce qui lui semblait naturel : elle n’avait jamais douté de son talent. Son professeur ne lui avait-elle
pas dit qu’elle serait un jour « l’ambassadrice du théâtre français à l’étranger » ? Elle repensait souvent à ses
débuts, là-bas, au conservatoire, quand elle concourrait sur la scène de l’Opéra. Elle repensait à André Gornès,
au petit Domino, à Anne-Marie Fleishmann. Que devenaient-ils ? Ils devaient entendre parler d’elle pourtant !
Peut-être venaient-ils voir ses spectacles mais ils n’osaient pas ensuite se rendre dans sa loge par timidité ou par
jalousie. Une seule fois c’est elle qui avait revu André Gornès. Elle s’était aperçu en passant à Valence lors
d’une de ses tournées qu’il jouait dans un petit théâtre une pièce qui s’appelait l’Empire de la Nuit. La surprise
qu’elle avait eu en voyant son nom sur l’affiche ! Elle y était allé le soir même. La pièce était terriblement
ennuyeuse. Il y tenait le rôle d’un aveugle. Quand elle était allé le féliciter ensuite il n’avait même pas eu l’air
étonné de la voir. Il ne lui avait parlé que de lui, de ses projets, la pièce devait être reprise à Paris la saison
suivante et il comptait bien sur ce rôle pour se faire remarquer. Il lui avait répété encore une fois que le théâtre
était toute sa vie, et qu’il était prêt à tout pour réussir. Et puis elle n’avait plus jamais entendu parler de lui.
Elle, ce qu’elle aimait c’était ce frisson qui la parcourait au moment d’entrer en scène, ce sentiment où l’orgueil
se mêlait à la honte, l’orgueil de dominer son public et la honte de se donner à lui. Exactement comme dans
l’amour.
NB: Vous pouvez suivre le déroulement de ce roman depuis le début en cliquant sur la rubrique "Rideau" de
Pierre Danger
Vous pouvez lire les commentaires et ajouter le votre sur le format parchemin du site internet.
1
/
2
100%