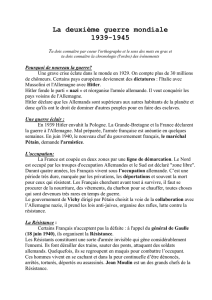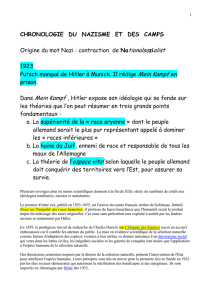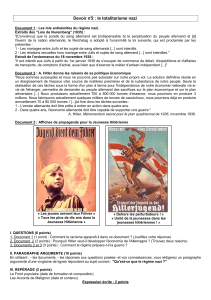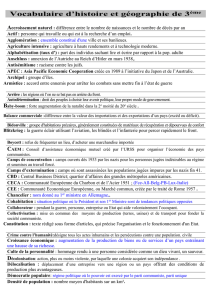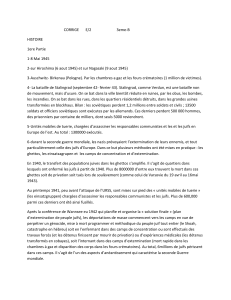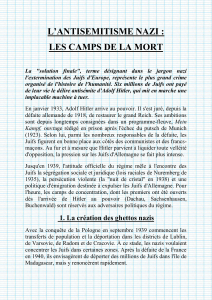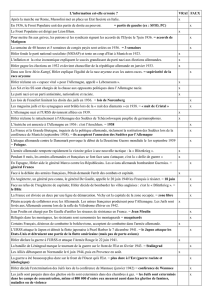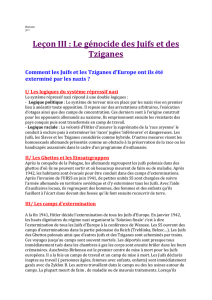Documents - Salle 309

Partie 1
1
De l’idéologie
Le national-socialisme opposé aux valeurs libératrices ou émancipatrices de l’homme,
héritées du siècle des Lumières et de la Révolution française (liberté de conscience, liberté
d’expression, égalité devant la loi, …)
Etymologie : contraction du mot allemand nationalsozialismus, national-socialisme.
Le nazisme (ou national-socialisme) est l'idéologie totalitaire du NSDAP (parti national-socialiste des
travailleurs allemands), parti politique apparu en Allemagne en 1919.
Elaboré par Adolf Hitler (1889-1945) et exposé dans son livre, à la fois autobiographique et
idéologique, "Mein Kampf" en 1925, le nazisme est fondé sur le principe de la supériorité de "la
race aryenne", sur la conquête d'un "espace vital" pour l'Allemagne et sur l'extermination de
"races" et de peuples considérés comme "inférieurs".
Dictature politique totalitaire s'inspirant du fascisme italien, le régime nazi est instauré en Allemagne
de 1933 à 1945. Puissamment relayé par les instruments de propagande, cette idéologie exalte le
nationalisme allemand (pangermanisme), le groupe au détriment de l'individu et le culte fanatique du
"Führer" (le guide), le chef charismatique qu'est Adolf Hitler.
Raciste et antisémite, le nazisme est hostile à la liberté de la presse, à la démocratie, au suffrage
universel, au syndicalisme, au libéralisme et surtout au communisme. Il cherche à rallier la classe
ouvrière en prônant l'union des classes sociales dans une même communauté nationale homogène.
Outre sa politique expansionniste qui a provoqué la Seconde guerre mondiale, le nazisme a procédé à
l'extermination des Juifs (Shoah) et des Tziganes dans des camps de concentration.
Le nazisme est une idéologie d'extrême droite faisant l'objet de deux interprétations possibles par les
historiens :
- un système totalitaire spécifique, essentiellement raciste et antisémite;
- une des formes du fascisme.
Dans Mein Kampf, Hitler expose sa doctrine pseudo-scientifique du racisme.
Quant à Hitler lui-même, c’est un personnage complexe où l’intelligence frustre est compensée par une
volonté inflexible devant laquelle aucun obstacle ne saurait compter, à commencer par celui de la
morale. Il n’aime pas la guerre pour elle-même mais l’envisage comme un moyen de faire triompher
« son combat » et aussi comme l’instrument de « sélection naturelle » de la race supérieure. En tout
cas, l’Allemagne sera une puissance mondiale ou ne sera pas ». le retour de l’Allemagne de Weimar,
de 1924 à 1929, à la stabilité et à la prospérité (notamment grâce aux facilités apportées au paiement
des réparations par le plan Dawes) n’est guère propice aux extrêmes, que ce soit de droite ou de
gauche. A la mort du président Ebert en février 1925, c’est l’ancien généralissime Hindenburg qui est
élu président de la République avec 14 600 000 voix contre 13 700 000 au candidat des modérés, 2
000 000 aux communistes et seulement 200 000 à Ludendorff, candidat de l’extrême droite,. En
1929, en dépit de l’activité intense de propagande que déploie Hitler, devenu chef du NSDAP, des
meetings à grand renfort d’étendards et de chemises brunes, d’un journal (le Völkisher
Beobachter), d’une équipe d’activistes dévoués à sa personne et à sa cause (Hermann Göring,
Rudolf Hess, Alfred Rosenberg), le parti nazi ne compte que 120 000 membres.
L’idéologie nazie
Le racisme hitlérien tire ses origines de très anciennes traditions germaniques remises à la mode
avant 1914 par des théoriciens comme Wilhelm Marr et Henri Class, les Français Gobineau,
Vacher de Lapouge et Jules Soury, ainsi que par le Britannique H.S. Chamberlain, devenu sujet
allemand et gendre de Richard Wagner. Il se rattache également à l’esprit Völkisch qui domine
pendant les années de la République Weimar toute la pensée de l’extrême droite nationaliste.
Pour Hitler, qui s’inspire également en les déformant des thèses darwinienne, la vie est un
éternel combat dans lequel le plus fort impose sa loi aux plus faibles. Les races humaines,
biologiquement inégales, se trouvent elles-mêmes en lutte constante pour assurer leur survie ou
pour la domination des autres. Cette hégémonie revient de droit à la race blanche et, à l’intérieur
de celle-ci, au noyau aryen, représenté par des hommes grands, blonds et dolichocéphales,
particulièrement nombreux en Allemagne. De là, Hitler tire le principe d’une hiérarchie des

peuples dominées par les Allemands, la « race des seigneurs », auxquels seront associés les
groupes d’origine voisine (Flamands, Anglo-Saxons, etc.). en dessous viendront des peuples
censés être plus « mêlés », comme les Latins, puis les peuples « inférieurs » : Slaves, Noirs et
surtout Juifs.
L’antisémitisme se trouve ainsi placé au cœur de la doctrine nazie. Aux origines médiévales du
phénomène (l’antijudaïsme traditionnel) s’ajoutent des motivations nouvelles qui sont la haine
du capitalisme financier, que l’on assimile arbitrairement aux Juifs et que l’on oppose au
capitalisme industriel, fondé sur le travail, le rejet du marxisme (réputé élaboré par des « Juifs »),
voire celui du christianisme. De ces postulats fumeux, le dirigeant nazi tire également sa vision
d’un Etat totalitaire respectant le « principe aristocratique de la nature, ainsi que la justification
de sa politique extérieure conquérante fondée sur la notion d’ »espace vitale » (Lebensraum).
Histoire du XXème siècle, P.Milza et S. Berstein
Classification horizontale :
Politisch : Politiques /
Berufsverbrecher : Criminels /
Emigrant : Expatri allemand /
Bibelforscher : Tmoins de
Jhovah / Homosexuell :
Homosexuels / ArbeitsscheuReich
: Paresseux du Reich /
Arbeitsscheu : Paresseux.
Classification verticale :
Grundfarben : Classification
primaire / Abzeichen fr
Rckfllige : Classification des
rcidivistes / Strafkomp :
abrviation de Stafkompanies,
marquage pour les prisonniers de
la compagnie disciplinaire / Juden :
Juifs.
Autres : Jdischer Rasseschnder :
Littralement Honte raciale,
renvoie aux interdictions faites aux
Juifs de se marier avec des aryens.
Dsigne probablement les Juifs qui
ont eut une relation sexuel avec
des Allemands et autres personnes
ayant eu une relation sexuelle avec
des Juifs. Fluchtverdachtiger :
Prisonnier suspect de vouloir
s'vader. Beispiel : Politisch, Jude,
Ruckfllige, Strafkomp : Exemple
de la multiplication des marquages
: Ce dport est un prisonnier
politique juif rcidiviste incorpor
la compagnie disciplinaire du
camp.
Hftling : Prisonnier « apprci »
par les SS pour les dnonciations
faites sur les autres dtenus.
Sonder Aktion Kommando :
Soldats de la Wehrmacht
incarcrs pour refus d'appliquer
les ordres.
P ou T : Lettre qui dsigne la
nationalit du dport.

Partie 1
1
De l’idéologie
Le citoyen allemand au service d’une mythique communauté raciale
(Volksgemeinschaft) et de « son » Führer
L’individu n’a de valeur qu’en fonction de son apport la « communauté́ raciale »
Après 1936, alors que l’opposition politique avait été́ écrasée et que l’état hitlérien était solidement
établi, il ne demeurait plus en Allemagne d’individus ou de groupes qui auraient pu sérieusement le
menacer. si l’on envoyait encore des gens dans les camps de concentration pour des actes individuels
d’opposition, la majorité́ des prisonniers, dans les années suivantes, furent arrêtés parce qu’ils
appartenaient un groupe qui avait déplu au régime ou risquait de le faire. Ce n’était déj̀ plus
l’individu et sa famille qui étaient punis et menacés mais des fractions importantes de la population.
Ce transfert de rôle de l’individu au groupe, tout en coïncidant avec les préparatifs militaires en vue de
la guerre, avait pour but principal la domination totale d’un peuple qui n’était pas encore dépouillé́ de
toute liberté́ d’action. il fallait obliger l’individu disparaître dans une masse totalement malléable.
Bruno Bettelheim, Le cœur conscient, Robert Laffont, 1972, p. 345.
L’individu travaille dans l’intérêt du groupe
La lutte pour la vie consacre le groupe, non l’individu l’intérieur de ce groupe et au sein duquel il
doit prendre sa place pour travailler l’intérêt commun. La guerre est dirigée vers l’extérieur : c’est en
direction des allogènes que l’« exploitation » et le « manque de scrupules » sont permis.
Johann Chapoutot, La loi du sang, penser et agir en nazi, Gallimard, 2014, p. 215.
Tout Allemand a l’obligation de se plier aux normes imposées
il est caractéristique de l’état oppressif qu’il éprouve rapidement le besoin d’intimider ses propres
partisans. [...] Les actions de groupe enseignaient aux membres du parti qu’eux aussi étaient en danger
constant. ils savaient déj̀ ce qu’il en coûtait de s’écarter des normes [...].
il leur restait apprendre quel point il était dangereux d’avoir des convictions personnelles, quelle
que fût leur nature.
Bruno Bettelheim, Le cœur conscient, Robert Laffont, 1972, p. 353.
Hitler et la dépopulation de l’Europe
il nous faudra une technique de la dépopulation. J’entends par ce terme l’anéantissement de
groupements entiers – je parle de groupements ethniques – et je suis résolu accomplir cette œuvre
d’extermination car elle constitue l’une de mes tâches. La nature est cruelle ; donc, nous avons
également le droit d’être cruels. si j’ai le droit d’envoyer la fine fleur du peuple allemand dans l’enfer
de la guerre, sans m’arrêter au sacrifice d’un sang infiniment précieux, j’ai évidemment aussi le droit
d’exterminer des millions d’individus appartenant une race inferieure et qui se reproduisent comme
la vermine.
Propos de Hitler extraits des mémoires de Rauschning, entretien avec Hitler, cité par Joe J.
Heydecker et Johannes Leeb, Le procès de Nuremberg, éd. correa Buchet/Chastel, 1959, p. 273.
(Rauschning était l’ancien président national-socialiste du sénat de Dantzig l’époque o la ville était
encore un Etat libre.)
Scène de rue à Berlin, hiver 1932 – 1933
« Au début de la soirée je me trouvais dans la Bülowstrasse. Il venait d’y avoir un grand meeting nazi
au Sportspalast ; des groupes d’hommes et d’adolescents en sortaient, vêtus de leur uniforme brun ou
noir. Trois S.A. marchaient devant moi sur le trottoir, chacun portant, comme un fusil sur l’épaule, un
drapeau nazi, roulé autour de sa hampe ; les hampes se terminaient par des pointes métalliques en fer
de lance.
Soudain les S.A. se trouvèrent face à face avec un garçon de dix-sept ou dix-huit ans, en civil, qui
courait dans la direction opposée. J’entendis un des nazis crier : « Le voilà ! » et aussitôt tous les trois
se ruèrent sur le jeune homme. Il poussa un cri, essaya de s’esquiver, mais n’en eut pas le temps.
L’instant d’après, l’ayant refoulé dans l’ombre d’une porte cochère, ils étaient en train de le battre et
de le frapper avec les pointes aiguës de leurs hampes. Tout cela s’était déroulé avec une rapidité si
invraisemblable que j’en croyais peine mes yeux. Déj les trois S.A., abandonnant leur victime,

avaient repris leur marche travers la foule, dans la direction de l’escalier qui conduit au métro aérien.
Je fus, avec un autre passant, le premier à atteindre la porte sous laquelle le jeune homme était tombé.
Il était là, tassé sur lui-même, gisant de guingois dans un coin comme un sac oublié. Tandis qu’on le
relevait, j’entrevis avec horreur son visage : l’œil gauche était moitié arraché et le sang s’écoulait de
la plaie. Il n’était pas mort. Quelqu’un s’est offert le transporter l’hôpital en taxi.
Entre-temps des douzaines de spectateurs s’étaient rassemblés. Ils avaient l’air étonnés, mais pas
spécialement émus : ce genre de choses est devenu trop courant. « Allerhand … » entendait-on
murmurer. À vingt mètres de l, au coin de la Potsdamerstrasse, se tenait un groupe d’agents de police,
armés jusqu’aux dents. Bombant le torse, la main sur le ceinturon du revolver, ils demeuraient
superbement indifférents à toute cette affaire. »
Extrait de Christopher Isherwood. Adieu à Berlin. Paris, Le Livre de Poche/Biblio, 2004, pp. 304 –
306.
Hitler entendait éveiller tout citoyen allemand à la conscience de son identité raciale ; mais pour de
nombreuses femmes, cet éveil allait de pair avec une prise de conscience politique. Les femmes
s’avisèrent alors d’agir conformément l’idée ambitieuse, parfois intimidante mais le plus souvent
stimulante, qu’elles devaient espérer davantage de la vie. En se penchant sur leurs Mémoires ou leurs
déclarations, on s’aperçoit que les furies de Hitler avaient nourri au temps de leur jeunesse un même
espoir : au terme d’une instruction basique, au seuil de l’âge adulte, elles s’étaient prises rêver d’une
vie plus exaltante. Banale aujourd’hui, cette aspiration était alors révolutionnaire. Les jeunes femmes
d’origine sociale modeste s’affirmaient en quittant leur village, en s’inscrivant des cours pour
devenir infirmières ou dactylo, et en adhérant à un mouvement politique. Pour les filles de ces femmes
qui avaient pu voter pour la première fois sois la république de Weimar, le champ des possibles était
vaste, en Allemagne et au-delà.
Il est rare que les femmes étudiées dans cet ouvrage d écrivent, ou même mentionnent, la politique
menée avant guerre par les nazis l’endroit des Juifs. Ainsi, Brigitte Erdmann, une artiste de music-
hall qui fut envoyée à Minsk pour divertir les troupes, écrivait-elle sa mère en 1942 qu’elle y avait
rencontré pour la première fois un Juif allemand. A la lecture de tels témoignages, on peut se
demander si ces femmes avaient conscience que la « question juive » était au cœur de l’idéologie
hitlérienne et si elles étaient informées du sort que l’on réservait aux Juifs. Bien sûr, les jeunes filles
élevées dans l’Allemagne nazie ne pouvaient ignorer la propagande grossière, les images, les affiches
et les journaux qui dépeignaient les Juifs comme des êtres inférieurs.
Les Furies de Hitler. Comment les femmes allemandes ont participé à la Shoah, par Wendy Lower
L’endoctrinement
L’endoctrinement a plusieurs fonctions : il met les modèles de réflexion et de foi l'abri des
interprétations alternatives et crée un monde imaginaire refermé sur lui-même. Les clichés sur l'ennemi
créent la distance et justifient la violence, protègent l'image de soi et effacent les conflits de
conscience. Les stéréotypes empêchent la perception individuelle de l'autre et créent une haine
abstraite l'égard de tous ceux qui sont différents. ils fournissent la condition intellectuelle d'une «
pensée de croisade » fanatisée qui nie son adversaire jusqu' sa qualité́ d'être humain. L'objectif de la
violence n'est plus alors la soumission d'êtres humains, mais l'extermination de créatures d'une autre
espèce, dont on ne considère plus qu'ils appartiennent au genre humain [...]. Les clichés sur l'ennemi
créent l'angoisse qui s'épanche dans la violence. L'endoctrinement libère des potentiels terroristes avec
lesquels le personnel tente de se libérer de sa propre peur [...]. Les séances éducatives étaient un
élément permanent de l'emploi du temps hebdomadaire dans la caserne [...]. Le but, ici, était cependant
moins de transmettre des connaissances que d'inculquer une attitude et de renforcer l'identification
l'organisation [...]. Le matériau de formation était extrêmement pauvre : une histoire allemande
défigurée par une héroïsation de l'esprit germanique, des légendes datant du « temps du combat » du
parti, quelques principes de racisme biologique et une série de stéréotypes de l'ennemi.
Wolfgang Sofsky, L’organisation de la terreur, Calmann-Lévy, 1995, pp. 139-140.
Une idéologie issue du mouvement vlkisch
Le socle de l’idéologie nazie est la pensée vlkisch qui se structure au moment de la fondation de
l’Empire allemand. Le mouvement vlkisch (de Volk, peuple en allemand) est un populisme de droite,
fondé sur une vision du monde centrée sur l’idée de nature, de race et d’identité. La pensée vlkisch se

développe partir des productions d’origine allemande telles celles des néoromantiques qui remettent
l’honneur une histoire et des traditions supposées germaniques. Le respect des lois naturelles et la
prédominance du peuple s’incarnent dans la figure du paysan allemand, valorisé dans une multitude
d’écrits très largement diffusés, comme l’a montré George L. Mosse dans son étude des racines
intellectuelles du nazisme. L’historien a souligné le fait que la pensée vlkisch se veut une réponse
l’industrialisation et l’urbanisation accélérée de l’Allemagne au XIXe
siècle qui inquiétent une partie
des élites traditionnelles.
Le mouvement vlkisch ne demeure cependant pas fermer aux influences extérieures.
Progressivement, il intègre les idées issues du darwinisme social, qui veut transposer l’humanité les
découvertes de Charles Darwin concernant le monde animal. Les écrits du Français Gobineau et de
l’anglais Chamberlain rencontrent un réel succès en Allemagne, davantage que dans leur pays
d’origine. Gobineau expose le principe de la diversité et de l’inégalité supposées des races humaines et
annone que le métissage, inévitable selon lui, se traduira par la disparition des races pures et
supérieures. Chamberlain, fervent admirateur de l’Allemagne, s’efforce de faire l’histoire de la race
germanique et de prouver sa supériorité, comme synthèse de la civilisation occidentale.
A la fin du XIXe
siècle, les idées vlkisch sont relayées dans la population par un grand nombre de
groupements et d’associations, actives notamment auprès des jeunes Allemands. Elles accompagnent
la montée en puissance politique et économique de l’Empire allemand. La primauté du peuple
allemand doit être assurée au nom des lois naturelles et raciales qui la fondent. En cela, les idées
vlkisch s’opposent radicalement aux idées socialistes qui défendent l‘égalité des droits naturels de
tous les hommes, héritage du siècle des Lumières et de la Révolution française, et la solidarité
internationaliste (ces idées trouvent leurs limites dans les politiques coloniales conduites par les Etats
européens). Si le mouvement vlkisch envisage une révolution conservatrice pour imposer ses idées, il
regarde vers le passé, tandis que le mouvement socialiste prépare une révolution prolétarienne
résolument tournée vers l’avenir.
L’idéologie vlkisch, le paysan et le Juif
Le paysan, qui devint le type même de l’individu véritablement vlkisch, non seulement incarnait les
vertus de simple justice et de bonté, mais était également fasciné par la force. Ce fut une importante
évolution, qui surgit peut-être des frustrations de ceux qui souhaitaient faire du Volk une réalité mais
dont les espoirs furent essentiellement contrariés par l’accélération de l’industrialisation. [...]
L’ennemi était présenté dans le même contexte que l’était le héros vlkisch. Au début du mouvement,
Riehl [professeur l’université de Munich, auteur de La terre et les gens, 1863] avait désigné le
prolétariat déraciné comme l’adversaire. Après lui, ce fut le Juif qui devint l’ennemi par excellence. La
littérature populaire, principalement des romans (qui se vendaient par millions), décrivait le Juif
étranger sous des formes stéréotypées d’un goût de plus en plus détestable. Les romans paysans en
plein essor décrivaient le Juif comme un être venu de la ville la campagne en vue de dépouiller le
paysan de ses richesses et de ses terres. C’était une évolution des plus insidieuses car, en spoliant le
paysan de ses biens fonciers, le Juif le coupait de la nature, du Volk et de la force vitale, le conduisant
inéluctablement la mort. [...]
George L. Mosse, Les racines intellectuelles du Troisième Reich. La crise de l’idéologie allemande,
Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 2006, page 61, pages 74-76
Les milliers de lignes consacrées dans Mein Kampf à l’idéologie national-socialiste peuvent se
ramener à une démonstration relativement simple.
Le nazisme est une Weltanschauung (« vision du monde ») basée sur la théorie dite du
« darwinisme social ». celle-ci postule qu’une « loi naturelle » organise les races humaines selon
le même ordre hiérarchique que les espèces animales : les races supérieures – les prédateurs –
luttent pour la suprématie ; les autres – les proies – pour survivre. En bas de la hiérarchie
« naturelle » des races végètent les « nègres », espèce intermédiaire entre le singe et l’homme. Au
sommet, dit Mein Kampf, trônent les aryens : « L’Aryen est le Prométhée de l’humanité ;
l’étincelle divine du génie a de tout temps jailli de son front lumineux ; il a toujours allumé à
nouveau ce feu qui, sous la forme de la connaissance, éclairait la nuit recouvrant les mystères
obstinément muets et montrait ainsi à l’homme le chemin qu’il devait gravir pour devenir le
maître des autres êtres vivants sur terre ; en quelques siècles la civilisation humaine
s’évanouirait et tout le monde deviendrait un désert. » Le sang détermine la race, poursuit Mein
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%