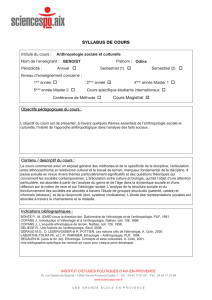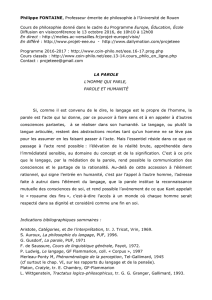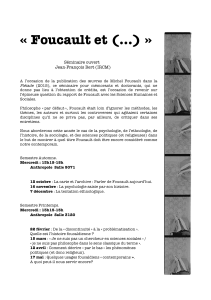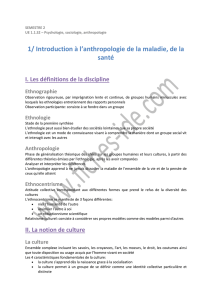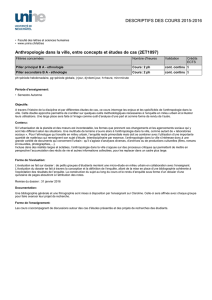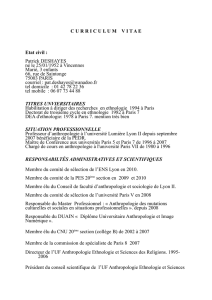1 Éléments d`épistémologie (Méthodes de la Science politique) Pr

Éléments d’épistémologie
(Méthodes de la Science politique)
Pr. Michel Bergès
Université des Sciences sociales de Toulouse 1
Premier semestre 2008
* Le cours étant en chantier, seuls les débuts ont été traités, la fin de la première partie comme une seconde étant
à venir.
Introduction : Définition auto-référentielle de l’épistémologie
Pour une épistémologie relativiste et culturaliste
Première partie
Éléments d’épistémologie externe des sciences
Introduction
Les fondements d’une épistémologie « externe » : l’histoire et la sociologie des
sciences.
Première sous-Partie : éléments d’histoire des sciences
Introduction :
Science et civilisation : pour une approche interculturelle
I. Éléments d’histoire des sciences de la nature
1. Généalogie de la Raison scientifique
Introduction :
Le débat sur les « origines » antiques de la science : « Orient » ou « Occident » ?
L’Inde et la Chine ne sont pas traités (éloignement par rapport à l’ère
méditerranéenne puis occidentale, même si les échanges culturels ont été réels).
1. 1. Le modèle oriental
– La Mésopotamie
– L’Égypte

2
1. 2. Le modèle grec
– La naissance de la raison théorique
– Naturalistes et humanistes
Conclusion : Bilan de la Science antique
Un bilan brillant
Des limites. Séparation logique, mathématiques, physique. Savants livresques.
Coupures avec la technique, à l’exception de Syracuse (cf. Archimède).
Faiblesse des instruments de mesure.
Importance des écoles de pensée, des supports matériels, des lois de
conservation et de diffusion du savoir (bibliothèques, livres, encyclopédies,
traités…).
Sur les conditions socio-politiques d’émergence de la Raison scientifique, cf. la
thèse de Geoffrey Lloyd (Pour en finir avec les mentalités). Compléter avec
Jean Lévi (Les Fonctionnaires divins. Politique, Despotisme et mystique en
Chine ancienne, Paris, Seuil, col. « La Librairie du XXe siècle », 1989).
Les mêmes formes de rationalité apparaissent en Chine comme en Grèce, entre
les Ve et le IIIe siècle a. c. Insister sur la comparaison.
Comment expliquer cette naissance croisée de ces formes de rationalité ?
Hypothèse du sociologue Durkheim :
Les catégories logiques de pensée ne sont pas universelles, sauf au niveau de la
forme, mais déterminées par les structures sociales dans leur contenu. Exemple
de Marcel Granet (La Pensée chinoise).
Le modèle de Jacques Pirenne :
La raison, la pensée rationnelle, libre, critique, naît dans les cités commerciales
et maritimes, qui luttent contre les systèmes terriens, continentaux, fermés, qui
asservissent les hommes. Liens avec la période médiévale.

3
2. Les trois « systèmes du monde »
Introduction : « Les trois systèmes du monde » (Fernand Braudel)
2. 1. Le premier « système du monde » d’Aristote et de Ptolémée
Continuité et discontinuité avec la Science antique
2. 1. 1. La première « Renaissance » du XIIe siècle
Platoniciens contre aristotéliciens : le retour des Grecs (via le monde musulman
de l’Espagne du Sud).
La révolution scolastique
Les sciences médiévales (l’empirisme, la perspective, la lumière, l’arc-en-ciel)
Enfermement dans le dogmatisme : déclin de l’Université de Paris au XIVe
siècle
2. 1. 2. La seconde « Renaissance » du XVe siècle
Les inventions et les « découvertes » vont contribuer lentement à l’émergence
d’une nouvelle conception de l’espace et du temps.
Le second retour du modèle grec, grâce aux intellectuels ayant fui Byzance prise
par les Trucs en 1453, qui s’installèrent en Italie, facilita un temps,
paradoxalement, le maintien des vieux paradigmes scientifiques.
Nicolas de Cues
Giordano Bruno
Paolo Rossi : L’importance des « ingénieurs » de la Renaissance. Les techniques
rejoignent la science théorique
2. 2. Le nouveau paradigme newtonien de l’espace
Pas de « révolution scientifique », mais une évolution lente vers la science
moderne.
Introduction : les apports des historiens des sciences. Alexandre Koyré, Pierre
Duhem, Thomas Kuhn, Gaston Bachelard, James Burke…

4
2. 2. 1. Les « dix étapes » de la destruction de l’aristotélisme
– Le Concile de Trente (1545-1582)
– Les canons des villes allemandes
– Ticho Brahé
– Galilée (1)
– Les Pays Bas
– La lunette de Galilée (2)
– Képler
– Descartes
– Spinoza
– Newton
2. 2. 2. Interprétations historiennes du « miracle » de la « Grande Révolution »
scientifique moderne
Cf. Pierre Chaunu (La Civilisation de l’Europe classique)
Des savants représentants de la bourgeoisie ?
Le rôle des éditeurs libres et le recul du latin
La démultiplication des instruments de mesure
La généralisation de l’esprit de positivité et le rôle de l’Encyclopédie
Les réseaux de savants (secrets, individualisés)
Les premières politiques publiques de la science
Conclusion : Les limites de la science moderne (cf. Gaston Bachelard, La
Formation de l’Esprit scientifique). « Des savoirs flottants », malgré les
avancées scientifiques.
Complémentarité, lenteurs, limites de chaque auteur scientifique (Jean Piaget).
Les remarques de Fernand Braudel.
Des usages sociaux idéologiques et politiques de la science. Cf. l’ouvrage de
Robert Darnton, La Fin des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution (Paris,
Perrin, 1984).

5
2. 3. Du second au troisième « système du monde »
2. 3. 1. Du « newtonisme social » au « positivisme »
2. 3. 1. 1. La politisation de la science : l’engagement des savants pour la
Révolution et l’Empire
– La science orchestre « la Révolution culturelle de l’An II » (Serge Bianchi)
Mesurer le temps et l’espace.
La Science, ça sert d’abord à faire la guerre (Des chaussures, des canons,
du salpêtre).
– Une nouvelle institutionnalisation du savoir
Des Grandes Écoles à la place de l’Université
Le nouveau système scientifique français
2. 3. 1. 2. La « révolution positiviste »
Introduction :
– L’internationalisation progressive de la science.
– La séparation science et philosophie (différences par rapport à l’esprit des
Lumières). Auguste Comte, comme symptôme :
Cf. Science et Vie : article d’Anne Petit :
« Face à une réalité politique dans laquelle les idéaux de 1789 se sont effrités, et
poursuivant le rêve de Condorcet, un re-faiseur de monde s’applique au début du
XIXe siècle à construire la théorie d’une société organisée selon les principes de
la Science. Il la nomme société positive. Mais au fil d’un long et patient
cheminement, il en arrive à une critique ouverte de la société des savants jugée
incapable d’assumer la mission organisatrice qui devait lui revenir. Ce
philosophe politique est polytechnicien et s’appelle Auguste Comte ».
Auguste Comte reprend en partie l’utopie de Francis Bacon (1561-1626), La
Nouvelle Atlantide (1627).
– Une ambition scientiste
Une idéologie européenne
Scientisme, valorisation de la méthode expérimentale, déterminisme,
quantitativisme et mécanisme.
– Les brillants résultats des sciences positives (Pasteur…)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
1
/
45
100%