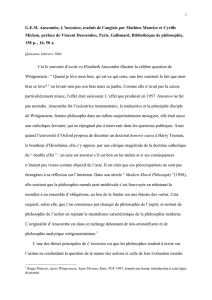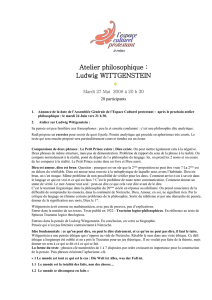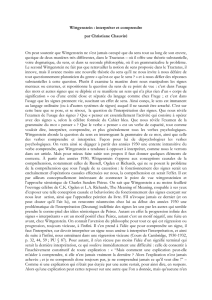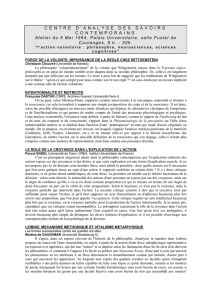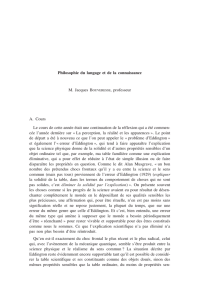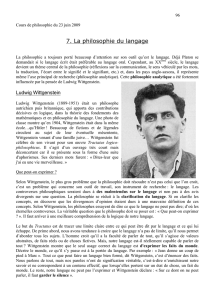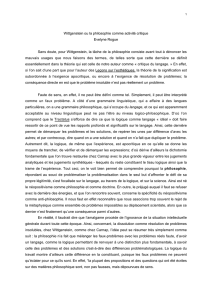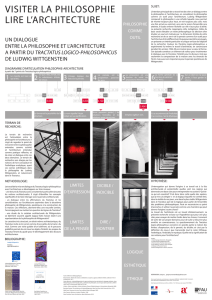Sur le sens du verbe « devoir - UChicago Voices

La philosophie morale
297
Note wittgensteinienne sur les acceptions multiples du nécessaire
Vincent Descombes
Je réunis ici quelques considérations sur la philosophie des modalités qui n’avaient pas
leur place dans un exposé exotérique, mais qui peuvent éclairer certains points abordés dans
le texte ci-dessus.
1. Sur l’intérêt philosophique d’une grammaire des modalités. On ne saurait sous-estimer
l’importance d’une réflexion sur les modalités pour une bonne intelligence des questions
philosophiques. Wittgenstein en était parfaitement conscient puisqu’il a écrit : « Il ne serait
pas absurde de dire que la philosophie est la grammaire des verbes “devoir” (müssen) et
“pouvoir” (können), car c’est ainsi que se découvre ce qui est a priori et ce qui est a
posteriori
1
. » En effet, c’est en examinant la fonction de ces verbes auxiliaires dans la
construction d’énoncés et la manière dont nous utilisons de telles constructions que l’on peut
démasquer l’a priori quand il s’exprime à la manière d’une constatation. Wittgenstein donne
un exemple : pour défendre le sérieux de la graphologie, on dit qu’il faut bien que le caractère
de quelqu’un s’exprime d’une façon ou d’une autre dans son écriture (es muß freilich der
Charakter sich irgendwie in der Schrift ausdrücken). Autrement dit, commente-t-il, nous
avons décidé d’appliquer de toute façon (irgendwie) une certaine image ou représentation
(Bild), excluant d’avance que les faits puissent la démentir. La nécessité de ce « es muß » est
celle d’une norme de représentation que nous fixons, elle est donc complètement a priori.
2. « Il n’est de nécessité que logique ». A l’époque du Tractatus logico-philosophique,
Wittgenstein soutient qu’il n’existe qu’une espèce de nécessité, la nécessité logique (6.37).
Elizabeth Anscombe fait remarquer que cette thèse est une « conséquence dogmatique » de la
théorie dépictive des propositions qu’il a exposée dans le Tractatus
2
. Qu’un état de choses
soit possible, cela est exprimé par le seul fait qu’une certaine combinaison de signes fait sens
dans le langage (5.525). Anscombe signale également la conséquence embarrassante d’une
telle conception des modalités : elle exclut la possibilité même d’une philosophie de l’action.
Wittgenstein, dans le Tractatus, ne recule pas devant cette conséquence : l’homme n’agit pas,
car il n’y a pas d’événements du monde qu’on puisse véritablement lui imputer comme son
action. Pour qu’un homme pût agir, il faudrait qu’il soit en position d’exécuter ses intentions.
Or cette exécution n’est pas garantie, car il n’y a pas de connexion logique entre la volonté et
le monde (6.374). N’étant pas logique, la connexion est contingente, de sorte qu’on ne peut
1
« Ursache und Wirkung : Intuitives Erfassen », p. 393 (dans L. Wittgenstein, Philosophical Occasions 1912-
1951, éd. par J. Klagge et A. Nordmann, Indianapolis, Hackett, 1993, p. 374 ; voir « Cause et effet : saisie
intuitive », trad. J.-P. Cometti dans L. Wittgenstein, Philosophica IV, Mauvezin, éditions TER, 2005, p. 77).
2
E. Anscombe, An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus, Londres, Hutchinson, 1959, p. 81.

La philosophie morale
298
pas imputer au sujet les événements du monde, mais seulement son attitude à l’égard du
monde pris comme un tout. « Le monde est indépendant de ma volonté » (6.373). Comme
Wittgenstein l’écrivait plus vigoureusement encore dans ses Carnets : « Je suis complètement
sans pouvoir » (11.6.16). Sans doute le sens commun voit-il les choses autrement : il y a des
choses que je fais, d’autres que je ne fais pas (Carnets, 4.11.16). Mais, en réalité, ma volonté
ne contrôle pas plus la partie du monde que je crois plus proche de moi que les autres parties
du monde : la connexion entre « Je veux lever le bras » et l’événement reste contingente .
La « philosophie de la psychologie » que Wittgenstein a développée ultérieurement a
été rendue possible par la levée du dogmatisme qui s’était exprimé dans le Tractatus. Une des
composantes les plus précieuses de cette psychologie philosophique est justement sa
philosophie de l’action. Désormais, le philosophe n’a plus à soutenir (contre le sens commun)
que l’homme n’est pour rien dans ce qui arrive dans le monde.
3. Le « peut » logique et le « peut » physique. En même temps qu’il développe l’analogie des
« jeux de langage » dans les notes de 1933-34 réunies dans le Cahier bleu, Wittgenstein met
désormais l’accent sur le fait que les verbes de modalité sont employés dans des significations
complètement différentes selon les contextes. Il ne s’agit plus de réserver le nécessaire et le
possible à la logique, il s’agit de ne pas confondre un emploi logique et un emploi non
logique, mais par exemple physique, des verbes « pouvoir » et « devoir ». Wittgenstein
s’attaque aux propositions philosophiques qui présentent des possibilités ou des impossibilités
logiques comme s’il s’agissait de faits généraux (autrement dit, si l’on peut s’exprimer ainsi,
comme autant de faits a priori concernant le monde). Par exemple, nous dirons qu’il n’est pas
possible d’énumérer tous les nombres cardinaux
3
. Pourquoi n’est-ce pas possible ? Ce n’est
pas parce que la tâche est au-dessus de nos forces, comme on dirait qu’il est impossible de
traverser l’Atlantique à la nage. Répondre ainsi serait suggérer qu’un être plus puissant que
nous pourrait réussir là où nous échouons. Mais la différence est justement là : on peut
essayer de traverser l’Atlantique à la nage, en ce sens qu’il est possible de décrire quelqu’un
en train d’essayer de réussir à le faire, et aussi de dire ce qu’il devrait avoir fait pour avoir
réussi, alors qu’on ne peut pas dire ce que doit faire quelqu’un pour essayer d’énumérer tous
les nombres cardinaux ni non plus ce qu’il devrait avoir fait pour avoir réussi.
4. Les « nécessités aristotéliciennes ». Wittgenstein est revenu maintes fois sur cette
distinction de la modalité logique d’avec la modalité physique. Or une telle distinction ne
suffit pas à rendre compte d’un troisième concept de nécessité, celui qui est mis en œuvre
dans ce qu’on appelle, à la suite d’Elizabeth Anscombe
4
et de Philippa Foot
5
, les « nécessités
aristotéliciennes ». Excellente dénomination, à l’appui de laquelle on peut invoquer l’autorité
de notre poète Corneille. Car les nécessités aristotéliciennes ne sont pas une invention de
quelques philosophes contemporains, elles correspondent à un usage du mot « nécessaire »
3
L. Wittgenstein, The Blue and Brown Books, Oxford, Blackwell, 1958, p. 54.
4
E. Anscombe, « On Promising an dits Justice », « Rules, Rights and Promises », « On the Source of the
Authority of the State », dans Ethics, Religion and Politics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1981.
5
Philippa Foot, Natural Goodness, New York, Oxford University Press, 2001.

La philosophie morale
299
que toute philosophie des modalités doit reconnaître. Corneille commente ainsi le précepte
d’Aristote sur les libertés que peut prendre le poète avec l’histoire ou la vraisemblance
lorsque cela est nécessaire :
Après avoir tâché d’éclaircir ce que c’est que le vraisemblable, il est temps que je
hasarde une définition du nécessaire dont Aristote parle tant, et qui seul peut nous
autoriser à changer l’histoire et à nous écarter de la vraisemblance. Je dis donc que le
nécessaire, en ce qui regarde la poésie, n’est autre chose que le besoin du poète pour
arriver à son but ou pour y faire arriver ses acteurs. Cette définition a son fondement
sur les diverses acceptions du mot grec qui ne signifie pas toujours ce qui
est absolument nécessaire, mais aussi quelquefois ce qui est seulement utile à parvenir
à quelque chose (Discours de la tragédie et des moyens de la traiter selon le
vraisemblable et le nécessaire, Seuil, L’intégrale, p. 840).
On qualifiera ici de nécessaire ce qui ne saurait manquer sans qu’une activité devienne
impossible, sans qu’un but devienne inaccessible, et, de façon générale, sans que nous soyons
privés d’un bien. Est donc nécessaire la chose dont nous avons besoin, la chose qu’il nous faut
pour accomplir notre projet, la chose à l’égard de laquelle nous sommes nécessiteux.
Autrement dit, une grammaire philosophique des modalités ne peut pas en rester à une
distinction de la nécessité logique d’avec la nécessité physique, elle doit aussi rendre compte
de la nécessité pratique, une espèce de nécessité qu’introduit la question pratique « Que dois-
je faire ? ». Or cette nécessité pratique ne doit pas être confondue avec ce qu’on appelle
aujourd’hui la nécessité « déontique », celle qui consiste dans une obligation (et cela bien que
le mot grec to deon puisse fort bien signifier une « nécessité aristotélicienne »).
Anscombe le fait remarquer, le verbe « devoir » n’a pas toujours le sens d’une obligation :
Quand nous avons les mots « devoir », « il faut », par lesquels nous rendons le grec dei
d’Aristote, nous devrions les prendre tels qu’ils figurent dans le langage ordinaire (par
exemple au sens où « nous devrions » apparaît dans cette phrase) et pas seulement tels qu’ils
figurent dans les exemples de « discours moral » que donnent les philosophes de la morale.
Les athlètes devraient poursuivre l’entraînement, les femmes enceintes surveiller leur poids,
les vedettes leur image de marque, il faut se brosser les dents […]
6
5. Les paradigmes de la nécessité. Il y a une place dans la grammaire philosophique de
Wittgenstein pour les « nécessités aristotéliciennes », à condition de prendre au sérieux une
suggestion qu’il fait à propos du mot « nécessaire ». Selon lui, une bonne part des difficultés
philosophiques que nous rencontrons en maniant le concept de nécessité provient de ce que
nous avons plusieurs « paradigmes » (comme il dit) de la nécessité. Dans les Leçons sur les
fondements des mathématiques (de 1939), il en indique trois
7
.
6
E. Anscombe, L’Intention, op. cit., §35, p. 118.
7
L. Wittgenstein, Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge 1939, éd. par Cora Diamond, The
University of Chicago Press, 1975, p. 241.

La philosophie morale
300
(1) Le premier paradigme du nécessaire qu’il mentionne est celui de la régularité. Cette
première explication du nécessaire n’est pas des plus claires. On dira en effet : en quoi le fait
qu’un phénomène se produise régulièrement est-il un paradigme de ce que nous entendons par
nécessaire ? Où est la nécessité que ce qui s’est produit régulièrement continue à le faire ? Y
a-t-il un lien entre les événements qui se produisent régulièrement ou fréquemment ou bien
sont-ils indépendants? Si la régularité est un paradigme de la nécessité, il s’agira d’une
nécessité qu’on ne comprend pas, qu’on ne peut pas expliquer. On ne peut manquer de penser
ici à ce qui est dit dans le Tractatus sur les lois de la nature (6.372). Nous parlons des « lois
de la nature ». Parfois nous les invoquons comme si elles expliquaient les phénomènes. Nous
sommes alors comme les Anciens qui expliquaient les choses par Dieu et le destin, avec cette
différence que nous ne sommes pas conscients d’avoir atteint la limite de l’explication.
En fait, Wittgenstein donne une version plus claire du paradigme de la nécessité
naturelle lorsqu’il évoque plus loin le nécessaire au sens de ce qui est imposé par la contrainte
physique : il y a nécessité que je sorte quand le gendarme me saisit par le collet et me pousse
dehors
8
.
(2) Le second paradigme du nécessaire est celui qu’on explique en disant « C'est nécessaire ...
faute de quoi ... ». Wittgenstein donne comme exemple une situation où l’on dirait : il est
nécessaire qu'il vienne ici, sinon il arrivera quelque chose de déplaisant. On reconnaît dans ce
paradigme le sens que prend le nécessaire dans l’ordre pratique : il s’agit donc du paradigme
de nos nécessités aristotéliciennes. En effet, qu’est-ce qui caractérise la nécessité pratique ?
C’est qu’elle s’exprime par une alternative. Dans l’exemple donné par Wittgenstein, une
certaine personne nous est nécessaire, au sens d’indispensable (nous ne pouvons pas nous
passer d’elle). Ou bien : elle doit absolument venir pour s’épargner les désagréments qui sont
inévitables si elle ne vient pas. Wittgenstein retrouve ici son idée selon laquelle un énoncé
comportant le verbe « devoir » ne peut tenir tout seul : il lui faut un contexte. En effet, un
« doit » absolu, c’est-à-dire présenté sans qu’on dise ce qui est exclu par là, est tout
simplement privé de sens.
Que veut dire le mot « doit » (soll) ? Un enfant doit faire cela, cela veut dire : s'il ne fait pas
cela, il va arriver quelque chose de déplaisant. Récompense et punition. L'essentiel à ce sujet
est ceci : l'autre personne est contrainte de faire quelque chose. Un « doit » n’a de sens que s’il
se trouve derrière lui quelque chose pour lui donner de la force - une puissance qui punit et
récompense. Un « doit » en soi est privé de sens. (Ein Soll hat also nur Sinn, wenn hinter dem
Soll etwas steht, das ihm Nachdruck gibt — eine Macht, die straft und belohnt. Ein Soll an
sich ist unsinnig
9
.)
Une nécessité pratique n’est pas quelque chose d’irrésistible comme le serait une
nécessité naturelle. Elle suppose une alternative et donc la possibilité, sinon toujours d’un
choix, du moins d’une évaluation. Il est remarquable que Wittgenstein loge dans ce registre le
problème du « tu dois » proprement éthique (tu dois faire ton devoir). On a parfaitement
8
L. Wittgenstein, Lectures on the Foundations of Mathematics , op. cit., p. 242.
9
L. Wittgenstein, Werkausgabe, t. III : Wittgenstein und der Wiener Kreis, Francfort, Suhrkamp, 1984, p. 118

La philosophie morale
301
raison de demander, à propos du « tu dois » éthique comme de tous les « tu dois » : et
qu’arrivera-t-il si je ne le fais pas ? Loin d’être incongrue ou mesquine, cette question est
parfaitement appropriée. En ce sens au moins, la philosophie doit poser la question du
« fondement » des nécessités morales (au sens de ce qui rend nécessaire la chose nécessaire)
si elle veut éclaircir le concept de ce type de nécessité. Mais, lorsqu’on en vient aux exigences
ultimes, au « tu dois » présenté comme inconditionnel, on assiste à un conflit de deux points
de vue. Du point de vue moral, nous sommes troublés à l’idée qu’on ferait son devoir parce
qu’on aurait peur d’être puni (par le motif de la « crainte du Seigneur ») ou, pire encore, pour
être récompensé. Mais, du point de vue logique, il est indispensable de trouver un sens à
l’alternative « ou bien tu fais cela … ou bien alors … », et il faut donc qu’on puisse indiquer
ce qui arrivera si j’agis bien et ce qui arrivera si j’agis mal.
Dans une section du Tractatus, Wittgenstein s’interroge sur le « tu dois » que nous
trouvons dans l’énoncé de la « loi éthique » (6.422 ). Que signifie ce « tu dois » ? En posant
cette question, on ne se demande évidemment pas : quelle récompense recevrai-je si je fais ce
que la loi morale dit que je dois faire, ni quelle punition subirai-je si je ne le fais pas ? Ce
serait dégrader le « doit » éthique que de le concevoir ainsi, sur un mode purement utilitaire.
Pourtant, la question des conséquences désirables ou indésirable doit pouvoir être posée : ce
n’est pas seulement une affaire de motivation, c’est une affaire de sens. Si l’on veut donner
satisfaction à cette condition sémantique tout en conservant au « doit » éthique sa dignité, il
faudra trouver une « récompense éthique » dans l’action elle-même plutôt que dans un
événement extérieur (santé, richesse, reconnaissance). Ce passage suggère donc, comme on
l’a souvent noté, une solution d’esprit stoïcien ou spinoziste : le malheur de l’insensé est dans
sa propre folie, la béatitude du sage est dans sa propre sagesse.
(3) Les nécessités conventionnelles. Le dernier paradigme d’une nécessité que mentionne
Wittgenstein dans cette leçon est celui des règles du jeu : elles créent des nécessités
conventionnelles. On dit : « Ceci est rendu nécessaire par la règle. » Par exemple, en
expliquant à quelqu’un les règles de notre jeu : « Ici, la règle dit que tu dois tourner à droite.
Là, elle dit que tu fais ce que tu veux. » La règle est donc comme une autorité qui nous dit ce
que nous devons ou pouvons faire. Pourquoi le dit-elle ? Pourquoi faut-il tourner ici à droite ?
Nous n’avons pas à le demander dès lors qu’il s’agit d’une règle qui définit le jeu (et non
d’une recette qui aurait à faire la preuve qu’elle est efficace au regard des résultats qu’elle
permet d’obtenir). Il n’y a pas de réponse, sinon que c’est pour qu’il y ait le jeu, pour qu’il
soit amusant, etc. Ce troisième paradigme nous invite à ne pas confondre une nécessité dans
le système et la nécessité du système lui-même. La règle du jeu rend nécessaires certaines
opérations, mais ces nécessités n’existent que dans l’espace du jeu. Une fois posée la règle, il
est nécessaire ici de tourner à droite. Mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait une règle
prescrivant de tourner à droite.
Est-ce à dire que les règles qui créent des nécessités conventionnelles soient elles-
mêmes arbitraires ? Wittgenstein ne soutient nullement cette thèse simpliste qui devait servir
de doctrine philosophique aux auteurs « post-structuralistes » des années 1960. Dire que les
règles que nous fixons sont conventionnelles ne veut pas dire qu’elles soient arbitraires ou
 6
6
1
/
6
100%