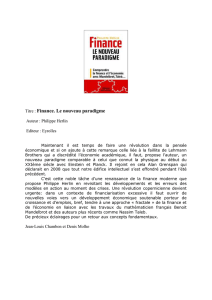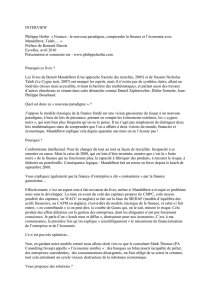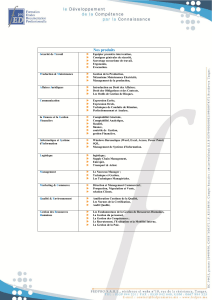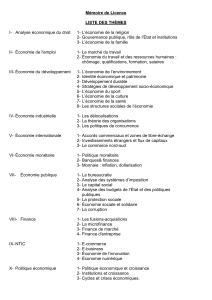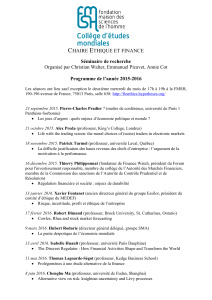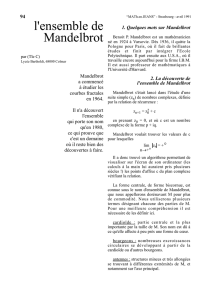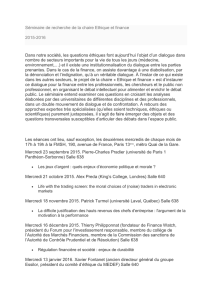Etude de dossier

ÉTUDE DE DOSSIER
______
Adjoint de direction 2012
Concours externe et interne
La finance est devenue ultra mathématisée à partir des années 70. La récente crise financière a
suscité des interrogations sur le rôle des mathématiques et en particulier des modèles
mathématiques en finance.
À partir des documents joints, dans le contexte de la crise financière, vous rédigerez une note sur
l’utilisation des modèles mathématiques et ses conséquences.
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS
1. « Où se trouve le risque ? »
Christian WALTER - Banque Stratégie n° 297 - Novembre 2011 - 2 pages
2. « De la théorie à la pratique - Est-il vraiment important que les marchés soient efficients ? »
Alfred GALICHON et Philippe TIBI - Revue Banque hors série - Mai 2011 - 7 pages
3. « Les dix péchés capitaux de la Value at Risk »
Philippe FOULQUIER et Alexandre LE MAISTRE - Banque Stratégie n° 303 - Mai 2012
5 pages
4. « The Case Against The modern Theory of Finance »
Benoît MANDELBROT - The (mis) Behaviour of markets – 2008 - Chapitre V - 4 pages
5. « Les modèles contribuent-ils à l’efficacité des marchés financiers ? »
Nizar TOUZI et Philippe DURAND - Revue Banque hors série - Mai 2011- 5 pages
6. « Est-ce la faute des « petits génies » en mathématiques ? »
Nicole CRESPELLE - La crise en questions - Éditions Eyrolles - 2009 - 1 page
7. « Une dangereuse sous-estimation de l’incertitude »
Philippe HERLIN - Alternatives Économiques hors série n° 87 - 1er trimestre 2011 - 3 pages
8. « Mathématiques et risques financiers »
Nicolas BOULEAU - Éditions Odile Jacob - 2009 - 1 page
9. « Les mathématiques financières et la crise financière »
Nicole EL KAROUI et Monique JEANBLANC- Matapli - Bulletin de liaison - Vol. 87
2008 - 6 pages
10. « Benoît Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques financiers »
Rama CONT - http://hal.inria.fr - 19/01/2012 - 6 pages

1
AD 2012 1/2 Banque stratégie n° 297
Novembre 2011
MODÈLES MATHÉMATIQUES
OÙ SE TROUVE LE RISQUE ?
La gestion alternative est-elle plus ou moins risquée que la gestion traditionnelle ?
Tout dépend des modèles mathématiques utilisés...
[…]
COMMENT MESURER LE RISQUE ?
Nous avons montré dans un article publié en 20051 comment l'idée de l'indexation et des benchmarks a
représenté dans la finance du XXe siècle la résurgence de la théorie de l'homme moyen du statisticien
et astronome belge Adolphe Quetelet. La résistance à l'indexation et au bornage systématique des
gestions représente la forme contemporaine des débats qui ont agité les statisticiens à la suite de la
domination de la théorie des moyennes dans les années 1860. La gestion « autre » que la gestion
bornée retrouve les arguments utilisés par les adversaires de la quételéisation massive de la statistique
au XIXe siècle : la moyenne (la performance du benchmark) ne peut représenter un critère qui résume
suffisamment le comportement réel des portefeuilles. Et la volatilité -qui n'est qu'un écart moyen à la
moyenne- relève du même dogme quételésien. La Value-at-Risk, lorsqu'elle se contente de transformer
une volatilité en quantiles, ne répond en rien au problème de la gestion du risque. Loin des moyennes.
L'idée sous-jacente à la catégorisation en classe spécifique de la gestion « autre » est celle de la
protection de l'épargnant (de l'investisseur) contre des risques mal cernés. Mais les risques sont-ils
moindres dans le cas de gestions bornées ? La diversification représente-t-elle une forme de gestion
moins risquée que celles que l'on trouve dans les gestions qualifiées d'« alternatives » ? Il est
couramment admis aujourd'hui qu'une gestion bien diversifiée et bornée est davantage protectrice pour
l'épargne qu'une gestion « alternative ». Or rien n'est moins sûr : ce raisonnement nécessite la
validation d'une hypothèse mathématique relative aux probabilités. Et il est connu aujourd'hui que
cette hypothèse est mise en défaut dans beaucoup de situations de marchés. Dans ces contextes, la
gestion non diversifiée (donc « autre » que la gestion classique) est plus protectrice et les portefeuilles
concentrés traversent mieux les crises que les portefeuilles diversifiés. En fait, croire que la
diversification protège bien revient à croire que les fluctuations boursières sont très régulières et bien
homogènes, que la performance des portefeuilles se répartit équitablement sur tous les titres du
portefeuille, toutes les journées de Bourse. Mais tous les professionnels observent bien que la
performance (et les pertes) se concentre sur quelques titres bien ou mal choisis, sur quelques journées
particulières de Bourse, que le marché est souvent calme (sauf quand il est très agité), et que la vraie
loi des portefeuilles gérés et bien plutôt une loi des 80/20 : très peu de titres (de jours) contribuent à
beaucoup de gains ou de pertes.
L'IMPACT DE LA DIVERSIFICATION
Dans un travail récent2 réalisé avec Olivier Le Courtois, nous avons montré comment une gestion peu
diversifiée, qui suivrait des règles qualifiées d'« alternatives » au sens franglais, pourrait être plus
protectrice qu'une gestion « classique » bien diversifiée. En remplaçant les modèles mathématiques à
base de mouvements browniens par d'autres modèles utilisant des processus aléatoires non browniens,
c'est-à-dire en changeant les hypothèses probabilistes sur les fluctuations boursières, l'indexation et la
1 « La gestion indicielle et la théorie des moyennes », Revue d'économie financière, n° 79, pp. 113-136.
2 « La concentration des portefeuilles ». Perspective générale et illustration, Cahiers de recherche de l'EM Lyon, 2008/03.

1
AD 2012 2/2 Banque stratégie n° 297
Novembre 2011
gestion bornée apparaissent tout à coup bien plus dangereuses que la gestion « alternative ». Derrière
ces débats, ce qui est en jeu est une compréhension de l'incertitude financière.
L'objectif est simple : le régulateur cherche à protéger l'investisseur. Pour cela, il lui faut indiquer des
catégories de risque, et donc apprécier l'incertitude financière représentée par les produits vendus.
Pour cela, il est nécessaire de disposer de mesures et donc de modèles de cette incertitude financière.
Le choix est alors le suivant : soit on considère que l'incertitude est modélisable par un aléa régulier
(par exemple un modèle probabiliste qui utilise le mouvement brownien3) et, dans ce cas, les mesures
usuelles du risque suffisent et permettent d’isoler une pseudo-catégorie appelée en franglais « gestion
alternative », décrite comme plus risquée en regard de l’hypothèse de régularité aléatoire ; soit on
considère que la représentation brownienne est trompeuse, et il devient alors nécessaire de repenser les
manières d’apprécier le risque des produits financiers, qui peuvent remettre en cause la partition
risqué/non risqué qui repose sur la vision brownienne lisse du risque. Dans ce cas, il est bien possible
que les gestions dites « alternatives » se révèlent moins risquées que les gestions benchmarkées.
Par analogie avec la manière dont une maladie se répand, en employant le modèle de la contagion des
idées, nous avons appelé en 2009 « virus B » (pour « virus brownien »), l’épidémie intellectuelle qui a
fait penser l’incertitude au moyen d’une représentation brownienne des fluctuations (Le virus B. Crise
financière et mathématique, éditions du Seuil). Dans la gestion d’actifs, il semble bien que le virus
brownien ait muté et soit devenu le virus des benchmarks. Un autre B…
Christian WALTER
Christian WALTER est actuaire agrégé (Institut des actuaires), professeur associé (IAE, Université Paris I) et titulaire de la
chaire Éthique et Finance (Institut catholique de Paris).
3 En 1827, le botaniste écossais Robert Brown observe au microscope les grains de pollen de la plante Clarckia pulchella. Il constate que ces
grains contiennent des particules et que ces particules, dans l'eau, sont animées de mouvements continuels (dus à l'agitation thermique).
Les particules se déplacent dans tous les sens, apparemment au gré du hasard. Ce hasard obéit à des règles précises qui décrivent le
mouvement désordonné de ces particules : c'est le mouvement de Brown, ou mouvement brownien. Les règles de ce mouvement seront
définies mathématiquement au début du XXe siècle par Louis Bachelier (1900), Albert Einstein (1905), et Norbert Wiener (1923). La « loi
en racine carrée du temps » qui fait transformer la volatilité mensuelle en volatilité annuelle (12 mois) en multipliant la première par la
racine carrée de 12, et que l'on trouve dans les réglementations prudentielles internationales (comme Bâle III pour les banques ou
Solvabilité 2 pour les compagnies d'assurance) est une application de l'hypothèse brownienne.

2
AD 2012 1/7 Revue Banque hors série
Mai 2011
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
EST-IL VRAIMENT IMPORTANT QUE LES
MARCHÉS SOIENT EFFICIENTS ?
L'efficience des marchés, qui n'était au début qu'une hypothèse émise par Eugene Fama, s'est
affirmée au fil des années comme une théorie sur laquelle se fonde la finance moderne. La crise
de 2008 l'a profondément remise en cause... ce qui n'a pas empêché les marchés, durant la crise,
de remplir leurs fonctions essentielles : financer l'économie et assurer l'épargne des investisseurs
finaux. Quelle importance, alors, accorder à cette théorie ?
'eff
thé
que
peut tradu
icience des marchés est une question
orique majeure dont la validité a été
stionnée par la crise de 2007. On
ire l'expression anglaise « efficient
markets » par « marchés efficients » ou
« marchés efficaces ». Or, la distinction entre
ces deux traductions ne relève pas uniquement
de la nuance sémantique ou de la chasse aux
anglicismes. Le terme « efficient » employé au
plus près du sens de l'expression anglaise
suppose un marché :
rationnel ;
incorporant toute l'information dispo-
nible ;
impossible à battre.
« Efficient » ne signifie pas la même chose
qu'« efficace », qui évoque un marché en état
de marche, apportant des solutions, résolvant
rapidement des problèmes -et dont la traduction
anglaise serait « operational »-).
Aussi dogmatique que certains puissent
la considérer aujourd'hui, la théorie
de l'efficience des marchés fut initialement
formulée comme une hypothèse : 1'« efficient
market hypothesis » (EMH). Celle-ci est
particulièrement importante dans la
construction de la finance moderne car, d'une
part, elle a joué un rôle structurant dans le
développement du secteur financier des trente
dernières années et, d'autre part, tous les acteurs
des marchés financiers l'intègrent dans leurs
outils de prise de décision. Si les marchés ne
sont pas efficients, faut-il remettre en
question les conséquences scientifiques et
politico-économiques tirées de la théorie ?
D'un point de vue scientifique d'abord,
L'EMH est en effet l'une des pierres de touche
d'une industrie financière dont l'utilité
économique et sociale est de financer
l’économie et de gérer l'épargne (et donc
individus. Si l'EMH n'est pas valide, la science
économique ne doit-elle pas, comme elle l'a fait
dans les précédentes crises majeures, remettre
en cause ses fondements théoriques et explorer
de nouvelles voies ?
D'un point de vue p
d'assurer certains risques sociaux) des
olitique, l'EMH fait partie
du faisceau d'arguments qui justifient le laissez-
faire économique: si les prix des actifs sont de
« bons » prix, si la « main invisible » fait son
office et alloue les ressources de façon
optimale, alors la vocation de l'État n'est pas de
jouer un rôle par construction inutile, voire
nuisible, d'encadrement de l'économie, par les
règles, les incitations et les prix. Ceci suppose
que les marchés « efficients » sont « efficaces »
pour allouer les ressources. Pour prendre une
analogie osée avec la physique, une théorie
« juste » est en général « efficace ». La rela-
tivité générale, qui n'a pas été invalidée durant
près d'un siècle et peut donc être considérée
comme « juste » jusqu'à preuve du contraire, est
« efficace » car elle permet d'écrire justement
les équations qui assurent le bon
fonctionnement de certains systèmes, pour
lesquels la mécanique newtonienne ne suffit
pas, comme les GPS, par exemple. Les deux
notions ne se superposent pourtant pas tout à
fait. Pour continuer l'analogie avec la physique,
une théorie imparfaite, voire inexacte, peut
donner des résultats parfaitement acceptables
pour l'utilisation qu'on en fait : c'est le cas de la
mécanique newtonienne, dépassée par la
physique quantique, mais qui suffit parfai-
tement à de nombreuses applications pratiques,
pour lesquelles elle est « efficace ». Ainsi, sans
être forcément « efficients », les marchés
pourraient être « efficaces » au regard de leur
fonction sociétale. L'objectif de cet article est
d'éclairer ces deux notions et de poser les
termes objectifs d'un débat miné par ses
L

2
AD 2012 2/7 Revue Banque hors série
Mai 2011
connotations idéologiques, et dont la crise née
en 2007 souligne encore l'actualité.
I. LE DÉBAT
UNE ÉTAPE CLEF DANS LA GÉNÉALOGIE DE
LA FINANCE MODERNE
La théorie des marchés efficients a été
formulée, sous forme d'une « hypothèse », pour
la première fois en 1970 par Eugene Fama de
l'Université de Chicago. Selon cette théorie,
toute information est reflétée dans le prix d'un
actif, qui n'est autre que la somme actualisée
des cash flows attendus. La meilleure prédiction
qu'on puisse faire à propos du prix futur d'un
actif est son prix de marché présent : il n'y a
pas d'« opportunités d'arbitrage ». Toutefois, les
interprétations de la notion fluctuent. Dans
une conférence datant de 1984, James Tobin1
distingue quatre formes possibles d'efficience
des marchés : d'une notion purement technique
(arbitrage efficiency : il n'y a pas d'opportunités
d'arbitrage) à une notion d'économie politique
(functional efficiency : les marchés remplissent
efficacement certains rôles pour les individus,
c'est cette notion que nous traduisons ici
par « efficacité »), en passant par deux notions
intermédiaires : fundamental valuation effi-
ciency, qui signifie que les prix de marché sont
justes, et full valuation efficiency, qui signifie
que les marchés sont complets (c'est-à-dire qu'il
est possible de s'assurer contre tous les risques).
L'EMH joue un rôle très particulier dans la
généalogie de la finance moderne. La boîte à
outils des financiers contemporains (directeurs
financiers, analystes, investisseurs) a été consti-
tuée à partir de ses fondements intellectuels,
qui, pour citer John Cochrane2, ont transformé
la finance « d'une collection d'anecdotes en
science ». On peut ainsi citer parmi la
descendance de l'EMH et du modèle CAPM la
gestion indicielle, la valorisation des options, la
théorie des stock-options, etc.
UNE HYPOTHÈSE DEVENUE DOMINANTE
Jusqu'à ces dernières années, l'EMH semblait
d'une robustesse considérable, tant théori-
quement qu'empiriquement.
1 James Tobin, « On the Efficiency of the Financial System »,
Lloyds Bank Review, 1984.
2 John Cochrane, « Efficient market today », Conference on
Chicago Economics, 10 novembre 2007.
Théoriquement tout d'abord, car accepter que
l'EMH était invalide revenait à supposer les
investisseurs non rationnels, ce que les
économistes en général répugnent à faire, sauf
pour une minorité d'entre eux qui pratiquent
l'économie dite « comportementale ». Et empi-
riquement, car de nombreux travaux éco-
nométriques la valident. Ainsi, Michael Jensen
écrivait en 1978 dans une introduction à un
numéro du Joumal of Financial Economics3
entièrement consacré à la validation empirique
de cette hypothèse, que « peu de propositions
en économie ont des fondements empiriques
plus solides que l’hypothèse de l’efficience des
marchés ». Les circonstances de la dernière
crise de marché allaient cependant remettre en
question les prémisses de la théorie.
APRÈS LA CRISE DE 2008, UN DÉBAT
VIGOUREUX…
Dans un article célèbre4, Krugman impute à la
finance « moderne » une responsabilité dans la
crise de 2008. Selon lui -la popularité de ce
point de vue ayant cru fortement au cours
des deux dernières années-, les économistes
« mainstream » majoritaires n'ont rien vu venir
car ils ont été désarmés par leur croyance dans
l'EMH, les théories mathématiques élégantes
qu'elle a permis de formuler, et aussi par un
confort intellectuel et matériel qui les a fait
épouser les intérêts des puissances financières.
La confiance excessive des économistes en
leurs outils et en leurs modèles les a conduits à
penser que les chocs macroéconomiques et
financiers (et les récessions au premier chef)
pouvaient être maîtrisés. Ainsi, la croyance en
l'avènement d'une ère de la « grande modé-
ration » qui serait marquée par la maîtrise
durable de la volatilité est caractéristique de
cette attitude, et comparable à certains égards à
la croyance en la « fin de l'histoire ».
Mais le camp adverse n'est pas excessivement
troublé par la crise. Ainsi, pour Eugene Fama,
la crise provient au contraire de ce que l'EMH
n'a pas été prise suffisamment au sérieux : « If
banks and investment banks took market
efficiency more seriously, they might have
avoided lots of their recent problems5 ».
3 Michael Jensen, « Some Anomalous Evidence Regarding
Market Efficiency », Journal of Financial Economics, Vol.6,
n° 2/3, 1978.
4 Paul Krugman, « How Did Economists Get It So Wrong ? »,
New York Times, 6 septembre 2009.
5 Q & A, « Is Market Efficiency the Culprit ? », Fama/French
Forum, 4 novembre 2009.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%