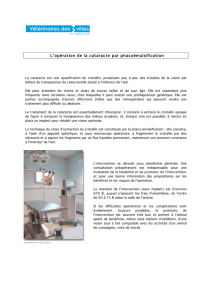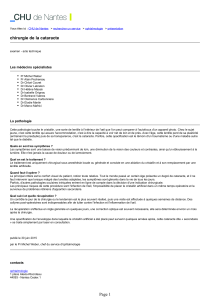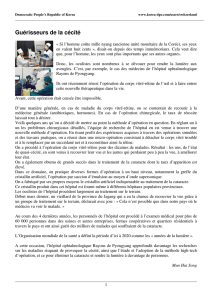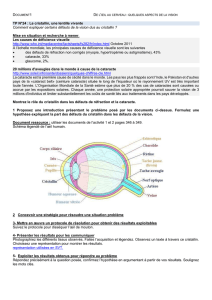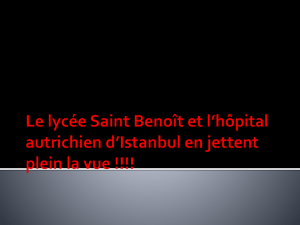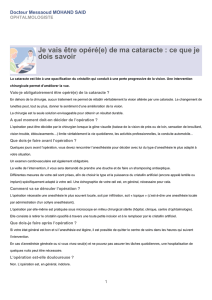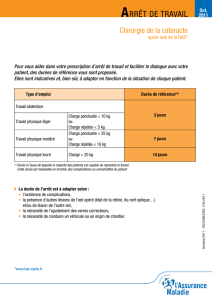la cataracte

LA CATARACTE
Le cristallin est une lentille biconvexe
située en arrière de l’iris et qui contri-
bue, avec la cornée, à faire converger
des rayons lumineux sur la rétine. Le
signe fonctionnel essentiel de la cataracte
est une diminution de l’acuité visuelle tou-
chant avant tout la vision de loin.
En fait, la diminution de vision n’est ja-
mais totale et l’œil atteint de cataracte
conserve tou-
jours au mini-
mum une
perception lu-
mineuse.
D'autres signes
fonctionnels
peuvent appa-
raître comme
particulière-
ment gênants
pour le patient :
c'est notam-
ment un
éblouissement
en lumière vive
dû à la diffrac-
tion de la lu-
mière sur les
opacités qui
perturbe considérablement la conduite
nocturne.
L’examen de l’œil atteint montre l’exis-
tence d’une opacité plus ou moins dense
dans l’aire pupillaire qui donne un aspect
de pupille blanche. L’examen au bio-mi-
croscope permet de préciser la topogra-
phie et l’importance de la cataracte.
“ La diminution de vision
n’est jamais totale ”
La reconnaissance d’une cataracte doit
faire proposer un bilan pour préparer une
intervention chirurgicale.
• le bilan général a surtout pour but de
choisir le type d’anesthésie. Il est actuel-
lement possible d'opérer une cataracte
sous anesthésie générale, loco-régionale
ou topique, c'est-à-dire par simple instilla-
tion de collyre. De ce fait, les contre-indi-
cations générales à une intervention sont
tout à fait exceptionnelles.
• le bilan ophtalmologique doit avant tout
évaluer les possibilités de récupération
fonctionnelle et l'existence éventuelle
d'une pathologie associée. La recherche
d'une atteinte maculaire, en particulier
d'une dégénérescence maculaire liée à
l'âge, sera essentielle car la coexistence
avec une cataracte n'est pas rare. Sa pré-
sence pourrait faire rediscuter l'indication
opératoire car l'intervention risquerait
d'amener une amélioration dérisoire,
voire conduire à une aggravation.
Les causes de la cataracte
- La cataracte
sénile est de
loin la plus fré-
quente. Elle est
le plus souvent
bilatérale mais
peut avoir une
large prédomi-
nance unilaté-
rale ; elle a une
évolution lente-
ment progres-
sive. Elle
survient le plus
souvent chez
l'adulte après
70 ans, parfois
plus précoce-
ment (cataracte
pré-sénile).
- Les cataractes
traumatiques :
elles peuvent ré-
sulter d'une per-
foration oculaire avec éventuellement un
corps étranger intraoculaire et la survenue
de la cataracte est en général très rapide
après l’accident. Une cataracte peut aussi
survenir après une contusion du globe
oculaire et l'opacification du cristallin peut
alors être retardée.
54
OPHTALMOLOGIE
OPHTALMOLOGIE
Cataracte totale
Cataracte congénitale
La cataracte est une opacification du cristallin.
Plus de 200.000 personnes sont opérées chaque année.

Il arrive que
le trauma-
tisme initial
soit passé
inaperçu. Il
sera impor-
tant de le
mettre en
évidence,
notamment
par une
radio de
l'orbite, à la
recherche
d'un corps
étranger in-
traoculaire.
- La cataracte peut également survenir
dans le cadre de certaines affections gé-
nérales, telles le diabète, des insuffi-
sances parathyroïdiennes, ou
accompagner certaines affections mus-
culaires telle la maladie de Steinert ou
des maladies cutanées, tels l'eczéma
constitutionnel, la sclérodermie...
Les cataractes peuvent aussi être favori-
sées ou provoquées par certains traite-
ments tels que la corticothérapie locale
ou générale au long cours ou la radiothé-
rapie.
- Des cataractes secondaires peuvent
survenir suite à une pathologie oculaire
évolutive telle que uvéite, glaucome, réti-
nopathie pigmentaire, ou succéder à une
intervention chirurgicale.
- Enfin, il existe des cataractes congéni-
tales : ici les opacités sont présentes à la
naissance. Elles sont liées à des mala-
dies de la mère ayant atteint l’enfant pen-
dant la grossesse (rubéole congénitale,
toxoplasmose, rubéole, cytomégalovirus,
herpès). Elles peuvent aussi être d’origine
génétique et survenir isolément ou asso-
ciées à d‘autres malformations.
Le traitement
Il est uniquement chirurgical. Il est indiqué
dès lors que la gêne fonctionnelle est per-
çue comme importante par le patient, ce
qui est extrêmement variable suivant ses
occupations et ses exigences. La gêne à
la conduite nocturne est notamment res-
sentie comme invalidante par le patient. Il
est de toute façon déconseillé d'attendre
qu'une cataracte soit trop évoluée, gênant
l'examen du fond d'œil, empêchant de
surveiller l'état de la rétine. Ceci est en
particulier vrai chez le sujet myope ou dia-
bétique car une cataracte dense pourrait
rendre impossible un traitement au laser
de la rétine.
L'intervention chirurgicale aura pour but
d'une part d'enlever l'opacité cristalli-
nienne, d'autre part de compenser les
modifications optiques induites par l'abla-
tion de la lentille cristallinienne.
L’ ablation du cristallin :
Elle est actuellement, réalisée dans l'im-
mense majorité des cas, par phako-émul-
sification aux ultrasons : à travers une ou-
verture de 3 à 4 mm de la chambre
antérieure de l'œil, la capsule qui entoure
le cristallin est découpée, le contenu
cristallinien fragmenté à l'aide ultrasons,
puis aspiré. La partie postérieure du sac
cristallinien est donc laissée en place. Elle
servira de logement au cristallin artificiel.
Compensation de l’ablation du cristallin
Le cristallin étant une lentille convergente
de 20 dioptries, l'ablation du cristallin en-
traîne une modifi-
cation du trajet des
rayons lumineux
qui doit être com-
pensée. Ceci peut
être réalisé dans
de rares cas par
lunettes ou lentilles
de contact. Mais, la
plupart du temps,
la correction s'ef-
fectue par la mise
en place d'un im-
plant à l'intérieur du
sac cristallinien
laissé en place.
Ces cristallins artifi-
ciels peuvent cor-
riger soit unique-
ment la vision de
loin, et le patient doit porter des lunettes
pour la vision de près, soit la vision de loin
et la vision de près (implants
multifocaux).
Dans le cas des cataractes congénitales,
il est fréquent de corriger par lunettes ou
55
Implant en place
Phakoémulsification du cristallin
LA CATARACTE
OPHTALMOLOGIE
OPHTALMOLOGIE
1
/
2
100%