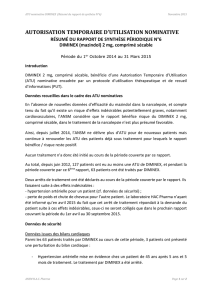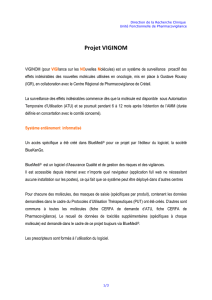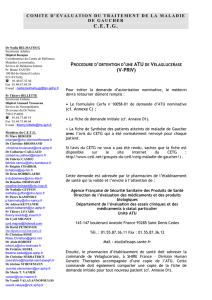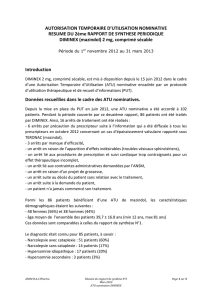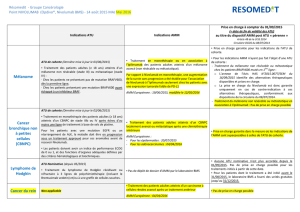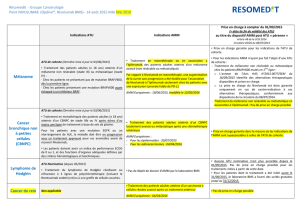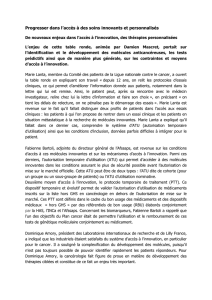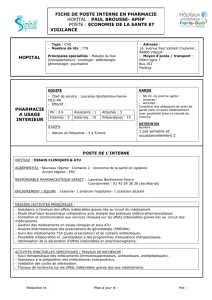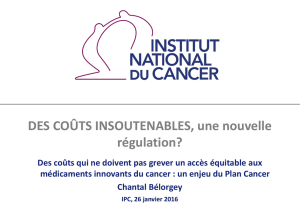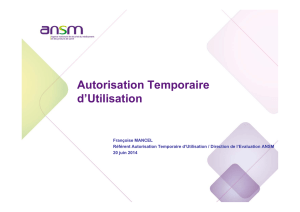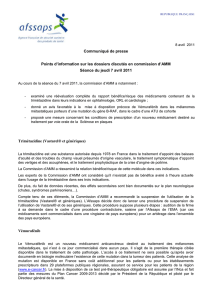Autorisation temporaire d`utilisation. Comment s`exerce la

16
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002
RAPPELS UTILES CONCERNANT L’ATU
L’utilisation en thérapeutique humaine d’une spécialité phar-
maceutique, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, suppose que
ce produit a préalablement fait l’objet d’une autorisation de
mise sur le marché (AMM) soumise aux conditions énoncées
par l’article L. 5121-20 du Code de la santé publique (CSP).
Cette règle comporte des exceptions, dont la dispensation des
produits utilisés pour la réalisation d’essais cliniques destinés
à permettre au fabricant de justifier de l’innocuité et de
l’intérêt thérapeutique d’un médicament afin, précisément,
d’obtenir l’autorisation de le commercialiser.
La loi 92-1229 du 8 décembre 1992 (amendée le 28 mai 1996)
organise une nouvelle exception à cette règle, l’autorisation
temporaire d’utilisation (ATU) [article L. 5121-12 du CSP].
L’ATU n’est pas destinée à donner une coloration administra-
tive à l’utilisation d’une spécialité pharmaceutique autorisée
dans une autre indication que celle figurant au résumé des carac-
téristiques du produit (RCP) annexé à l’autorisation de mise
sur le marché (AMM).
Elle concerne spécifiquement des médicaments n’ayant pas (ou
plus) d’AMM, destinés à la prise en charge de maladies rares
ou graves, pour le traitement desquelles aucune spécialité n’est
disponible sur le marché.
L’ATU vise à mettre fin à une pratique non dépourvue d’in-
tentions louables, mais illicite au regard du droit français,
dénommée “usage compassionnel” ou “usage humanitaire”[1].
Il s’agissait généralement pour un laboratoire pharmaceutique
de répondre à la demande de médecins en leur fournissant, en
dehors de la situation d’essai clinique, un produit ne faisant pas
l’objet d’une autorisation de commercialisation, produit que
ces médecins délivreraient ensuite à des patients [2].
L’ATU a pour but de remplacer cette pratique souvent mise en
place dans des conditions aléatoires, en donnant un cadre régle-
mentaire à l’accès d’un nombre limité de patients déterminés
à une ressource thérapeutique présentant un caractère excep-
tionnel sans alternative disponible sur le marché. Le cadre orga-
nise les conditions d’utilisation du produit, la protection
des malades concernés, mais également, de façon latérale, le
recueil des informations susceptibles d’être tirées de cet usage,
notamment du point de vue de la tolérance.
L’ATU s’inscrit dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes :
Celle d’un médicament ayant fait l’objet d’essais thérapeu-
tiques, en vue d’une demande d’AMM, permettant de présu-
mer fortement de son efficacité, de sa bonne tolérance.
Le titulaire des droits d’exploitation (ou son mandataire) adresse
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSaPS) une demande d’ATU, assortie d’un engagement
concernant la prochaine demande d’AMM.
L’autorisation peut être subordonnée par l’Agence à la mise en
place d’un protocole d’utilisation thérapeutique et d’un recueil
d’informations établis par le titulaire des droits d’exploitation.
Parmi les renseignements fournis à l’appui de la demande
d’ATU figure le texte provisoire du RCP concerné.
Cette situation est usuellement dénommée “ATU de cohorte”.
Celle d’un médicament prescrit à des malades nommément
désignés et sous la responsabilité d’un médecin traitant, dès lors
que l’efficacité et la bonne tolérance du produit sont présumées
en l’état des connaissances scientifiques et qu’il est susceptible
de présenter un bénéfice pour la santé du patient concerné.
La demande du prescripteur est adressée à l’AFSSaPS par le
pharmacien gérant la pharmacie d’un établissement de santé.
La demande comporte le nom ou le code du médicament, sa
forme pharmaceutique et son dosage, la justification de la pres-
cription, ses modalités, et l’engagement du prescripteur à infor-
mer le patient sur le médicament et la portée de l’autorisation
dont celui-ci fait l’objet.
PHARMACOVIGILANCE
Autorisation temporaire d’utilisation
Comment s’exerce la pharmacovigilance
J.P. Demarez*, O. Boudignat**, V. Lamarque**, A. Sainte-Croix Le Baleur**
* Tirés à part J.P. Demarez, cabinet Laurent Houdart, 75004 Paris.
** Travail réalisé dans le cadre du Groupe pharmacovigilance du SNIP.
[1] L’éventuelle attitude compassionnelle peut s’inscrire :
– dans une situation d’essai clinique pour un produit titulaire d’une AMM pour
une autre indication que celle de l’AMM,
– pour un produit non titulaire d’une AMM, soit dans la situation d’essai
clinique, soit dans l’une de celles organisées par l’ATU.
[2] Selon l’article 21 du Code de déontologie médicale, “il est interdit aux méde-
cins de délivrer des médicaments non autorisés”.

La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002
17
PHARMACOVIGILANCE
Cette situation est usuellement dénommée “ATU nominative”.
Le passage d’une ATU nominative à une ATU de cohorte est
une éventualité, qui n’est jamais implicite.
Le décret 98-578 du 9 juillet 1998 organise les conditions régle-
mentaires des autorisations d’importation et des autorisations
temporaires d’utilisation de médicaments à usage humain, les
produits concernés étant susceptibles d’être importés.
Le décret 95-278 du 13 mars 1995 (article R 5144-3 CSP) dis-
pose que “la pharmacovigilance s’exerce... pour les médicaments
mentionnés à l’article L. 5121-12 (faisant l’objet d’une ATU)
après la délivrance de l’autorisation temporaire d’utilisation”.
ATU NOMINATIVE ET PHARMACOVIGILANCE EXERCÉE
PAR LES FIRMES
Situations rencontrées
La demande peut affecter :
Un produit en développement ne faisant pas encore l’objet
d’une AMM.
Un produit non encore enregistré en France, mais éventuel-
lement enregistré dans un autre pays (notamment un État de
l’Union européenne).
Il convient de relever à cet égard que, dans le cadre d’une AMM
envisagée en procédure européenne centralisée, l’ATU consti-
tue un cadre particulier du droit administratif français. Quel que
soit le pays vecteur de la demande d’enregistrement, les traite-
ments dispensés dans le cadre de l’ATU ne concernant que des
patients traités en France, les informations relatives à des effets
indésirables présumés doivent être adressés à l’AFSSaPS, et
non aux autorités administratives impliquées dans la démarche
d’enregistrement. Le cadre réglementaire à observer est celui
de la pharmacovigilance française, et non celui de la demande
d’AMM.
Un produit ne faisant plus l’objet d’une AMM en France, ce
qui ne préjuge en rien de sa situation commerciale dans un autre
pays (y compris de l’Union européenne).
Ces situations diffèrent de celle d’une spécialité pourvue d’une
AMM dans une indication donnée pour laquelle un usage thé-
rapeutique serait envisagé dans une autre indication. Dans ce
dernier cas, il appartient au médecin traitant de se déterminer
en fonction des données dont il dispose.
Demande d’ATU
Le médecin intéressé adresse au pharmacien hospitalier qu’il
va charger de sa démarche une demande d’ATU pour tel(s)
ou tel(s) de ses patients. Le pharmacien hospitalier contacte
l’AFSSaPS, qui manifeste son éventuel accord au médecin et
au pharmacien.
La firme pharmaceutique reçoit du pharmacien un bon de com-
mande et la copie du document de l’AFSSaPS l’avisant de la
décision d’accorder l’ATU à la spécialité X sous la responsa-
bilité du docteur Y (identifié également par son adresse
professionnelle) pour une durée de traitement déterminée (dans
la limite maximale d’un an), en vue de la prescription de
ce médicament à un patient identifié de façon indirectement
nominative.
L’ATU comporte un numéro d’enregistrement, l’identification
de la pharmacie concernée (pharmacie hospitalière) et celle de
la firme détentrice du produit. Y figure la mention : “le deman-
deur s’engage à informer le patient, par un formulaire écrit,
de la nature et du statut sans AMM du traitement qu’il va rece-
voir”. Il va de soi que cet engagement ne concerne en rien la
firme. Celle-ci n’a pas à vérifier le respect de l’obligation ou y
voir un préalable à la délivrance du produit. Le demandeur est
le médecin prescripteur, généralement hospitalier,et seul chargé
de l’information du patient destinataire.
Cependant, il apparaît souhaitable que la firme ainsi requise
par l’ATU :
Organise une traçabilité interne couvrant la période comprise
entre la réception de l’ATU et la délivrance du dernier condi-
tionnement en fin de la période fixée pour la validité de l’ATU,
et ce autant de fois qu’il est délivré d’ATU nominatives pour
le produit.
Dispose d’un traitement automatisé des données issues de
l’ATU, données indirectement nominatives pour le(s) patient(s)
impliqué(s), directement nominatives à l’égard du prescripteur
demandeur. Cette banque de données est susceptible de
recueillir notamment, mais pas exclusivement, d’éventuelles
informations relevant de la pharmacovigilance du produit. Le
traitement automatisé est soumis aux dispositions en vigueur
relatives aux fichiers constitués de données relatives à la santé
(avis du comité “théodule”, autorisation de la CNIL, informa-
tion du patient sur son droit d’accès, etc.).
Intègre, dans le cas où des essais cliniques sont conduits avec
le produit parallèlement à son usage thérapeutique dans le cadre
d’une ATU, les événements indésirables signalés par les inves-
tigateurs d’essais cliniques dans une catégorisation distincte
des effets indésirables présumés notifiés par les prescripteurs
utilisant l’ATU. Cela conduirait dans l’idéal à prévoir un code
de saisie différent pour l’une et l’autre de ces deux catégories
de données.
Délivrance du produit sous ATU nominative
Destinataires. Les dispositions relatives à l’ATU, législa-
tives comme réglementaires, n’opposent aucun obstacle aux
conditions de traitement et de suivi thérapeutique d’un patient
dans le cadre d’une ATU nominative. Elles peuvent donc
concerner un patient hospitalisé, un patient suivi en ambula-
toire à partir d’un établissement hospitalier, un malade traité en
exercice libéral.
La dispensation s’effectue à partir d’une pharmacie hospita-
lière. Il est exclu qu’elle s’effectue du laboratoire pharmaceu-
tique directement au médecin prescripteur du patient concerné,
modalité que l’identification indirectement nominative de ce

18
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002
PHARMACOVIGILANCE
dernier ne favorise pas. En effet, le laboratoire pharmaceutique
ne connaît pas, et n’a pas de motif de connaître l’identité des
patients concernés par cette ATU. La traçabilité des unités thé-
rapeutiques délivrées est donc assurée par le truchement de
codes numériques et/ou des initiales du patient.
Information. La réglementation dispose que le produit déli-
vré sous ATU nominative fasse l’objet d’un étiquetage com-
portant :
– la dénomination du produit et/ou son éventuel nom de code,
– le numéro du lot de fabrication,
– la date de péremption.
La prescription par un médecin à un patient d’un produit sous
le régime de l’ATU nominative, si elle comporte une obliga-
tion d‘information relative à ce statut, ne limite pas l’informa-
tion à cette seule mention. La mise à disposition du produit sous
le régime de l’ATU nominative au médecin par la firme oblige
cette dernière à mettre également à disposition les informations
en permettant un bon usage en matière d’efficacité et de sécu-
rité. Ce, même si l’article L. 5121-12 (CSP) limite ces connais-
sances à une présomption[3].
Plusieurs cas de figure sont évoqués :
Il existe un résumé des caractéristiques du produit (RCP)
ancien, dans le cas d’un produit ne disposant plus d’une AMM,
ou actuel, dans le cas d’un produit bénéficiant d’une AMM dans
un autre pays. Il existe parallèlement une notice d’information
des patients répondant aux mêmes particularités. La probabi-
lité d’identité entre l’indication de l’ATU et celle de l’AMM
est grande. Il est à retenir que le plan d’un RCP n’est pas iden-
tique d’un pays à l’autre.
Le laboratoire est confronté, nonobstant l’existence du RCP et
de la notice, à la question de la traduction et/ou de l’actualisa-
tion des documents ci-dessus évoqués, au besoin par une note
technique complémentaire relative, en particulier dans le cas
de la pharmacovigilance, à la tolérance du produit et aux pré-
cautions d’emploi.
Il n’existe pas de RCP. La “présomption d’efficacité et de
sécurité en l’état des connaissances scientifiques” doit être
manifestée par un texte à l’initiative du laboratoire (voire la
fourniture de la bibliographie disponible). Ce texte ne semble
pas nécessiter une validation préalable par l’autorité adminis-
trative compétente ou la Commission d’AMM. Toutefois, en
pratique, il paraît néanmoins utile d’adresser au préalable copie
du texte à l’AFSSaPS, de même qu’il serait utile que
l’AFSSaPS adresse à la firme copie des correspondances adres-
sées par le service compétent au(x) médecin(s) demandeur(s).
À défaut d’une notice destinée au patient (disponible en cas
d’AMM ancienne ou obtenue dans un autre pays), l’informa-
tion relative au médicament à destination de celui-ci étant du
devoir du médecin prescripteur (en retenant le fait qu’il y aura
vraisemblablement plusieurs médecins impliqués dans l’utili-
sation de l’ATU nominative, donc plusieurs patients traités et
plusieurs pharmacies dispensatrices), il est recommandé de
rédiger un document destiné au(x) médecin(s) prescripteur(s)
et adressé en copie au pharmacien dispensateur, en utilisant le
plan standard du RCP :
Ce document constituant une “notice d’information théra-
peutique” contient une information validée “en interne” par
les structures habilitées.
Le document est régulièrement actualisé par l’adjonction de
données substantiellement intéressantes ou significativement
utiles au bon usage.
Les références conduisant à la rédaction et à l’actualisation
de ce document sont identifiées et conservées.
De plus en plus, l’AFSSaPS insère dans la lettre d’octroi d’ATU les
informations dont elle dispose concernant la tolérance du produit.
À noter que la posologie est celle déterminée par le prescrip-
teur dans la demande d’ATU, validée par l’octroi de l’ATU
nominative sous l’autorité du directeur général de l’Agence.
Conditions de délivrance. L’ATU nominative est, par défini-
tion, valide le temps prévu pour la durée du traitement mentionné
à la posologie précisée, le délai maximal étant d’un an et le renou-
vellement possible. Ces indications sont susceptibles de varier, le
traitement pouvant être interrompu et la posologie ajustée.
La fourniture du produit par la firme aux pharmacies-relais peut
s’effectuer selon au moins deux modalités : dotation complète,
ou dotation fractionnée à renouveler.
Le caractère nominatif de l’attribution exclut la rétrocession ou
la récupération pour réutilisation à d’autres fins que le traite-
ment du seul patient identifié.
Il est recommandé :
de tenir un dossier “bilan de fourniture” avec identification
directe ou indirecte des intervenants (prescripteurs-pharmacies-
patients) ;
en fin d’opération, compte tenu du nombre limité de méde-
cins demandeurs que suppose l’ATU nominative, un bilan glo-
bal (nombre de prescripteurs, de patients, d’unités distribuées)
sera effectué ;
la récupération pour destruction des lots distribués, mais par-
tiellement utilisés ou périmés, est à effectuer au niveau de la
pharmacie dispensatrice.
Pharmacovigilance des ATU nominatives
Selon l’article R 5144-3 (CSP), “la pharmacovigilance s’exerce
pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5121-12 après
délivrance de l’ATU”. Cette précision n’est pas sans créer des
difficultés d’application et d’interprétation, dans ce cas précis.
[3] “Dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l’état des
connaissances scientifiques”.

La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002
19
PHARMACOVIGILANCE
La situation d’ATU nominative implique un nombre déter-
miné de médecins demandeurs ayant soumis, dans les condi-
tions de l’exercice médical hospitalier ou de ville, un nombre
également déterminé (ou déterminable) de patients à une spé-
cialité délivrée par une firme pharmaceutique dans un volume
également déterminé (ou déterminable) correspondant au
nombre de patients traités.
La pharmacovigilance de la firme peut classiquement orga-
niser le recueil des éventuels effets indésirables présumés
(graves comme non graves), soit selon le mode de la notifica-
tion spontanée, soit selon le mode du recueil systématique. Cette
deuxième modalité peut être mise en place sous la forme d’un
document de suivi destiné à chacun des patients traités, remis
au prescripteur en même temps que les traitements, et retourné
en fin de traitement au service de la pharmacovigilance de la
firme, dûment complété par le prescripteur. En cas de survenue
d’un effet indésirable présumé, le prescripteur peut ainsi conser-
ver trace de l’observation et avertir le service de pharmacovi-
gilance de la firme. La firme et le prescripteur faisant partie
intégrante du système national de pharmacovigilance décrit à
l’article R 5144-5 (CSP), un tel mode de fonctionnement est
réglementairement conforme, qu’il fonctionne en notification
spontanée ou en recueil systématisé.
En application de l’article R 5144-19 (CSP), le médecin pres-
cripteur (comme tout médecin ayant constaté un effet indési-
rable grave ou inattendu susceptible d’être dû à un médicament)
doit faire la déclaration des effets indésirables graves ou inat-
tendus qu’il relie au médicament sous ATU nominative au
Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de sa région
d’exercice. Rappelons que l’effet inattendu est un effet indési-
rable non mentionné au RCP du produit, ce qui, en matière de
produit en ATU, ne recouvre pas l’ensemble des cas de figure
possibles.
En application de l’article R 5144-20 (CSP), la firme doit décla-
rer immédiatement au directeur général de l’AFSSaPS les effets
indésirables graves qui lui ont été signalés en rapport avec le
médicament en ATU (déclaration susceptible d’inclure des
observations issues de pays tiers rapportant des effets présu-
més inattendus).
La disposition relative au rapport régulier présentant la syn-
thèse de l’ensemble des effets indésirables déclarés par la firme
ou signalés à la firme étant contingentée, soit à une demande
immédiate du directeur général de l’Agence, soit à des périodes
rythmées par la date de l’AMM, on peut considérer qu’en
matière de médicament en ATU, la disposition souffre d’une
rédaction inappropriée.
Deux idées peuvent être dégagées pour résoudre les difficultés
ainsi constituées :
La firme et l’AFSSaPS pourraient, dès l’octroi de la première
ATU nominative, en prévision des extensions, convenir de l’af-
fectation des déclarations à un CRPV identifié, et définir la date
d’origine et la périodicité des rapports.
L’acceptation par une firme pharmaceutique d’honorer les
ATU nominatives constituant, pour les médecins demandeurs,
un service rendu, il ne serait pas excessif d’attendre en échange,
de la part de ces médecins, une vigilance particulière (dont les
modalités de réalisation pourraient être précisées dans une note
d’information) s’exerçant tant en direction de la firme que du
CRPV identifié, au moyen d’un bordereau duplicable.
L’article 5144-18 (CSP) soumet au respect de bonnes
pratiques de pharmacovigilance, définies par arrêté du ministre
de la Santé, les Centres régionaux de pharmacovigilance et les
pharmacovigilances des entreprises. Il serait utile, lors d’une
future rédaction de ces bonnes pratiques, de standardiser la
situation des médicaments en ATU et ses conséquences en
termes de pharmacovigilance.
Notons que l’AFSSaPS peut :
adresser aux médecins demandeurs une injonction d’orga-
niser “un suivi du patient et un recueil prospectif des informa-
tions portant notamment sur la tolérance de ce traitement (sous
ATU)”,précisant que l’Unité ATU ou un CRPV est destinataire
de ces informations au terme du traitement et en cas de renou-
vellement de l’ATU ;
préciser aux médecins demandeurs leur devoir général de
vigilance et ses modalités de réalisation, la procédure étant des-
tinée à permettre le recueil des manifestations cliniquement ou
biologiquement signifiantes ;
adresser au laboratoire pharmaceutique des rappels concer-
nant le contenu de l’information délivrée par celui-ci aux méde-
cins demandeurs en matière de recueil d’effets indésirables.
Recommandations pour la pratique :
Concernant les notifications. S’il paraît intéressant d’orga-
niser un système destiné à recueillir l’ensemble des effets indé-
sirables graves, comme non graves, observés, selon la mise à
disposition incitative des prescripteurs de fiches de notifica-
tions, les dispositions réglementaires sont respectées dès lors
que les notifications spontanées sont prises en compte par la
pharmacovigilance de la firme.
Peuvent être saisis, au minimum, les effets notifiés présumés
liés, les effets graves étant déclarés dans un délai maximum de
15 jours à l’administration compétente.
Dans le cas où le produit ferait l’objet d’un développement cli-
nique en France, ces événements ainsi notifiés peuvent prendre
le caractère de “fait nouveau” soumis à déclaration.
Le caractère “inattendu” sera apprécié au regard de la “notice
d’information thérapeutique évoquée en II.3.2”.
Concernant les rapports périodiques. En France, des rapports
périodiques (semestriels, annuels) peuvent être organisés à par-
tir de la date de délivrance de la première ATU nominative. La
situation est à évaluer selon que la firme projette ou ne projette
pas de conduire le produit faisant l’objet d’une ATU nominative
vers une AMM (quelle que soit l’indication revendiquée).

20
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002
PHARMACOVIGILANCE
Du point de vue international, deux situations sont possibles :
Le produit ne fait l’objet d’aucune AMM. Il peut être choisi,
à partir de la date de première ATU nominative, d’effectuer des
rapports réguliers, éventuellement semestriels, le temps de
l’existence d’ATU nominatives valides.
Le produit fait l’objet d’une AMM dans d’autres États. Les
rapports concernant l’utilisation thérapeutique sur le territoire
français, dans le cadre de l’ATU nominative, trouvent égale-
ment place dans les PSUR réglementairement prévus par les
procédures internationales.
ATU DE COHORTE ET PHARMACOVIGILANCE EXERCÉE
PAR LES FIRMES
Situations rencontrées
La demande peut affecter :
– Un produit en développement, non encore autorisé.
– Un produit non encore enregistré en France, mais éventuel-
lement enregistré dans un autre pays.
– Un produit ne faisant plus l’objet d’une AMM en France, mais
susceptible d’être encore exploité dans un autre pays. Cette
deuxième hypothèse nécessite le rappel de l’énoncé de l’article
L. 5 121-a disposant que l’octroi d’une ATU dite “de cohorte”
est prononcé dans le cas “de maladies graves ou rares lorsqu’il
n’existe pas de traitement approprié (et) que l’efficacité et la
sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu
des résultats d’essais thérapeutiques auxquels il a été procédé
en vue d’une demande d’AMM, que cette demande a été dépo-
sée, ou que le demandeur s’engage à la déposer dans un délai
déterminé”.
Une demande d’ATU de cohorte, pour un produit ne faisant
plus l’objet d’une AMM, ne répond à la disposition légale
que si le demandeur envisage une nouvelle AMM à terme dans
l’indication évoquée.
Demande d’ATU de cohorte
Si, stricto sensu, elle émane de la firme, elle peut également,
dans le cas de transformation d’une ATU nominative en ATU
de cohorte, procéder d’une incitation de l’Agence ou de noto-
riétés médicales.
Elle comporte le dépôt d’un dossier par le “titulaire des droits
d’exploitation”.
La cohorte constituée pourra évoluer parallèlement à des essais
cliniques, certains investigateurs participant à ces essais pou-
vant participer à la cohorte. Elle s’adresse à des médecins non
nécessairement encore tous identifiés, au moment de la
demande pour des patients identifiables en cours de cohorte.
L’ATU sera valable un an (éventuellement renouvelable),
accompagnée des annexes également prévues pour l’AMM
(RCP, étiquetage, notice). Notons, du fait d’essais cliniques,
l’existence d’une brochure pour les investigateurs.
L’utilisation s’effectue généralement dans le cadre d’un proto-
cole d’utilisation thérapeutique défini consensuellement par la
firme et l’AFSSaPS, à la demande de cette dernière, compor-
tant notamment les modalités de recueil des informations
relatives aux patients traités, à l’utilisation effective du produit,
aux effets indésirables observés (en particulier graves et
inattendus) impliquant de facto le service de pharmacovigilance
de la firme. La cohorte ainsi mise en place n’est pas un essai
clinique, et le médecin prescripteur n’est pas un investigateur
lorsqu’il intervient dans le cadre de l’ATU de cohorte.
Rien ne s’oppose à ce que les fichiers de suivi de cette cohorte
s’intègrent dans le fichier pharmacovigilance de la firme, en
matière d’obligation de déclaration à la CNIL (conformément
aux dispositions de la loi informatique et libertés – loi 78-17
du 6 janvier 1978 – et de son amendement relatif aux données
de santé – loi 94-548 du 1er juillet 1994). Les fichiers consti-
tués pour permettre une gestion particulière d’une cohorte résul-
tant d’une ATU (fichier de prescripteurs associé au fichier de
patients traités) peuvent également, du point de vue des obli-
gations légales, être individualisés et soumis à chaque création,
aux dispositions de la loi relative au traitement automatisé des
données de santé (avis du comité consultatif pour le traitement
automatisé des données de santé, autorisation de la CNIL). Ces
fichiers ne peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.
Rappelons que les résultats du suivi issus du protocole d’utili-
sation thérapeutique devront être joints au dossier de demande
d’AMM ou de renouvellement de l’ATU.
Bien que, contrairement aux dispositions relatives à l’ATU
nominative, celles relatives à l’ATU de cohorte ne fassent pas
mention de “responsabilité du médecin”, l’obligation relative
à l’information du patient sur la nature et le statut sans AMM
du traitement est identique. Les règles de responsabilités (de la
firme demanderesse, du médecin prescripteur) mériteraient
d’être mieux précisées. Elles ne sont, par définition, pas celles
de l’essai clinique. La mise en place systématique, par la firme,
d’un protocole d’utilisation thérapeutique a le mérite de
clarifier certains aspects sous la condition d’être validée par
l’AFSSaPS.
Délivrance du produit sous ATU de cohorte
Destinataires. À la différence d’une cohorte d’épidémiologie
où les médecins intervenants sont recrutés au préalable par la
firme organisatrice, il semble ici possible que des médecins
intéressés par le traitements sous ATU puissent solliciter le labo-
ratoire pharmaceutique pour rejoindre l’ATU de cohorte.
Le produit peut, cependant, faire l’objet d’une restriction de
prescription, ainsi que de modalités particulières de dispensa-
tion pharmaceutique. Il n’est pas sans intérêt de se demander
quelle est la cohorte constituée : cohorte de médecins habilités
à utiliser le produit sous ATU, cohorte de pharmaciens desti-
nés à le dispenser sur prescription conforme, cohorte de patients
traités, voire les trois cohortes en même temps ?
Modalités pratiques de l’ATU de cohorte. Si le protocole
d’utilisation thérapeutique et de recueil d’information peut être
la condition, mise par l’Agence, à l’octroi de l’ATU de cohorte
 6
6
1
/
6
100%