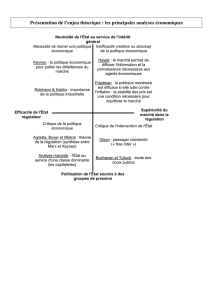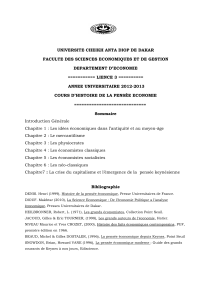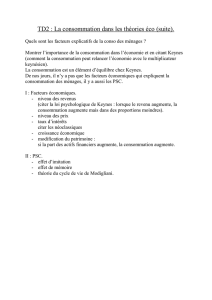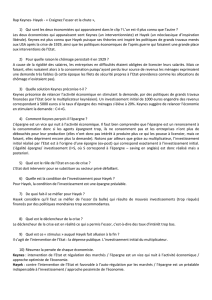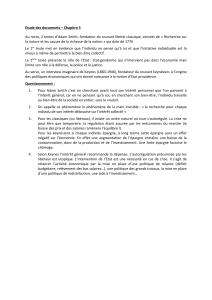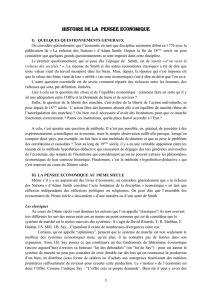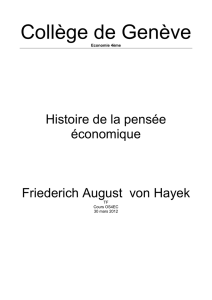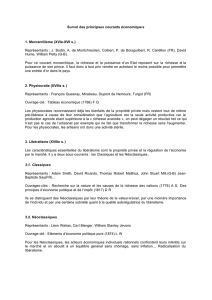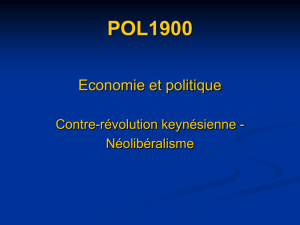MARCHANDISATION DU SOCIAL

1
COLLOQUE INTERNATIONL : L’ETAT ET LA PROTECTION SOCIALE
Ahcène AMAROUCHE,
Maître de Conférences – ENSSEA.
Les changements de paradigmes de l’économie libérale et la marchandisation du social.
Sommaire
Introduction. ............................................................................................................................................ 3
I.- De la théorie aux faits, un changement de paradigmes idéologiquement efficace. ............................ 4
1. - Le culte de la liberté individuelle et ses limites morales chez les économistes du courant
libéral classique. ................................................................................................................................. 5
2. - L’apport théorique de Keynes au libéralisme moral classique. ................................................ 6
3. - Le culte de la liberté individuelle revu et corrigé par Friedrich Von Hayek. ........................... 9
II. - Les marchés à l’assaut du pouvoir : la marchandisation du social à l’œuvre. .............................. 11
1. - Individu versus être social : le tout est plus que la somme des parties. .................................. 12
2. - La marchandisation du social, vrais problèmes et fausses solutions. .................................... 13
Conclusion. ............................................................................................................................................ 18
Bibliographie. ........................................................................................................................................ 19

2
Résumé.
L’expression « économie libérale » employée dans le titre de cette contribution est
délibérément choisie pour son ambiguïté, voire son ambivalence : le terme libéral ressortit au
mode de représentation (idéologie) d’une réalité tandis que le terme économie renvoie à cette
réalité même.
L’ambiguïté est dans l’emploi du qualificatif « libéral » pour décrire une réalité censée
n’obéir qu’à ses propres lois. L’ambivalence réside dans le fait que si les réalités forgent les
idéologies, les idéologies n’en rétroagissent pas moins sur les réalités au point d’en modifier
le cours – voire les lois. L’histoire du libéralisme est pleine d’enseignements sur cette double
relation entre économie et idéologie. Elle se lit dans les changements de paradigmes qui,
depuis Adam Smith, ont, par touches successives, mené à la prédominance de la pensée
néolibérale sur celle du libéralisme classique.
Après avoir retracé à grands traits cette histoire ambiguë au travers des changements
successifs des paradigmes de l’économie théorique (section I), nous nous attacherons à
présenter quelques traits de la situation présente, caractérisée par l’intrusion des paradigmes
du néolibéralisme en tant qu’idéologie dans le corpus théorique de l’économie pour fonder ce
qu’on appellera ici la marchandisation du social (section II). Par marchandisation du social
on entendra la conversion d’activités humaines à caractère immédiatement collectif (ou
global) en autant de champs de production de marchandises avec ce que cela comporte de
prévalence de l’individu sur l’être social de l’homme. Ce qui est visé dans cette démarche
théorico-idéologique, c’est la remise en cause du caractère social de ces activités et de leur
produit (biens publics, services collectifs et prestations sociales) en tant qu’ils ressortissent à
l’être social de l’homme. C’est aussi la remise en cause de l’Etat en tant qu’être collectif dans
lequel se reconnaissent les individus comme faisant partie d’un tout qui transcende leur
personne.
Nous conclurons en montrant l’inanité d’une telle conception du social au regard des
problèmes globaux auxquels est d’ores et déjà confrontée l’humanité, conception
« savamment rationalisée et déréalisée » (Bourdieu, 1998) pour servir de représentation
scientifique (censée donc être vraie pour tout un chacun) aux changements économiques en
cours associés à la mondialisation rampante.

3
Introduction.
La science économique a un bien étrange complexe : née de la philosophie morale qui
avait préparé le changement de l’ordre social et politique dans l’Europe des 17-18e siècles,
elle n’a de cesse de renier ses origines en cherchant constamment à prendre ses distances avec
les sciences morales et politiques. C’est peut-être la faute d’Adam Smith qui, après avoir
enseigné la théorie des sentiments moraux, en est venu à jeter les bases d’une science qui
traite des actions humaines d’où l’homme concret est exclu, où le diptyque finalité/éthique
est supplanté par le diptyque causes/effets.
Aussi a-t-elle de fortes réticences à conceptualiser certaines situations proprement
humaines où se mêlent l’objet et le sujet et à employer les termes qui rendent compte tout en
contrastes de leur réalité : richesse-pauvreté, conflits-solidarités, égalité-discrimination,
équité-injustice etc. bref, des termes qui renvoient à la matrice mouvante des rapports sociaux
et donc aussi à leur historicité (celle-ci s’entendant également ici dans le sens d’une diversité
de situations à un moment donné du temps chronologique). De même sont bannis les termes
qui suggèrent trop explicitement la dimension politique des actions de l’homme – c’est-à-dire
les choix qu’il est amené à faire envers ou contre ses congénères dans le rapport conflictuel ou
solidaire qui le lie à eux à l’intérieur de la Cité (et hors de la Cité maintenant que la Terre
entière est devenue un espace unifié où joueraient à plein les lois du marché).
Pourtant, la science économique ou l’Economique (on récuse à présent l’expression
classique d’Economie politique pour sa proximité originelle avec les sciences morales et
politiques qu’elle évoque en renvoyant à la Cité) est définie comme la science des choix ;
choix qui n’ont plus guère de dimension sociale (donc politique) – non plus que sociétale,
donc morale – mais seulement une dimension psychologique (encore que la psychologie aussi
en soit réduite à une sorte de rationalisation pavlovienne des comportements humains) : il
s’agit pour l’individu de prendre option pour des biens qui lui procurent le plus grand nombre
d’utilités pour un même quantum de peines, le tout sous contrainte de revenus (dont on ne sait
comment ils se forment), et dans un état donné des prix (dont on suppose qu’ils résultent de la
seule confrontation de l’offre et de la demande sur un marché). Mais alors que chez les
successeurs critiques d’Adam Smith (John Stuart Mill et Karl Marx tout spécialement), le
diptyque causes/effets prit l’allure d’un relativisme social-historique, rendu dans la double
détermination de la marchandise par le versant valeur d’échange de celle-ci, chez les
néoclassiques, l’héritage smithien se limita à la conception naturaliste-utilitariste de la
marchandise rendue dans la même double détermination par son versant valeur d’usage
1
. Une
transfiguration des rapports sociaux d’homme à homme en rapports économiques d’objet à
objet acheva de dégager la science économique de ses attaches morales quand ces objets n’ont
plus eu qu’incidemment, dans le nouveau corpus théorique, le statut de produit du travail
humain et que le travail lui-même partagea avec le capital le statut de facteur de production. Il
s’ensuivit un premier changement de paradigmes (qui s’est traduit par l’abandon du concept
1
Le concept de marchandise n’a pas livré tous ses secrets depuis Adam Smith. Si nombreux sont les économistes à admettre,
à sa suite, qu’il est l’unité de la valeur d’usage et de la valeur d’échange, ils ne se représentent pas tous le contenu
contradictoire de cette unité, de laquelle découlent les limites de la prétention des économistes néoclassiques à faire de
l’économie une science autonome des sciences morales et politiques. Pour aller au plus court, et sans entrer ici dans des
considérations d’ordre épistémologique relatives au statut théorique de l’économie, nous dirons que la valeur d’usage est
l’expression subjectivée des rapports homme-nature en ce sens que l’homme, en s’appropriant la nature, dote sa relation à
cette dernière d’une dimension proprement humaine ; tandis que la valeur d’échange est l’expression objectivée des rapports
homme-homme en ce sens que la relation de l’homme à autrui est médiatisée par les objets en sorte que dans l’échange, les
acteurs s’effacent pour ne rien laisser paraître de leur humanité. La science économique est donc fondée sur un double
malentendu.

4
même de marchandise au profit de celui de bien) dont la fonction idéologique a été de
ramener le complexe des déterminations sociales à contenu immédiatement collectif à une
juxtaposition de simples rapports interindividuels où l’intérêt personnel tient lieu de mobile
ultime des actions humaines et de catégorie analytique exclusive, tandis que le marché devient
le mode d’être et le lieu d’expression des rapports économiques, réduits en conséquence aux
seuls rapports d’échange bien contre bien. Cependant, si l’on peut imputer aux fondateurs de
la théorie néoclassique pareil changement de paradigmes en économie, c’est très
progressivement, et à la faveur d’un contexte sociohistorique et politico-idéologique
particulier que la nouvelle économie fut élevée au rang de science totale et que ses adeptes
cherchèrent des applications de ses paradigmes fondamentaux dans les domaines relevant
jadis de la philosophie et des sciences morales et politiques.
La présente contribution est consacrée à l’exposé succinct des changements successifs de
paradigmes de l’économie libérale (section I) pour ensuite montrer comment l’idéologie du
tout marché est montée « à l’assaut du pouvoir » (Yergin et Stanislaw, 2000) en transformant
progressivement les biens publics, les services collectifs et les prestations sociales
2
en biens,
services et prestations à caractère marchand – ce que nous appellerons la marchandisation du
social (section II). Nous conclurons par l’évocation des prémices de la crise de la théorie
néolibérale qui se profile derrière celle de l’économie mondiale financiarisée et derrière celle
de l’Etat néolibéral, confronté à cette crise en même temps qu’il est fortement sollicité par
l’aggravation des problèmes globaux qui se posent à l’humanité dans son ensemble.
I.- De la théorie aux faits, un changement de paradigmes idéologiquement efficace.
Comme indiqué en introduction, on peut faire remonter l’origine des paradigmes à la base
de la théorie économique libérale contemporaine à Adam Smith. Mais c’est à des auteurs
antérieurs qu’on doit la philosophie générale qui l’imprègne de part en part : celle de
l’égoïsme rationnel que Thomas Hobbes avait inaugurée et de l’utilitarisme que Jérémie
Bentham avait vulgarisée dès la fin du 18e siècle. C’est Bentham en effet qui réduisit toute la
philosophie à une affaire d’individus qui cherchent à augmenter leurs plaisirs et à diminuer
leurs peines. Cette conception philosophique, qui contient en germe l’idée d’une société
comme somme d’individus, fournira à la théorie néoclassique, par-delà Adam Smith, ses
principaux paradigmes qu’on peut résumer comme suit :
- primat de l’individu sur la société et des actions individuelles sur les actions
collectives ;
- caractère intentionnel des actions individuelles (les individus poursuivent
consciemment certaines fins) ;
- caractère rationnel de ces actions : les individus procèdent à l’évaluation
chiffrée des satisfactions et des peines selon la logique mathématique (Walras, 1909,
p.2)
3
.
Il en a résulté le rejet des concepts à contenu immédiatement collectif (on ne peut pas
prêter des intentions et une rationalité à des entités – nation, classe, Etat etc.) qui transcendent
2
Par commodité, et pour les distinguer des services collectifs, on entendra par prestations sociales les prestations mobilisant
la solidarité des personnes à travers les institutions.
3
Dans l’article cité ici, l’un des tout derniers travaux de l’auteur, Léon Walras parle au sujet de l’Economique, d’une science
psychico-mathématique en ce qu’elle traite de faits intimes (psychiques), par opposition aux sciences dites physico-
mathématiques qui traitent de faits extérieurs à l’homme.

5
le concept d’individu. De même, les notions de morale et d’éthique devinrent étrangères à
l’économie non seulement parce qu’elles sortaient du cadre conceptuel de l’égoïsme rationnel
que Hobbes avait déjà mis au cœur de son explication des conduites humaines, mais aussi, et
plus fondamentalement, parce qu’en ramenant l’individu à son être social, elles
réintroduiraient dans la problématique théorique de l’économie les questions que la
philosophie utilitariste avait précisément cherché à évacuer : celles de justice, d’équité, de
responsabilité sociale etc. pour ne rien dire de l’altruisme, de la sollicitude, de la solidarité, de
l’abnégation etc. – ou de leurs contraires – qui participent tout autant à la formation de la
matrice mouvante des rapports sociaux. Dans la mesure où ces rapports furent réduits à des
rapports interindividuels, la seule valeur morale admise par les nouveaux économistes est que
la liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres – aphorisme connu de longue
date mais suffisamment ambigu pour les libérer de toute référence à l’éthique et à la morale.
C’est Friedrich Von Hayek, théoricien et chantre du nouveau courant de pensée en économie,
qui formula avec le plus de netteté la morale à la base de la nouvelle théorie économique en
écrivant que nos décisions n’ont de valeur morale « que dans la mesure où nous sommes
responsables de nos intérêts et libres de les sacrifier » (Hayek, 1944, p. 152). Cependant, ce
résultat ne fut pas atteint avant que ne se trouvèrent réunies les conditions sociohistoriques et
politico-idéologiques de la prédominance du néolibéralisme ; ce que nous allons essayer de
relater succinctement en cherchant à resituer dans leur contexte les changements de
paradigmes en économie.
1. - Le culte de la liberté individuelle et ses limites morales chez les économistes
du courant libéral classique
4
.
Ainsi qu’il a déjà été dit, Adam Smith est considéré par tous les économistes, toutes
générations et courants de pensée confondus, comme le père du libéralisme économique. La
formule par laquelle il résumait sa doctrine – Laissez faire, laissez passer – trouva chez les
économistes libéraux de deuxième et troisième générations un écho particulièrement fort en
dépit des mises en garde morales d’un John Stuart Mill qui s’élevait contre la perspective d’un
monde où « la vie de tout un sexe est employée à courir après les dollars, et la vie de l'autre à
élever des chasseurs de dollars». La métaphore de la main invisible du marché, due également
à Adam Smith, fut traduite par eux en une loi fondamentale de l’économie – celle de la
concurrence pure et parfaite – pour donner naissance à un édifice théorique des plus abstraits
où il était supposé un pouvoir trop atomisé des agents pour avoir quelque influence sur le
fonctionnement des marchés. Le culte de la liberté individuelle qu’ils se forgèrent sur cette
base ne pouvait que susciter chez eux une profonde méfiance à l'égard de l’Etat en tant
qu’agent économique et plus encore en tant qu’agent assurant la médiation sociale entre
acteurs. C’est pourtant Adam Smith lui-même qui, énonçant les devoirs du souverain ou de la
République qui justifiaient que l’Etat disposât des revenus de l’impôt, mit à leur charge la
construction et l’entretien d’ouvrages et d’établissements publics « dont une grande société
retire d’immenses avantages, mais qui sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris ou
entretenus par un ou par quelques particuliers, attendu que pour ceux-ci, le profit ne saurait
jamais leur en rembourser la dépense » (Smith, 1976, p. 370).
Pour leur part, et quoiqu’ils aient été à l’origine de la nouvelle orientation de l’économie
théorique en la faisant entièrement reposer sur le principe de l’individualisme
4
Pour la commodité de l’exposé, nous désignerons (à la suite de Keynes) par courant libéral classique l’ensemble des auteurs
libéraux depuis Adam Smith jusqu’à Alfred Marshall en y ajoutant Keynes lui-même pour l’opposer au courant néolibéral
représenté par Friedrich Von Hayek et Milton Friedman notamment.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%