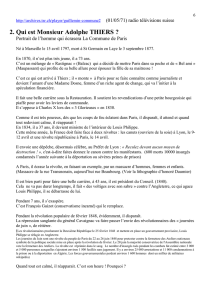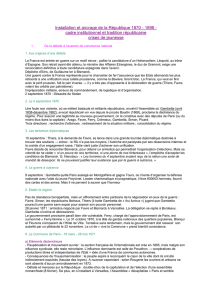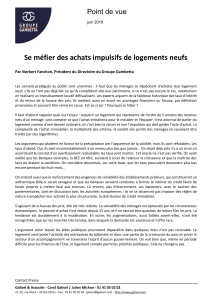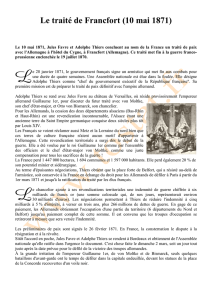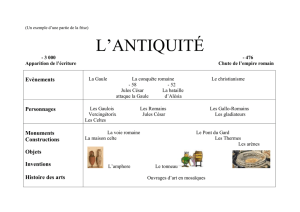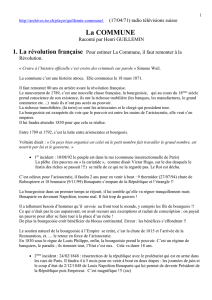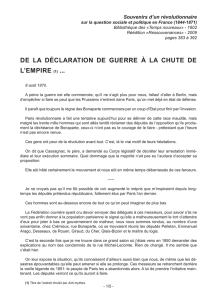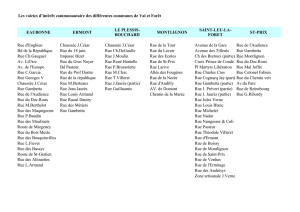La troisième République 1870-1940

La troisième République
1870-1940

Du même auteur:
Une dynastie de la bour;geoisierépublicaine: les Pelletan (L'Harmattan, 1996)
Les poèmes secrets de Camille Pelletan (Maison de poésie, 1997)
La mer au temps des Pelletan (AECP, 1998)
L'âge d'or des républicains (L'Harmattan, 2001)
Richesse et diversité de la République en France: les républicains atYpiques du
XIXème siècle (EDlMAF, sous presse)
Couverture: buste de Marianne par H. Moulin, 1867.
Coll. part. Cliché Sophie Baquiast

Paul BAQUIAST
La troisième République
1870-1940
Préface d'Emile ZUCCARRELLI,
Député-maire
de Bastia,
Ancien ministre
L'Harmattan L'Harmattan Hongrie L'Harmattan Italia
5-7, rue de l'École-Polytechnique Hargita u. 3 Via Bava, 37
75005 Paris 1026 Budapest 10214 Torino
FRANCE HONGRIE ITALIE

@L'Hannatlan,2002
ISBN: 2-7475-3338-7

Préface
Lorsque notre mémoire collective évoque la troisième République,
nous la faisons synonyme de fondation. Car depuis janvier 1875 le
régime qu'elle a créé est devenu notre bien commun.
Par accident? Par cette unique voix de majorité obtenue par
l'amendement Wallon? Trop vite dit. En effet, comment oublier
l'enracinement dans cette riche et tumultueuse décennie qui de 1789 à
1799, par un cheminement complexe, souvent contradictoire, crée des
valeurs devenues incontournables: souveraineté nationale, exigence
d'égalité, foi dans le progrès et dans ses vertus émancipatrices. Elles
rebondissent en 1830 et surtout en 1848 en enrichissant l'héritage, en
lui donnant une dimension sociale, certes entrevue par la génération
précédente mais maintenant au cœur des attentes de ceux qui ont jeté
à terre Louis Philippe. Comment oublier aussi ces «Radicaux»
relevant le flambeau contre Badinguet, et ces «Communards»
conjuguant « la Sociale» et « la Nation» ? L'Insurgé de Jules Vallès est
à la fois merveilleux roman, magnifique cours d'histoire et
irremplaçable manuel d'instruction civique à faire lire à tous nos
lycéens.
Le livre que nous offre aujourd'hui Paul Baquiast se situe dans la
lignée de ces ouvrages qui nous apprennent à lire. C'est à dire selon la
formule heureuse de Jean Jaurès, à devenir libre, à devenir des
citoyens. Parce qu'il nous donne à voir et à comprendre que la
République est une création permanente. Non seulement parce qu'il
lui a fallu du temps pour devenir républicaine, mais surtout parce que
prenan t appui sur ces « socles de granit» posés par Siéyes , Condorcet
mais aussi Robespierre, elle a su surmonter les crises, de Mac-Mahon
à l'Affaire Dreyfus en passant par Boulanger. Et en les surmontant
enrichir son contenu: laïcité et école publique viennent, tout
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%