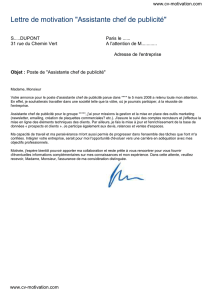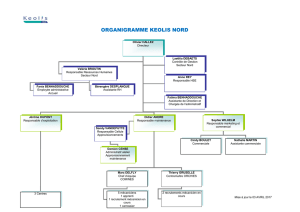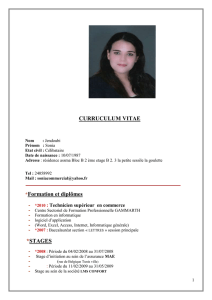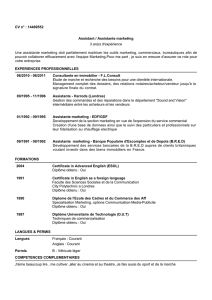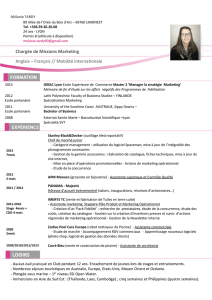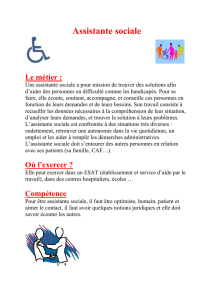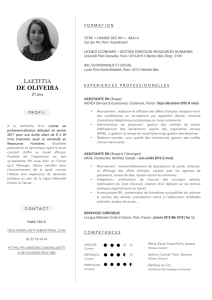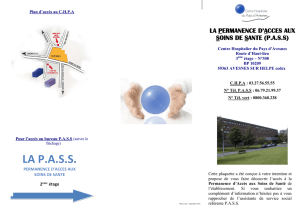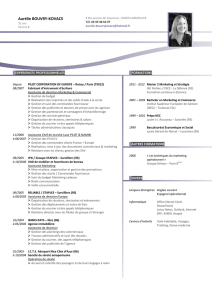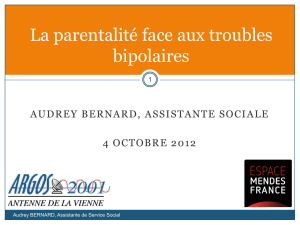sans conteste les parents « victimes d`un environnement social

1
Atelier 1 :
Travailler avec les familles dites «
Travailler avec les familles dites «Travailler avec les familles dites «
Travailler avec les familles dites «
défaillantes
défaillantesdéfaillantes
défaillantes
», de la défiance à l’alliance en conjurant les
», de la défiance à l’alliance en conjurant les », de la défiance à l’alliance en conjurant les
», de la défiance à l’alliance en conjurant les
malentendus
malentendusmalentendus
malentendus
Animatrice
Marylène KITA-DEBUIRE, assistante sociale
Avant-propos
J’appartiens à une génération
charnière
pour laquelle il est établi que l’école a eu pour
mission d’apporter un enseignement de base à tous les enfants, sans trop compter sur la
participation des parents. A l’inverse, aujourd’hui, même si la frontière entre le monde de
l’école et le milieu de vie de l’élève reste relativement étanche, l’école s ‘est davantage
ouverte aux parents et, désormais, attend que ceux-ci contribuent à l’éducation scolaire de
leurs enfants. Cette attente parfois démesurée à propos du rôle complémentaire des
parents repose sur l’hypothèse que les parents ont la disponibilité nécessaire et, surtout,
que tous les parents sont aptes à comprendre le bien fondé des programmes. Cette attente
peut nous sembler paradoxale de la part de membres d’une institution qui reste plutôt
suspicieuse envers les parents qui sont parfois définis comme des
parents défaillants
parents défaillantsparents défaillants
parents défaillants
. En
effet, encore trop souvent, lorsqu’un élève pose problème ou est en difficulté, l’institution
scolaire se pose peu de questions sur elle-même et son premier réflexe est de s’interroger
sur la responsabilité des parents ; surveillent-ils les devoirs ? sont-ils assez concernés par
la scolarité de leur enfant ? D’où les sempiternels reproches de laxisme qui pèsent sur la
plupart des parents confrontés aux difficultés scolaires de leurs enfants, même si ce sont
sans conteste les parents «
victimes d’un environnement social insécurisant rendant leur
position de parent tout simplement intenable »
1
qui sont le plus suspectés de désintérêt
massif pour la scolarité de leur enfant. Du côté des parents il n’est pas rare non plus de
constater qu’ils intériorisent ou expriment une vision réductrice du travail et de l’attitude
des enseignants.
1
BOUCHEREAU Xavier, »Assistance éducative :risque d’un ethnocentrisme de classe »ASH octobre 2003,
numéro 2327

2
M . KITA-DEBUIRE (suite atelier 1)
Positionnement de l’assistante sociale scolaire
Dans ce contexte de défiance réciproque, quel rôle l’assistante sociale scolaire
pourra-t-elle tenir ?
Avant de tenter tous ensemble de répondre à cette interrogation, il m’a semblé
intéressant de cibler quatre obstacles auxquels l’assistante sociale scolaire doit
habituellement faire face :
- Le premier me semble être l’impossibilité pour une assistante sociale scolaire de
prétendre être dans une totale extériorité
extérioritéextériorité
extériorité. En ce qui concerne le domaine de la
parentalité, l’une des difficultés sera notre implication en tant que parent sur ce sujet
(ou en tant qu’enfant ayant eu l’expérience de la parentalité de ses propres parents).
Et, dans le domaine de la scolarité, d’une façon générale, nous avons tous eu
l’expérience du statut d’élève. Ces expériences personnelles ont laissé des traces et ne
permettent pas que disparaissent nos affects.
- Les représentations
représentationsreprésentations
représentations constituent un second obstacle. En effet, des représentations sous
-tendent nos pratiques. Comme le fait observer Jean-Pierre MINARY,
psychosociologue, familles et professionnels «
ne partagent pas forcément les mêmes
repères culturels à propos de ce qui constitue des ajustements relationnels adaptés
entre parents et enfants »
2
L’assistante sociale scolaire devra donc se distancier de
ses propres représentations en tant que personne ayant ses propres références
culturelles et/ou éducatives, mais devra également se décentrer de ce que l’institution,
à laquelle elle appartient, va véhiculer à propos de l’élève et/ou de ses parents. Sur ce
dernier point, en effet, au cours d’échanges formels et informels avec d’autres
membres de l’institution scolaire, l’assistante sociale scolaire est souvent confrontée à
l’univocité de l’analyse réalisée à propos de parents d’élèves dont sont soulignées les
carences et la probable démission. Enfin, l’assistante sociale scolaire, peut elle aussi
subir les néfastes effets des représentations qu’ont les autres membres de la
communauté scolaire en ce qui concerne son travail et ses domaines de compétence.
2
Jean pierre MINARY, in « interventions sociales auprès des familles en situation de précarité » ouvrage
coordonné par Michel BOUTANQUOI, ed. l’Harmattan

3
- Un troisième défi à relever est ce que je qualifierais de conflit de loyauté.
conflit de loyauté. conflit de loyauté.
conflit de loyauté.
L’appartenance de l’assistante sociale scolaire à son institution la conduit à œuvrer en
cohérence avec celle-ci, et, même si son travail ne relève pas d’injonctions de
l’institution scolaire, il nécessite cependant une prise en compte des attentes et des
objectifs de l’équipe enseignante et éducative. Tout particulièrement dans les conflits
entre école et parents, l’assistante sociale scolaire va s’évertuer à conserver une
certaine neutralité en ne perdant pas de vue l’intérêt de l’élève. Mais, dans le
déroulement de tels conflits, l’assistante sociale scolaire court le risque de sembler
déloyale aux uns et aux autres, car, en reprécisant les règles et objectifs de
l’institution, elle peut apparaître aux parents comme l’alliée de l’institution scolaire.
A l’inverse, lorsqu’elle tente d’éclairer l’institution sur les difficultés particulières de
l’élève, elle peut être perçue comme le défenseur systématique des parents et de
l’élève.
- Le quatrième défi a trait à l’instabilité
l’instabilitél’instabilité
l’instabilité des analyses
des analyses des analyses
des analyses mais est dû également à certains
paradoxes
paradoxesparadoxes
paradoxes. Le caractère interactif du travail de l’assistante sociale scolaire avec les
élèves et leurs parents, mais également le cheminement parfois lent avec ses
différents partenaires donne lieu à une instabilité de ses analyses. L’assistante sociale
scolaire, tout en respectant des logiques différentes de la sienne, a tendance à
s’éloigner des discours convenus ou des jugements sans appel. Ce que je qualifie
la
culture du doute
est l’essence même de son métier et cela lui permet de rester une
sorte d’arbitre au milieu des dissonances et surtout de ne pas se rigidifier à partir
d’à priori. «
Parler et se taire ; suspendre des doutes et réinjecter de l’incertitude ; agir
et ne pas intervenir.
C’est ce basculement permanent qui caractérise au mieux
l’activité des assistantes sociales scolaires : valoriser l’action, la déployer en référence
à des règles, et s’inscrire discrètement dans le cours des choses. Loin de nous offrir
des solutions miracles pour résoudre les difficultés des élèves, cette analyse donne à
penser un engagement long et tenace pour les prévenir…. »
3
.
Ce patient travail de
fond peut donner l’impression d’une analyse instable aux différents interlocuteurs
qui sont souvent avides de diagnostics rapides.
Quant aux paradoxes, ils ne sont pas
3
Pascale GARNIER, « les assistantes sociales à l’école » PUF 1987

4
rares dans le contexte actuel de l’institution scolaire. Ainsi, la compétence des parents
au plan éducatif est fréquemment remise en cause mais en cas de difficultés liées à
des incivilités par exemple, l’entourage familial est souvent sommé de venir sur le
champ prendre en charge l’enfant récalcitrant, l’école n’assumant plus la prise en
charge en ses murs de certaines punitions pour manquement aux règles établies
(C’est surtout le cas en collège, d’après ma propre expérience.)
CONCLUSION
Bien d’autres difficultés pourraient être pointées, mais notre réflexion aujourd’hui va
consister à réfléchir ensemble pour dégager des pistes. Le positionnement de l’assistante
sociale découle de tous les paramètres évoqués ci dessus, et je crois qu’en dépit du
contexte actuel où l’espace privé est envahi d’injonctions et de normes concernant la
bonne
parentalité
, l’assistante sociale scolaire conserve à l’esprit que
« la souffrance au niveau de
l’identité parentale éprouvée par les parents est en lien avec la sensation d’être perçus de
façon négative par les intervenants sociaux, ce qui entache la relation
parents/professionnels et freine considérablement une éventuelle dynamique de soutien à
la parentalité »
4
. C’est pourquoi il me semble que, pour soutenir les parents comme
premiers éducateurs de leurs enfants, nous devons mettre de côté nos idéaux difficiles à
atteindre, et nous appuyer davantage sur les points forts des parents, en valorisant leurs
compétences. Enfin, pour favoriser encore plus la coordination des deux mondes principaux
de l’élève : sa famille et son milieu scolaire, il faut expliquer aux parents les enjeux et la
culture de l’école. Selon Nicole CATHELINE :
« Les parents doivent être associés à toute
forme de réflexion menée par l’école au sujet de leur enfant. Ce n’est pas en les excluant des
décisions qu’on favorise l’alliance
alliance alliance
alliance thérapeutique »
5
4
EUILLET Séverine, ZAOUCHE-GAUDRON Chantal. « Des parents en quête de parentalité. L’exemple des
parents d’enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance » Societés et jeunesses en difficulté 2008 ,numéro 5
5
CATHELINE Nicole « Psychopathologie de la scolarité » page 25, Edition Masson 2003

5
M. KITA-DEBUIRE, atelier 1
Quelques pistes supplémentaires pour les débats
Quelques pistes supplémentaires pour les débatsQuelques pistes supplémentaires pour les débats
Quelques pistes supplémentaires pour les débats
:
::
:
-Evoquer la théorie développée par Guy AUSLOOS sur la compétence des familles :Guy
AUSLOOS, psychiatre, systémicien a publié en 1996 un ouvrage intitulé « La compétence
des familles », publié (nouvelle édition en 2010 chez Erès), dans lequel il explique que les
familles ont besoin d’être confortées dans leur parentalité, et qu’il faut donc chercher la
compétence des familles plutôt que de s’appesantir sur ce qui ne va pas .En parallèle, on
peut remarquer que le système scolaire français souligne toujours à outrance les
erreurs( cf :l’échelle de notation), et valorise peu les compétences des élèves, malgré
certains courants novateurs qui souhaitent que l’école française s’inspire davantage
d’autres cultures scolaires et en particulier du modèle finlandais par exemple.
- Dans une même approche et sur le même sujet, évoquer l’ouvrage récent (Août 2010) de
Peter GUMBEL, « On achève bien les écoliers ». Ce journaliste anglophone, enseignant à
Sciences Po, évoque la
culture de la négativité
qui règne en France encore aujourd’hui, ce
qu’il trouve extrêmement contre productif et terriblement décalé par rapport à d’autres
cultures scolaires (en particulier dans les pays anglo-saxons).
-Evoquer en référence aux cours du DESU (Diplôme supérieur d’université, bac +4) dont
j’ai bénéficié à l’université PARIS VIII, la pertinence des interventions de Hervé HAMON,
président du tribunal pour enfants à PARIS, qui explique :
« la parentalité passe par
l’acquisition d’un savoir faire, par l’appropriation du sentiment d’être parent et par
l’apprentissage de ses droits et ses devoirs. Aujourd’hui, …, on croit qu’il suffit de rappeler
à ses droits et devoirs ne famille défaillante, quitte à les lui imposer de manière
autoritaire. »
 6
6
 7
7
1
/
7
100%