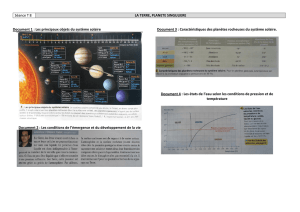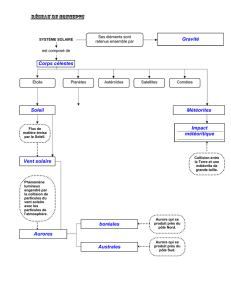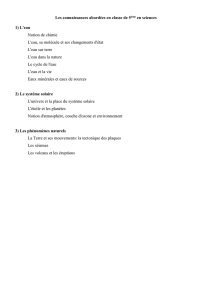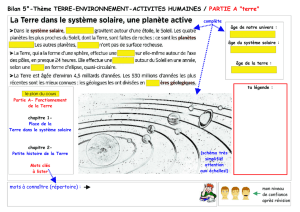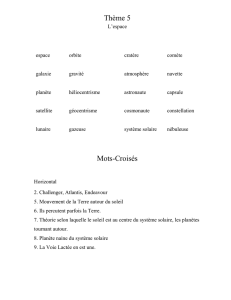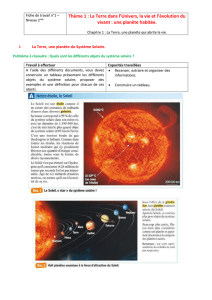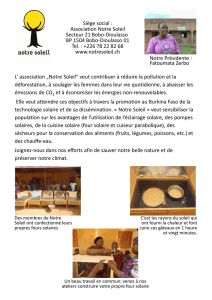sciences - Collections

ACTUEL 8LA PRESSE MONTRÉAL DIMANCHE 9NOVEMBRE 2003
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
.
SCIENCES
MATHIEU PERREAULT
Quand ilsontmislesvoilespour
lesIndes,en 1492,lesmarinsde
Christophe Colombcraignaientd’arri-
ver,passélesAçores,àune zone de
l’océanAtlantiqueo
ùil n’yaurait
pasde vent.Heureusement,celan’est
pasarrivéetilsontdécouvert
l’Amérique.
Cinq sièclesplus tard,c’est autour
d’unautreexplorateur d’arriverdans
une région inconnueetstagnante.
La sonde Voyager1 ,lancée en 1977,
auraitatteintlafrontièredusystème
solaire,làoùtombeleventsolaire.
Cettesemaine danslarevueNature ,
troisarticlesdiscutentcetteétape
importantedel’exploration spatiale.
Curieusement,cedébatentreastro-
nomesaune importancecruciale pour
laquestion duréchauffementde la
Terre.
Le«ventsolaire» n’est pascomme
celuiquifaitmonterlescerfs-volants.
Ils’agitde particulesd’énergie émises
parle Soleil. Ellesn’interagissent
pasavecVoyager1:lasonde ne ralen-
tirapasquand le ventsolairetombera.
Onpeut faireune analogie avecles
ondesradio outéléphoniques,qui
n’interagissentpasaveclesobjets
solidescomme lesvoituresoules
êtresvivants.
Ceventsolaires’éloigne duSoleil
àlavitessede1million de kilomètres
àl’heure. Maisaux confinsde notre
système solaire,il entreencontact
avecd’autresparticulesd’énergie,
quiformentle «ventinterstellaire».
Lesdeux flux de particules,qui
voyagentdansdesdirectionsopposées,
ralentissentsous le choc.Àune certaine
distanceduSoleil,il n’yaplus de
«vent»dansaucune direction :c’est
l’«héliopause».
Lesarticlesde Nature ,ainsiqu’un
autredanslarevueGeophysicalResearch
Letters,supputentlapossibilitéque
Voyager1soitentrée danslazone où
le ventsolaireralentit.Une équipe
de l’UniversitéJohn Hopkins,au
Maryland,pensequeoui. Deux autres
pensentquenon. Unéditorialde
Naturefaitétatdesdeux thèses.
L’héliopauseseraitsituée entre85et
120 unitésastronomiques(une UA
correspond à150millionsde kilo-
mètres)d
uSoleil,etVoyager1setrouve
àprèsde 90UA.
«Leproblème,c’est quel’instru-
mentquim
esureleventsolairene
fonctionne plus»,expliqueWilliam
Liu,le scientifiqueresponsable de
l’environnementspatialàl’Agence
spatiale canadienne,jointpartélé-
phone àCalgary,oùil participe à
une réunion sur lasciencesolaire-
terrestre. «Ilfaut alors fairedesmesures
secondairesavecd’autresappareils,
etvoircommentellessontcompatibles
avecunaffaiblissementduvent
solaire.»
L’équipe de l’UniversitéJohn
Hopkinsautilisédescapteurs de
particulesàbasseénergie,etassure
avoirvérifié avecde vieillesdonnées
de Voyager1(l’instrumentde mesure
duventsolairenefonctionne plus
depuis1980etc’est le seulàavoir
flanché) quelesmesuresde particules
àbasseénergie varienten fonction
de lavitesseduventsolaireavec
une marge d’erreur de seulement20%.
Selon leurs mesures,le ventsolaire
abaisséde1million de kilomètres
àl’heure,à150000 km/h.
Effetde serre
Quand lesvents interstellaireet
solaireserencontrent,le choclibère
d’autresparticules,encoreplus
chargéesd’énergie. Certainesvont
vers l’espace,etnourrissentle vent
interstellaire. D’autresvontvers le
Soleil,etinteragissentavecl’atmo-
sphèredesplanètes.
«Lesparticuleschargéestrèséner-
gétiquesquisontissuesduchocentre
lesvents interstellaireetsolaireconsti-
tuentlessemencesdesnuagesde
pluie sur laTerre,expliqueM.Liu.
Ellesattirentlesmoléculesd’eau,
grâceàleur charge,etjouentunrôle
importantdansle climatterrestre. Si
Voyager1aeffectivementrencontré
lazone oùle ventsolaireralentit,
celasignifie quecesparticulesjouent
unrôle plus grand qu’on pensaitsur
le climat.Etdoncquelerôle de
l’activitéhumaine dansleschange-
mentsclimatiquesest moinsgrand
qu’onpensait.»
Quoi qu’il en soit,Voyager1re-
trouverabientôtunventsolaire
normal:laposition de l’héliopause
varie avecle cycle solaire,etprésente-
ment,laforceduventsolairevaen
augmentant,reculantd’autantl’hélio-
pause. «Quand le Soleil est dansla
phaseactivedeson cycle,son énergie
vasurtout vers lestachessolaires,
quigrossissent,ditM.Liu.Dansla
phasedescendante,lestachessolaires
relâchentleur énergie,augmentant
laforceduventsolaire.»
Voyager1 ,quifile à60 000 km/h,
n’ade l’énergie quepour une quin-
zaine d’années.Elle n’enverra
probablementjamaisd’informations
en provenancedel’espaceinter-
stellaire,quicommencevers 150UA.
Lesdernièresdonnéesseronttrans-
misesvers 2020,environ à140UA.
IlfaudraunautreChristophe Colomb
pour avoirdesnouvellesde la
«dernièrefrontière».
La sonde spatiale Voyager1arriveaubout duvent
solaire. Cequ’elle ytrouverapourraitbien éclairer
le débatsur…l’effetde serre.
PHOTO JET PROPULSION LAB,NASA
L’effetChristophe Colomb
Voyageur 1aquittélaTerreen1977 etsetrouvemaintenantà90UA dusystème solaire.
HÉLIOPAUSE
ONDE DE CHOC INTERNE
ONDE DE CHOC AVANT
VENT
INTERSTELLAIRE
VENT
INTERSTELLAIRE
VENT
SOLAIRE
VOYAGER 1
VOYAGER 2
SOLEIL
TERRE
SATURNE
URANUS
PLUTON
JUPITER
NEPTUNE
Leventinterstellairedévie en partie quand il
rencontreleventsolaire. Celaforme une sphère
irrégulièreautour de notresystème solaire.
Cettesphèreadéjàétéobservée autour d’autres
étoiles.La zone bleupâle est celle oùle ventsolaireperddelavitesse. Quant
auventinterstellaire, il ralentitaupassage de l'onde de chocavant.
Aumilieu,l’héliopause, oùil n’yaplus de ventspatial.
INFOGRAPHIE LA PRESSE /GRAPHIC NEWS /JET PROPULSION LAB,NASA
.
1
/
1
100%