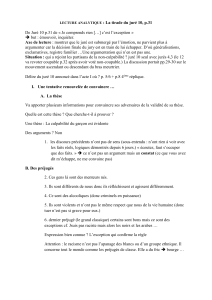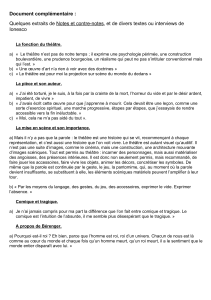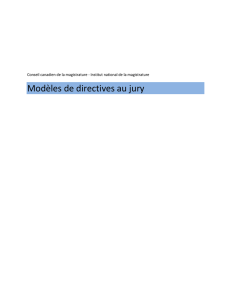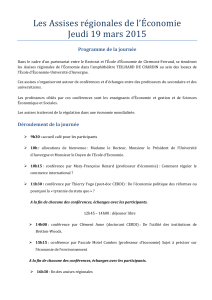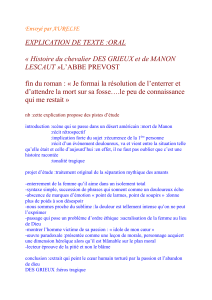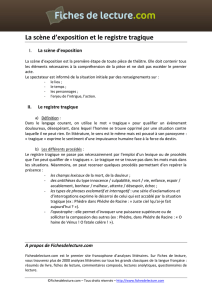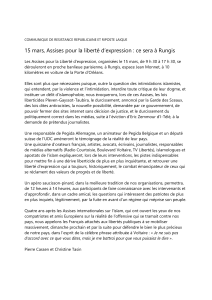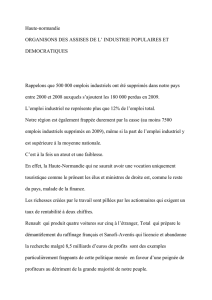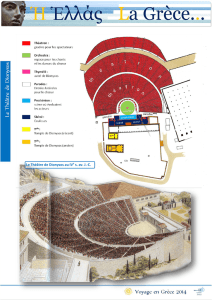Préface de Véronique Nahoum-‐Grappe, anthropologue,1 du livre

!
"!
#$%&'()!*)!+%$,-./0)!1'2,0345$'66)7!'-82$,6,9,:0)7"!*0!9.;$)!*)!<,62.)!
=%6>?7!Probe&et&Libre,&un&écrivain&juré&d’assise?7!%*@A0(2)8BC2'?8)97!DE"F@!
!
!
!
GH8$'.8?!I!
!
!
!
!G8$)!J0$%!*'-?!0-)!(,0$!*K'??.?)?!)-!L$'-()!-)!$)??)3M9)!)-!$.)-!N!()!/0)!9K,-!.3':.-)!
)-! '3,-8!I! 9)! J0$%! ($,.8! ?)! $)8$,0;)$! ! )-! 6,?.8.,-! *)! ?6)(8'8)0$! )H8%$.)0$! )8! (0$.)0H!
6)-*'-8!9)!6$,(>?7!!3'.?!!8,08!*)!?0.8)7!.9!?)-8!/0K.9!-K)?8!6'?!au&cinéma@!O9!-KP!'!6'?!!*)!
?(%-'$.,!!%($.8!N!9K';'-()!/0.!69'/0)$'.8!?'!('0?)!&.-'9)!?0$!9)!3,.-*$)!?0?6)-?@!O9!-KP!'!
6'?! -,-!690?! 9'! *,0M9)! ?0$&'()! ! *0! J)07! /0'-*7! *'-?! 9)! &.937! 3,$8?! )8! ($.3)?! Q!6,0$! *)!
$.$)!R! ?,-8! 3.?! )-! .3':)?@! ! O(.7! 9)! ?,(9)! *0$! *)?! (2,?)?! /0.! ?,-8! ;$'.3)-8! '$$.;%)?! )?8!
8,0(2%!Q!6,0$!*)!;$'.!R@!!
!
S)!!J0$%!$)??)-8!*'-?!?,-!(,$6?!';'-8!3T3)!8,08)!(,-?(.)-()!9'!:$';.8%!*)!9'!?.80'8.,-!I!
8,08!J0$%7!9,$?/0)!9'!?%'-()!!?K,0;$)7!?K.33,M.9.?)!.-8%$.)0$)3)-8!)-!&'()!*)!9K%-,$3.8%!
*)! ()! /0.! )?8! )-! /0)?8.,-7! N! ?';,.$! 9K%9'M,$'8.,-! (,99)(8.;)! *K0-! J0:)3)-8! 6$,-,-(%! '0!
-,3!*)!9'!?,(.%8%7!)8!*,-8!!9K%-,-(%!60M9.(!!(,-?8.80)!!9K'(8)!!?,(.'9!I!9'!;.)!*)?!6$%;)-0?!
6)08!M'?(09)$!*>?!9'!&.-!*)!9K'0*.)-()@!!!!
#)-*'-8! 9)?! /0)9/0)?! 2)0$)?7! 9)?! /0)9/0)?! J,0$?! *K0-)! ('0?)! 8$'.8%)7! J0$%?7! J0$.?8)?7! )8!
6)$?,--)?!.369./0%)?!!;,-8!T8$)!$%0-.?!*'-?!0-!3T3)!9.)0!I!8,08!*,.8!?)!J,0)$!N!9K%(,08)!
*)?!6'$,9)?!/0.!?)$,-8!6$,-,-(%)?7!()!/0.!(,-8$'.-8!9)!Q!J0$%!6,609'.$)!R!!N!0-)!%(,08)!
)H()68.,--)99)7! 0-)! 8,8'9)! 3,M.9.?'8.,-!U! ?'! ?.80'8.,-! ! *V)H8%$.,$.8%! '0H! &'.8?! '(($,W8! 9'!
-%()??.8%! *K,0;)$80$)! .-8.3)! ! '0! 6$%?)-8@! XK)3M9%)7! (K)?8! *K0-)! *,0M9)! %(,08)! /0K.9!
?K':.8!I!()99)! *K0-! .-(,--0!!N!9'!M'$$)7!)8!()99)7! 8,08!'0!&,-*!*)! ?,.7!*)!?,-!6$,6$)! Q!&,$?!
.-8%$.)0$!R!I!.9! ?K':.8! *)!?)! 6,?)$! 9'!/0)?8.,-! «&mais&qu’est8ce&que&je&pense&???&»!';)(! 0-)!
.-8)-?.8%!)8!0-!?%$.)0H!$'$)3)-8!$)/0.?!*'-?!9'!;.)!/0,8.*.)--)@!!S)!Q!J0$%!6,609'.$)!R!/0.!
-K)?8! 6'?! 0?%! 6'$! 9K2'M.80*)! ,0! 9)! 3%8.)$! *,.8! !%8'M9.$! )-! ?,.! !0-)! /0'9.8%! *)!?.9)-()!
)H()68.,--)99)@!O9!-K)?8!690?!!/0K0-!3.$,.$!!*0!6$%?)-87!0-!6)0!&.:%@!!
C,33)! ?.! 9)! $'9)-8.??)3)-8! (%$%3,-.)9! ! *)! 9'! ?.80'8.,-7! 9'! -%()??'.$)! ,$:'-.?'8.,-!
$.80'9.?%)!!*)?!:)?8)?!)8!*)?!6'$,9)?!(,99)(8.;)?!!*>?!/0)!9'!?%'-()!)?8!*%(9'$%)!Q!,0;)$8)!R!!
?)!(,-J0:0'.8!';)(!9K)?82%8./0)!3T3)!*0!9.)0!)8!()99)!*)?!8,:)?!*)?!J0:)?!6,0$!(,-;,/0)$!
9)!$%)9!*)!9'!?.80'8.,-!I!8,08!N!(,067!/0'?.3)-8!62P?./0)3)-87!9)!8$':./0)!*)?!&'.8?!8'6.?!
'0! &,-*! ! *)! ()! /0.! )?8! )-! J)0! &'.8! .$$068.,-!?0$! 9'! ! ?(>-)! !*0! 6$%?)-87! (,33)! 0-!
(2'-:)3)-8! *)! /0'9.8%! *)! 9K'.$7! (,33)! ?.! ! 9K,3M$)! &$,.*)! *)! 9K.*%)! *K.-('$(%$'8.,-! )8!
9K,*)0$! 3T3)! *)! 9'! ($0'08%! *)?! &'.8?! (,33.?! %8'.)-8! *);)-0! 6'96'M9)?! 6'$! 8,0?7! .(.7!
3'.-8)-'-8@!!
SK'08)0$! *)! ()?! 9.:-)?! -K'! J'3'.?! (,--0! *)! ?.80'8.,-! ,Y! 9'! *.3)-?.,-! (%$%3,-.)99)! )8!
$.80'9.?%)! ! *)! 9'! ?(>-)! )?8! '0??.! 9.%)! '0! &,-*! *)! ()! /0.! )?8! ;%(0! 6'$! (2'(0-@! C)! &,-*!
8$':./0)! ! /0)! 9'! ;.)! ,$*.-'.$)! )8! ! 9)?! 3,-*'-.8%?! ,&&.(.)99)?! 3'?/0)-8! )8! )-8)$$)-8@! C)!
8$':./0)! *)?! &'.8?! .$$%;)$?.M9)?! )8! *)?! *)?8.-?! )-! ?0?6)-?! /0K,-! 6$%&>$)! )-! :%-%$'9! -)!!
J'3'.?! )-;.?':)$7! ?0$8,08! '0! (.-%3'! ,Y! 9K2,$$.M9)! )?8! *%9.(.)0?)3)-8! &'0H7! ! ! )?8! .(.!
(,-;,/0%!3':.?8$'9)3)-8!et&précisément!6'$!9'!$.80'9.?'8.,-!!*)!9K'(8.,-@!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!+%$,-./0)!1'2,0345$'66)!'!%8%!J0$%!*K'??.?)?!)-!DEEZ!N!#'$.?!)8!6'$9)7!)-!6$%?)-8'-8!()!9.;$)7!*)!?,-!
)H6%$.)-()!*)!J0$%@!

!
D!
![0(0-! &.937! 3T3)! 60.??'-8! )8! 8$':./0)7! ! 3T3)! $'9)-8.! )8! &,$3.*'M9)3)-8! 3'8%$.)9!
\(,33)!?,0;)-8!*'-?!9)?!:$'-*)?!%($.80$)?!&.93./0)?!8$'.8'-8!*0!?,(.'9]!-)!6)08!$)-*$)!
()!/0.!?)!6'??)!.(.!!!6'$()!/0)!-,-!?)09)3)-8!8,08!)?8!Q!6,0$!*)!;$'.!R7!!rien&&n’est&joué&à&
l’avance7! 3'.?! ! )-! 690?7! 9)! J0$%! -K)?8! 6'?! ! ! N! 9K)H8%$.)0$!! *)! 9K%($'-! I! 90.! /0.! ?)! ($,P'.8!
6$,8%:%!!)8!;,P)0$!!6$)-*!8$>?!;.8)!(,-?(.)-()!/0K.9!)?8!8,8'9)3)-8!.369./0%!(,33)!?0J)8!
?0$! 9'! ?(>-)7! *'-?! 9K'(8.,-! )-! (,0$?!@! ! S'! -%()??.8%! *)! ?'! 8,8'9)! 3,M.9.?'8.,-! 9K,M9.:)! N!
.-;)?8.$!?,-! 6$,6$)! $):'$*! *K0-)! ?,$8)!*)!3,$'9)!I!.9!&'08!'(()68)$!*)!;,.$!?'-?!)-(,$)!
(,36$)-*$)7!*K,Y!0-)!'88)-8.,-!&,$()-%)!'0H!6$%?)-()?!62P?./0)?!*)?!'(8)0$?7!8%3,.-?!
'((0?%?!69'.:-'-8?@!!S)0$?!6$,&.9?7!9)0$?!?.92,0)88)?7!9)?!69.?!!&$,.??%?!*)!9)0$?!(2)3.?)?7!
8,0?!9)?! *%8'.9?! *)! 9)0$?! &'^,-?! ! *KT8$)7! ?,-8! *%;,$%?! Q!! *)?! P)0H!R! I! 9'! (,-?,33'8.,-!
;.?0)99)! *K'08$0.! ;09-%$'M9)! N! 9'! M'$$)! )?8! *K'08'-8! 690?! .36.8,P'M9)! ! /0)! 9)?! :$'-*?!
?.9)-()?!'08,0$!!*)?!!6'$,9)?!6,-(80)-8!9K'88)-8)!*)!()!/0K.9?!;,-8!*.$)@!!
SN! '0??.7! 9)! Q!6'?! N! 6'?!R! J0*.(.'.$)!(,-8$'.-8! N! .-8)-?.&.)$! la& présence& & & au& présent!!*)!
(2'(0-!*)?!J0$%?!I!690?!,-!$):'$*)7!plus&on&écoute@!!S)!?,-!*)!9'!;,.H7!!?'!8,-'9.8%7!8,08)!9'!
(2'.$!3'8%$.)99)!*)!9'!6'$,9)!?)3M9)-8!?)!*%69,P)$!*)!&'^,-!!Q!;.?.M9)!R!'08,0$!*)!()!/0.!
)?8!6$,-,-(%@!_-!6)0!(,33)!'0!82%`8$)7!,Y!9)?!(,$6?!!62P?./0)?!*)?! '(8)0$?! )-! ?(>-)!
&'.8!!;.M$)$!';'-8!3T3)!8,08)!:$'-*)!$%6'$8.)!9K)?6'()!.-8%$.)0$!*0!?6)(8'8)0$7!8,0(2%!)8!
3,M.9.?%!)-!69).-!(a0$!6'$!9'!&,$()!?.9)-(.)0?)!*K0-)!6$%?)-()!203'.-)7!)-!(2'.$!)8!)-!
,?7!)8!-,-!6'?!!?)09)3)-8!?0$!9K%($'-@!!
b'.?! 0-)!(,0$?! *K'??.?)?! -K)?8! 6'?! -,-! 690?! (,33)! 0-)! 6.>()! *)! 82%`8$)!I! .9! -KP! '! 6'?!
*K'08)0$! .(.7! 6'?! *)! ?.:-'80$)!)-! M'?! *)! 9'! 62$'?)! M.)-! *.8)@! X'-?! 0-! 6$,(>?! *K'??.?)?7!!
9K'08)0$!&%$,()!!*)!9'!8$':%*.)!)-!(,0$?7!c’est&la&vie,!*'-?!8,08)?!9)?!'(()68.,-?!6,??.M9)?!!
*)! ()! 3,8! ?.! (,0$8@! Q!S'! ;.)!R7! $'3'??%)! )-! ?6.$'9)! *)! (,-8)H8)?! 2.?8,$./0)?! )8! ?,(.'0H!
)-8$)9'(%?!'08,0$!!!*K0-!T8$)!203'.-!I!.9!)?8!-%!)8!.9!*);.)-87!!)87!0-!J,0$!.9!!?)!$)8$,0;)!9N7!
'((0?%7!;.(8.3)7!*)!*,?7!*)!6$,&.97!'0!()-8$)!*K0-!3,3)-8!($0(.'9!,Y!8,08!()!/0.!%8'.8!Q!?'!
;.)!R! ! ?)! $%*0.8! !!N! 9'! ! 8'.99)! *K0-)!9)-8.99)7! ()! 3.99.3%8$./0)! -,P'0! *0$! *)! 9K.*)-8.8%7! 0-!
6,.-8!)-8$)!*)0H!?%/0)-()?!4!.9!P!'0$'!0-!';'-8!)8!0-!'6$>?!4!)-8$)!*)0H!62$'?)?!*0!$%(.8!
*)!;.)7!!)8!/0.!M$.99)!'0!&,-*!*)!9Ka.9!!*)!()90.!!/0.!;'!T8$)!J0:%!7!'??.?!?0$!()!M'-(7!!?)09!
(,33)!0-!!('.99,0@!!
S'!?.92,0)88)!203'.-)!*)??.-%)!'0!3.9.)0!*K0-)!?(>-)!!)-8.>$)3)-8!*%*.%)!!'0!6,0$/0,.!
*)?!&'.8?7!)8!*,-(!N!9K%-.:3)!*)!()!/0K.9!)?87!$)??)3M9)!*)!690?!)-!690?!N!0-)!?8'80)!I!3T3)!
9)?! 690?! 3,*)?8)?! *)?! '(8)0$?7! 9)?! 3,.-?! 6$.;.9%:.%)?! ?,(.'9)3)-8! %(,-,3./0)3)-87! )8!
(0980$)99)3)-8! *)?! 6)$?,--)?! .369./0%)?7! !(2'-:)-8! *)! ?8$0(80$)! 62P?./0)!9,$?/0K.9?!
?,-8! ! ! '66)9%?!N! 9'! M'$$)! !I! .9?! ?)! *$)??)-8! ! ,0! ?)! ;,08)-8! (,33)! *)?! ?8'80)?! '-8./0)?7!
(,33)!*)?!!:$'-*?!'(8)0$?!*)!82%`8$)7!8,08!9)0$!(,$6?!!?)3M9)!)-;)9,66%!6'$!9)!8$':./0)@!
S)!8$':./0)! *0! 3,3)-87! $)*,0M9%! .(.! *)!()90.!*0!&,-*!*)!9'!?.80'8.,-7!*)!8,08)!9)0$! ;.)!
$'3'??%)! .(.! '08,0$! *K0-! $%(.8! 60M9.(@! c,08! 9)0$! (,$6?! ?)3M9)! ! 2'M.99%! 6'$! 9'! 8$.69)!!
8$':%*.)! *0! 3,3)-87! *)?! &'.8?! (,33.?7! ! *)! 8,08! 9)0$! 6'$(,0$?! *)! ;.)@! ! ! c$,.?! ;,.9)?!
3,.$%?7! ?0'.$)?!!-,-! ;.?.M9)?! /0.! ! $)*)??.-)-8! 8,08)! 9)0$! 6,?80$)?! )8! (2'-:)-8! 9)0$?!
$):'$*?7!!'0J,0$*K20.!?)09)3)-8@!!S)?!?.92,0)88)?!N!9'!M'$$)!!?,-8!'9,$?!(,33)!!$)?.80%?!!
?)09?!!!'0!()-8$)!*)!9)0$?!6$,6$)?!;.)?7!)8!9K)-?)3M9)!!8$':./0)!/0.!9)?!)-;)9,66)!(,33)!
0-!?0'.$)!3)8!'9,$?!!N!-0!9)0$!203'-.8%!8,8'9)3)-8!62P?./0)!)8!8,8'9)3)-8!?,(.'9)!!!@!
!O(.!!9)?!(,$6?!?,-8! &,$3.*'M9)3)-87! 62P?.,9,:./0)3)-8!!?.:-.&.'-8?7! (,33)! '0! 82%`8$)7!
/0'-*!,-!?K'M.3)!*'-?!9)!:$'.-!*K0-)!6)'0!,&&)$8)!'0H!P)0H!?0$!()88)!J,0)7!?0$!9)!:$'?!*0!
M$'?7!!)8!()88)!M,0(9)!!*)$$.>$)!9K,$).99)7!(,33)!)99)!?)!;,.8@!C,33)!'0!82%`8$)7!,-!'88)-*!
9'!-'.??'-()!*)!9'!6'$,9)7!!9)!(,$6?!*)!9'!;,.H!/0.!:$'-*.8!*'-?!9)!M)$()'0!*0!?.9)-()!*)!
8,0?@! S)! ?.9)-()7! ! 2'3'(! 6$,*.:.)0H! *K'88)-8)?! ($,.?%)?! '08,0$! *)! ()! /0)! ;'! *.$)! 9'!
6)$?,--)! ! ?.! ?)09)! *)M,08! 9N! '0! ()-8$)! *)! 9'! ?(>-)!I! 9,$?/0)! 9)?! ! 6)$?,--)?! ?,-8! -,-!
?)09)3)-8! .??0)?! ! *)! 3.9.)0! 3,*)?8)7! 3'.?! /0K)-! 690?! ! 0-)! 3,*)?8.)! 'M?,90)! )8! -,-!

!
F!
6)-?%)!9)?!*%&.-.84!'0!?)-?!,Y!jamais!*'-?!9)0$!;.)!&'3.9.'9)!)8!?,(.'9)!9)0$!6'$,9)!'!%8%!
)-8)-*0)7! '88)-*0)7! $)?6)(8%)! ! (,33)! .(.! N! ()! 6$%8,.$)@! ! SK'08)0$! *)! ()?! 9.:-)?7! J0$%!
*K'??.?)! .9! P! '! *.H! '-?7! ?)! ?,0;.)-8! ';)(! 0-)! :$'-*)! %3,8.,-! *)! ()88)! &)33)! ! `:%)7!
8$';'.99)0?)!*)!-0.87!!?.!?0$6$.?)!*0!?.9)-()!)8!*)!9K'88)-8)!*)!8,0?!';'-8!/0K)99)!6$)--)!9'!
6'$,9)7!)8!/0.!'!?0!9)!*.$)!(,33)!?.!Q!J'3'.?!)99)!-K';'.8!6'$9%!';'-8!R@!!
#)8.8!N!6)8.87!8,0?!(,36$)--)-8!/0K.(.!,-!'!/0.88%!9'!;.)!/0,8.*.)--)!,$*.-'.$)7!!!Q!?0$;.)!R!
?)($>8)3)-8!!3)$;).99)0?)!/0'-*!Q!$.)-!*)!!?6%(.'9!R!-)!?KP!6'??)7!()99)!/0.!%(2'66)!N!9'!
;.).99)! ! 3'9%*.(8.,-! (2.-,.?)!I! Q!! J)! ;,0?! ?,02'.8)! *)! ;.;$)! *)?! (2,?)?! .-8%$)??'-8)?!d!R@!
O-8%$)??'-8)?!d! CK)?8! N! *.$)! 8,08)?! ()?! ';)-80$)?! )&&$,P'M9)?! /0)! $'66,$8)-8! 9)?! &'.8?!
*.;)$?7!()0H!/0.!'3>-)-8!9)0$?!2%$,?!*'-?!9)?!(,0$?!*K'??.?)?@!!X'-?!0-)!(,0$!*K'??.?)?7!
8,0?!?)-8)-8!/0K,-!)?8!*'-?!0-!'.99)0$?7!'0!?).-!*K0-!!)?6'()!60M9.(!?6%(.&./0)7!-.!6$,&'-)7!
-.!?'($%7!/0.!-)!!$)??)3M9)!N!$.)-7!-.!N!0-!&.937!-.!N!0-)!6.>()!*)!82%`8$)7!-.!'0!!$%(.8!*0!
&'.8!*.;)$?!*'-?!9)!J,0$-'9@!_-!9.)0!!/0.!?)3M9)!';,.$!%8%!.-;)-8%!!6,0$!8$'.8)$!)H'(8)3)-8!!
*)!9'!!*%(2.$0$)!!M%'-8)!!/0K,0;$)7!*'-?!0-)!?)09)!;.)!(,33)!*'-?!8,08!9)!!8.??0!?,(.'97!9'!
6,??.M.9.8%!!*0!8$':./0)@!
!_-)!(,0$!*K'??.?)?!-K)?8!6'?!!-,-!690?!!9K'$>-)!*K0-!(.$/0)7!)8!6,0$8'-8!?)!J,0)-8!9'!3,$8!
)8! 9'! ;.,9)-()7! 9)! *%?2,--)0$! )8! 9K)-&)$3)3)-8! 9%:'9)3)-8! *%(.*%7! 9'! 6)$*.8.,-! ,0! 9)!
?'908eb'.?7! (,-8$'.$)3)-8! ! N! 9'! 9088)! '0! ()-8$)! *)! 9K'$>-)7! 9)! !6$,(>?! ?)! J,0)! 8,0J,0$?!
*'-?!0-!!*)0H.>3)!!8)36?7!'6$>?!/0)!&0$)-8!(,33.?!9)?!&'.8?@!C,-8$'.$)3)-8!N!()!/0.!?)!
6'??)!*'-?! 9K'$>-)!,Y!9'!9088)7!3T3)!()99)! *0! 8'0$)'07!*,--)!?,-!?)-?!':,-.?8./0)! '0H!
?,0&&$'-()?! /0K)99)! 6$,*0.87! 9'! *,09)0$! /0)! 9)! ($.3)! ($%)! )?8! .-(,36$%2)-?.M9)! )8!
*%&.-.8.;)3)-8!.-'(()68%)7!)8!*,-(!$)J,0%)!?'-?!()??)!6,0$!T8$)!*%&'.8)!)-!?)-?!.-;)$?)!
*0!8)36?@!!
SK.36,??.M9)!'(()68'8.,-!*)!()!/0.!)?8!6,0$8'-8!.$$%;)$?.M9)!!)?8!9)!-,P'0!*0$!*)!()!/0K,-!
6)08! '66)9)$! ! Q!9)! 8$':./0)!R7! ,Y! 9'! ?,0&&$'-()! ! *)?! ;.(8.3)?! ?)! *,0M9)-8! *K0-)! &0$)0$!
$%8$,?6)(8.;)! *)! 8,0?!! (,-8$)! 9)?! &'.8?! (,33.?7! )8! /0.! )36T(2)-8! 8,08)! ?8'M.9.?'8.,-!I!
;.;$)!'6$>?!)?8!'0??.!.36,??.M9)!/0)!*)!3'$(2)$!?0$!0-!M$'?.)$7!*)!?)!$,09)$!?0$!0-!!&':,8!
*K'.:0.99)?! 20$9'-8)?7! *K'(()68)$! 0-!-.*?! *K%6.-)?! '08,0$! *)! 9'! 6$0-)99)7! 9)! $.?/0)! ! Q!*)!
3,0$.$!*)!(,9>$)!R!!)?8!:$'-*!'0!*%M087!!'08,0$!*0!(,$6?!*)!9'!;.(8.3)!7!/0'-*!9)!$T;)!*)!
J0?8.()!?)3M9)!.36,??.M9)@!!!
_-)!!(,0$!*K'??.?)?!'$$.;)!'6$>?!9K2,$$)0$!*)?!&'.8?!(,33.?7!/0'-*!9)!J,0$7!9)!$.*)'07!)?8!
8,3M%!?0$!()!/0.!?K)?8!6'??%!I!9)!*%?.$!(,99)(8.&!*)!$)J,0)$!()9'7!*)!8)-8)$!9)!(,-8$)!*,-!*0!
3'9!&'.87!8,0J,0$?!8$,6!8'$*7!?)3M9)!T8$)!0-)!-%()??.8%!'-82$,6,9,:./0)!*0!faire&société!
203'.-@!!G8!?.!9'!(0980$)!)99)43T3)!-'.??'.8!*)!!()88)!%8$'-:)!.36,??.M.9.8%7!9)!?,.$!;)-07!
*K'(()68)$! 9'! J,0$-%)! /0.! ;.)-8! *)! ?K%(,09)$7! /0'-*! ! .9! ?KP! )?8! 6'??%! /0)9/0)! (2,?)! *)!
8$':./0)!f!!
Une cour d’assise ressemble peut-être à un concert où tous les instruments doivent jouer
ensemble pendant un temps délimité, toutes les offres de sens, toutes les auditions, de toutes
les parties, des experts, etc. : mais un concert symphonique où la partition serait écrite en
même temps qu’elle se joue ! Et où, pour les acteurs en jeu, le final s'ouvre sur un monde
changé, sur un réel tranché par quelques phrases prononcées, sur la bascule de leurs vies dans
un après définitif.
!
1
/
3
100%