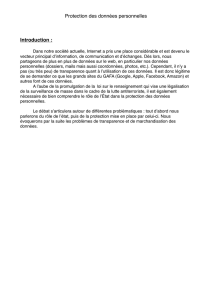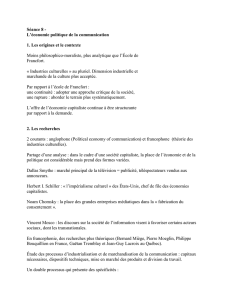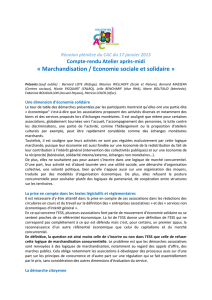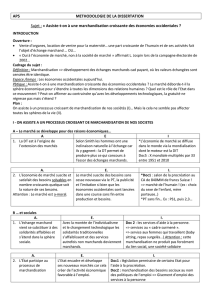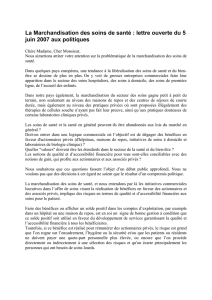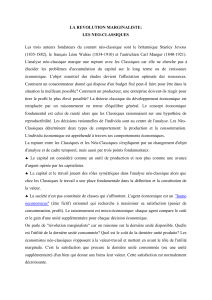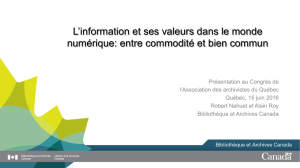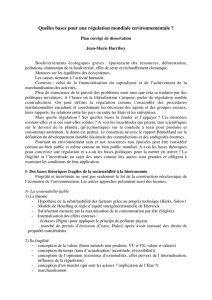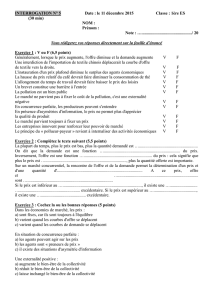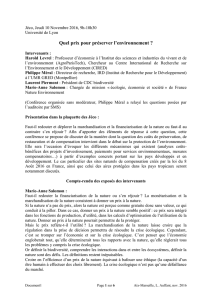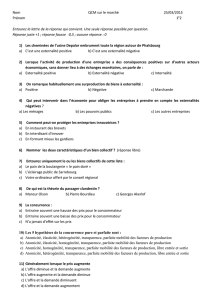Marchandisation et théorie économique

Marchandisation et théorie économique
par Bernard GUERRIEN
Actuel Marx, 2003/2 - n° 34

Marchandisation et théorie économique
Bernard GUERRIEN
Qu’entend-on par marchandisation ? Avant de répondre à cette
question, remarquons que ce mot est utilisé surtout par ceux qui sont
hostiles à ce qu’il désigne (la figure du « marchand », intermédiaire
inutile et éventuellement roublard, n’étant pas celle pour laquelle nous
avons le plus de sympathie, du moins dans nos sociétés). Souvent,
marchandisation est assimilée à « soumission à la loi de l’offre et de la
demande » ou à la « vérité des prix », ceux-ci traduisant en quelque
sorte les besoins de la société.
Quoi qu’il en soit, on entendra ici par marchandisation le processus
consistant à rendre marchande une relation qui ne l’était pas auparavant.
Cette relation prend alors la forme d’échanges sur la base de prix
− ceux-ci sont donc des taux d’échange, généralement relatifs à une
unité monétaire, qui sert de numéraire et d’intermédiaire dans les
échanges. D’où la question : comment vont alors se former ces prix ?
On est là en présence d’une des questions centrales de l’économie
politique, sujet de multiples débats, et qui va donc nous occuper ici.
Marchandisation et « loi de l’offre et de la demande »
La « marchandisation » d’un bien, ou d’un service, consisterait
donc à le soumettre à la « loi de l’offre et de la demande », qui
permettait de faire apparaître (ou « émerger ») un prix − lui-même
expression des préférences des acheteurs et des coûts (et profits) des
vendeurs. Cela est toutefois bien vague. En fait, les fondateurs de
l’économie politique en étaient conscients, et voyaient bien le caractère
erroné − car circulaire − du raisonnement consistant à dire, à la fois, que
les prix dépendent des offres et des demandes, et que celles-ci
dépendent des prix. C’est ainsi que dans le chapitre XXX de ses
Principes de l’économie politique et de l’impôt − chapitre intitulé « De

122 BERNARD GUERRIEN
l’influence de l’offre et de la demande sur les prix » − David Ricardo
écrit : « L’opinion selon laquelle le prix des marchandises ne dépend
que de la proportion de l’offre par rapport à la demande, ou de la
demande par rapport à l’offre, est devenue presque un axiome en
économie politique, et a été à la source de bien des erreurs dans cette
science » (Ricardo, 1821, p. 394). Si Ricardo, mais aussi Smith, Marx,
Mill, pour ne citer qu’eux, rejettent la théorie (l’ « opinion », dit
Ricardo) selon laquelle les prix seraient déterminés par l’offre et la
demande, ce n’est donc pas parce qu’ils l’ ignoraient ou parce qu’elle
n’aurait pas encore été « découverte » : c’est tout simplement parce
qu’ils ne la trouvaient pas pertinente. D’où la nécessité qu’ils ont
ressentie d’introduire des notions telles que le « prix naturel » (Smith),
ou le « prix de production » (Marx), prix autour duquel le « prix du
marché » ne fait que « graviter » − notamment sous l’action de l’offre et
de la demande. Pour Ricardo, « c’est le coût de production qui déter-
mine en définitive le prix des marchandises, et non, comme on l’a
souvent dit, le rapport entre l’offre et la demande » (ibid). Derrière le
coût (ou le prix) de production, il y a évidemment une théorie de la
valeur qui ne dépend pas de l’offre et de la demande (sinon, on
retomberait dans le raisonnement circulaire qu’on veut éviter) : c’est la
théorie de la valeur-travail, qui fournit un étalon, ou une référence (ou
une norme), pour l’échange. Il est vrai que cette théorie n’est pas sans
poser de problèmes − aussi bien dans les versions de Smith, Ricardo et
Marx − mais c’est toutefois la seule théorie de la valeur existante, outre
celle qui dit que « tout dépend de tout » et donc qu’on ne peut rien
affirmer de précis 1. Si une telle théorie a été adoptée par les fondateurs
de l’économie politique, ainsi que par Marx, ce ne peut être qu’après
mûre réflexion, compte tenu des conditions de leur époque − qui n’est
pas fondamentalement différente de la nôtre, tout au moins en ce qui
concerne les rapports de production et la forme d’organisation sociale.
Pourtant, dira-t-on, la théorie « classique » de Smith et Ricardo a
été depuis longtemps supplantée, en tant que théorie dominante, par la
théorie dite « néo-classique », qui − aussi surprenant que cela puisse
paraître − n’a pas de modèle sérieux, ou déterminé, de formation des
prix, malgré les apparences.
1. Les théoriciens néo-classiques actuels évitent d’ailleurs de faire référence à
la valeur ; ils préférent parler de « théorie des prix ». Par exemple, Milton
Friedman a donné pour titre Price Theory au seul manuel qu’il ait publié
(Friedman, 1976). Il est vrai que le livre de référence de Gérard Debreu s’appelle
Théorie de la valeur, mais hormis le titre, on ne trouve trace du mot « valeur »
dans cet ouvrage (il ne figure même pas dans l’index !), qui ne traite que de prix
(Debreu, 1962).

MARCHANDISATION ET THEORIE ECONOMIQUE 123
Marchandisation et marchandage
La démarche qui caractérise la théorie néo-classique est
l’individualisme méthodologique, dans sa version la plus extrême :
chercher à expliquer les relations économiques − et donc, entre autres,
les prix − à partir des caractéristiques des « individus » qui composent
la société. Parmi ces caractéristiques, l’accent sera mis sur la tendance
qu’il y a, chez chacun, à tirer le plus d’avantages possibles de l’échange
− ce qui est une hypothèse acceptable, même si elle n’est pas toujours
vérifiée.
Pour qu’il soit acceptable par les deux parties, l’échange doit être à
l’origine d’un bénéfice mutuel. Mais, et là est toute la difficulté, il y a,
en règle générale, une infinité de façons de partager ce bénéfice − qu’on
l’appelle « surplus », « rente » ou même « plus-value » − et donc une
infinité de taux d’échanges acceptables par les deux parties ; si, par
exemple, l’une d’entre elles est disposée à céder au plus trois pommes
contre une poire, l’autre étant prête à donner au plus deux poires contre
une pomme, alors tous les taux d’échange pommes-poires compris entre
1/2 et 3 sont acceptables − puisque l’échange à ces taux est mutuel-
lement avantageux. « Acceptable » ne veut pas dire « accepté », chaque
partie cherchant à imposer, ou à obtenir, le taux qui lui est le plus favo-
rable. La marchandisation passe donc ici par le marchandage − appelé
aussi négociation bilatérale − dont le résultat est toutefois indéterminé.
Les « classiques » ont cherché à lever cette indétermination en
proposant le travail en tant qu’étalon ; les néo-classiques ayant refusé
cette solution, ils ont tenté de s’en sortir, en vain, en invoquant l’offre et
la demande.
L’imbroglio entre marchandage et offre et demande
Pour donner une idée de cet imbroglio, on peut prendre l’exemple
de l’un des « pères fondateurs » de la théorie néo-classique, Stanley
Jevons. Celui-ci tente d’abord − ce qui est rare − de définir ce qu’est un
marché : « par marché, j’entendrai deux ou un plus grand nombre de
personnes négociant deux ou un plus grand nombre de produits lorsque
les stocks de ces produits et les intentions des coéchangistes sont bien
connus de tous. Il est aussi essentiel que le rapport d’échange entre
deux personnes quelconques soit connu de tous. Et le marché ne s’étend
que dans les limites de ces connaissances communes » (Jevons, 1884,
p. 151). Le marché est donc constitué par un ensemble d’individus qui
négocient entre eux, Jevons supposant en outre (ce qui ne va pas de soi)

124 BERNARD GUERRIEN
que chacun est informé de ce que font les autres. En fait, cette condition
caractériserait plutôt le « marché parfait », évoqué par Jevons un peu
plus loin, sans toutefois le définir : « La conception théorique du
marché parfait est plus ou moins réalisée dans la pratique. C’est le rôle
du courtier dans tout marché étendu que d’organiser l’échange pour que
chaque achat soit fait avec la plus complète connaissance des conditions
du commerce. Chaque courtier s’efforce d’avoir la plus parfaite
connaissance des conditions de l’offre et de la demande et les premières
informations de toute modification […] Par la médiation de la
corporation des courtiers, un consensus complet s’établit et le stock de
tout vendeur, ou la demande de tout acheteur, est portée sur le marché
[…] Donc un marché n’est théoriquement parfait que lorsque tous les
négociants ont une connaissance parfaite des conditions de l’offre et de
la demande et du rapport d’échange qui en résulte » (les italiques sont
de Jevons). On passe ainsi, en quelques lignes, d’un ensemble d’indi-
vidus marchandant directement entre eux à un système complexe (et
vague) où l’existence d’une « corporation des courtiers » permet de
parvenir à un « consensus » sur le « rapport d’échange » qui « résulte »
des « conditions de l’offre et de la demande ». Voilà donc pour l'offre et
la demande – qui « résulte » de quoi ? – introduites subrepticement.
Jevons se doute probablement qu'il fait une entourloupe ; pour s’en
sortir, il introduit la notion vague de « corps commerçant » (trading
body) – qui désigne « toute collectivité soit d'acheteurs, soit de
vendeurs » – ainsi qu'une soi-disant « loi d'indifférence » – « sur le
même marché libre (sic !), à un moment donné il ne peut y avoir le prix
pour le même bien » – pour enfin parvenir à ce qu'il veut : deux courbes
qui se croisent en un point qui donne le prix (unique) et les quantités
échangées d'équilibre. Ce qui lève l’indétermination du marchandage,
mais au prix d'une analyse confuse, pour ne pas dire oiseuse, non
reprise par la suite.
Une tentative de s’en sortir : coalitions et cœur d’une économie
d’échanges
Francis Edgeworth, sans doute un des théoriciens néo-classiques
les plus subtils, a bien vu les failles du raisonnement de Jevons. Par
souci de cohérence, il évite de parler des prix « consensuels », donnés,
alors que c’est à la théorie de les déterminer. Pour cela, il cherche à
lever l’indétermination du marchandage en envisageant l’existence d’un
« grand nombre » d’échangistes (l’idée de grand nombre étant
habituellement associée à celle de concurrence), en supposant qu’ils
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%