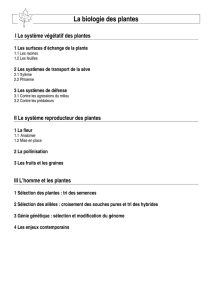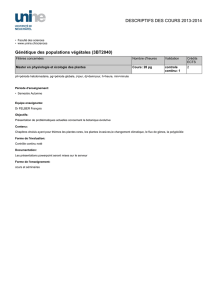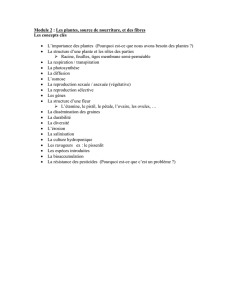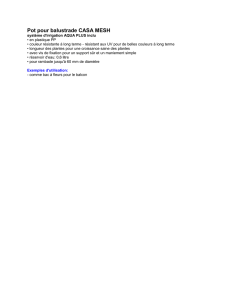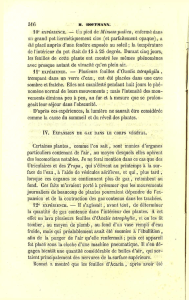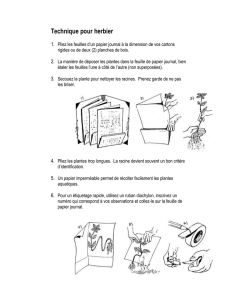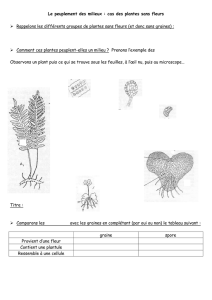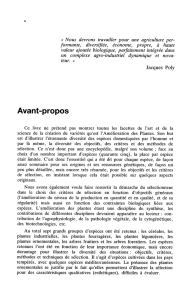Écologie - Réponses aux questions du chapitre 1

1
Nentwig W.
Bacher S.
Brandl R.
2009
manuel de synthèse - écologie
Vuibert Sciences
Réponses aux questions
du chapitre
Expliquez à l’aide d’un exemple la différence entre phénotype, génotype et écotype.
[p. 3-4]
Le phénotype ou image apparente de l’individu est l’ensemble des caractéristiques observables d’un or-
ganisme. La diversité de ses formes apparentes est dictée par les gènes, le développement individuel (on-
togenèse) et les facteurs environnementaux. La variabilité du phénotype d’un individu ou des individus
d’une population (ou d’une espèce) est limitée par le génotype (plasticité phénotypique). Les adaptations
d’une espèce au climat ou aux conditions du sol (édaphiques) d’une localité, fixées génétiquement, sont
désignées par le terme d’écotype. À la Figure 1.1 chaque individu de l’achillée millefeuille représente un
phénotype, tous les individus d’une localité correspondent à un écotype et les individus de toutes les lo-
calités possèdent le même génotype.
Quelle est la différence entre radiation adaptive et spéciation allopatrique?
[p. 5]
Par radiation adaptative on entend l’adaptation d’une espèce peu spécialisée à des exigences particu-
lières, de telle sorte qu’à partir d’une espèce puissent se développer plusieurs espèces plus fortement spé-
cialisées. Lors de la spéciation allopatrique une séparation spatiale (géographique) d’une espèce en 2 ou
plusieurs sous-populations est nécessaire.
1.
2.

Comment vous représentez-vous le biotope d’un organisme sténoèce?
[p. 8]
Un tel biotope ne présente pas par rapport à un facteur donné de grandes variations, ce qui veut dire que
ce facteur est relativement constant. De ce fait, un organisme sténoèce ne sera pas tolérant à son égard.
Comme exemples on peut citer le taux de salinité en mer ou la température dans un ruisseau de montagne
ou souterrain.
Donnez des exemples d’organismes qui peuvent utiliser différentes longueurs d’ondes
de la lumière.
[p. 9-12]
Les plantes utilisent au moyen de leurs photosystèmes et de divers pigments tels la chlorophylle a, le β-
carotène, la phycoérythrine et les phytochromes P 660 et P 730 différentes longueurs d’ondes. Mais les ani-
maux, capables de percevoir les couleurs, utilisent également, grâce à divers photorécepteurs, différentes
longueurs d’ondes, tels l’UV, le bleu, le vert et le rouge.
Les fluides corporels congèlent à une température inférieure à –2 °C.
Existe-t-il tout de même des possibilités de survie à des températures plus basses?
[p. 13-14]
La surfusion de l’eau (supercooling) peut éviter ou masquer les germes de cristallisation, de sorte qu’une
formation spontanée de glace est empêchée jusqu’à très basses températures. L’incorporation de subs-
tances antigel contribue également à renforcer ce phénomène. Lors de gel prolongé, le bilan hydrique de
l’eau corporelle à l’état liquide est beaucoup plus fortement affecté par les pertes dues à la transpiration;
c’est pourquoi la tolérance au gel est dans ce cas-là d’autant plus efficace. Les organismes tolérants au gel
contrôlent la croissance des cristaux de glace dans le liquide extracellulaire. Pour ce faire, ils produisent
des nucléateurs qui induisent aussi rapidement que possible la formation contrôlée de glace, c’est-à-dire
qu’ils minimisent les domaines en surfusion.
Expliquez à une personne chargée de la protection de la nature d’une petite ville
de Méditerranée que le feu est un facteur écologique important.
[p. 17-18]
Chaque jour se produisent dans le monde entier des dizaines de milliers d’orages accompagnés de mil-
lions d’éclairs. Ainsi, lorsque le substrat est approprié, cela peut conduire régulièrement à des incendies
d’origine naturelle. Les éruptions volcaniques aussi sont souvent en relation avec des incendies de grande
envergure. Le pin des Canaries (Pinus canariensis) a sans aucun doute développé sa stratégie de régéné-
ration comme adaptation à son environnement volcanique. En plus de son écorce épaisse, ce pin par-
vient à survivre aux attaques du feu par des pousses provenant de son tronc épais. Dans les biotopes sujets
aux incendies, s’installe une végétation spécifique et typique qui présente, tout comme les animaux, de
nombreuses adaptations au feu.
Par le feu, la biomasse épigée brûle. Si des feux se produisent de manière régulière, peu de biomasse s’ac-
cumulera, de telle sorte que les incendies individuels seront de dimensions modestes. Un incendie après
une longue période sans feux conduit à des incendies particulièrement graves, qui peuvent également
avoir une dimension catastrophique pour l’espèce humaine. Dans les habitats sujets aux incendies, ceux-
ci ne conduisent pas à une destruction du milieu naturel, mais à l’établissement d’une communauté d’or-
ganismes typiques, adaptés au feu.
3.
4.
5.
6.
manuel de synthèse - écologie
réponses aux questions du chapitre 1

Comment se comportent des organismes marins poïkilosmotiques
et homéosmotiques en eau douce?
[p. 20]
Un organisme poïkilosmotique a, en eaux douces, trop d’ions dans ses cellules. En absence d’un système
de régulation, de l’eau pénètre de façon passive dans ses cellules, afin de diminuer et d’équilibrer la concen-
tration trop élevée en sels minéraux. Naturellement, cela ne devrait pas se produire, car sinon les cellules
éclatent à cause de l’important flux d’eau et l’organisme meurt. Un organisme homéosmotique a, dans
une certaine mesure, la capacité de maintenir la concentration ionique de son milieu intérieur indépen-
dante de son environnement, cela veut dire qu’il survivra en eau douce.
Expliquez les avantages et les inconvénients des plantes de type C3, C4et CAM.
[p. 23, 28-29]
Dans la voie de synthèse en C3de la photosynthèse normale, le CO2est fixé dans le cycle de Calvin à un
acide en C3(acide phosphoglycérique) au moyen de l’enzyme ribulose-1,5-bisphosphate-
carboxylase/oxygénase (RubisCO). La RubisCO a une affinité étonnamment faible pour le CO2. La phos-
phorespiration, qui dépend de la température, nécessite presque un tiers du CO2fixé et le rendement de
la photosynthèse diminue lorsque la température augmente. Près de la moitié des protéines des feuilles
participent à la photosynthèse et une grande partie de l’azote fixé doit être utilisé pour la synthèse de ces
protéines. Pourtant, près de 95 % de toutes les espèces de végétaux fonctionnent selon ce principe
(Tableau 1.1).
Dans la voie de synthèse en C4, le CO2est fixé dans les cellules du mésophylle par l’enzyme phospho-
enol-pyruvate-(PEP-)carboxylase au PEP et devient un acide en C4(malate ou aspartate). Celui-ci est
transporté dans les cellules différenciées morphologiquement de la gaine périvasculaire jouxtant les fais-
ceaux libéro-ligneux, dans lesquelles a lieu le cycle normal de synthèse en C3. Là, séparée sur le plan spa-
tial, une molécule de CO2est détachée de l’acide organique et métabolisée par la voie en C3. La voie de
synthèse en C4est particulièrement avantageuse, car la PEP-carboxylase a une plus grande affinité pour
le CO2que la RubisCO. Par conséquent, la photosynthèse peut encore se faire, même par faible concen-
tration en CO2, autrement dit les concentrations de gaz en présence peuvent être utilisées de manière
plus efficace. Étant donné que davantage de CO2peut être fixé par unité de temps, la consommation
d’eau par molécule de CO2d’un tiers seulement est nettement inférieure à la fixation par la voie C3; les
pertes dues à la photorespiration sont minimisées, et la dépendance désavantageuse de la température est
supprimée. Les plantes en C4n’ont qu’1⁄3 à 1⁄6 de la teneur en RubisCO des plantes en C3. De ce fait, leur
besoin en azote s’en trouve réduit, ce qui les rend nettement moins attractives pour les herbivores, qui sou-
vent préfèrent des plantes riches en azote. Les plantes en C4ont besoin de températures plus élevées, de
fortes intensités lumineuses, et sont en mesure de fournir une production à pleine puissance à l’ombre.
Les plantes en C4sont donc dominantes dans les zones arides ou tropicales du monde, les plantes en C3
dans les zones non-tropicales, humides et fraîches ou montagneuses (Tableau 1.1). Près de 2 % de toutes
les espèces de végétaux sont des plantes en C4, parmi lesquelles il y a de nombreuses graminées (maïs,
canne à sucre, millet), également des espèces d’amarantes queue-de-renard (Amaranthaceae) et de ché-
nopodes (Chenopodiaceae), mais cependant pas d’arbres proprement dits, qui représentent pourtant les
85 % de la biomasse globale.
Les plantes de type CAM (crassulacean acid metabolism) disposent d’une combinaison des deux méca-
nismes précités, qui est particulièrement appropriée pour économiser l’eau. La séparation de la forma-
tion du malate lors de la photosynthèse n’est pas spatiale, mais temporelle. De nuit, le CO2est absorbé par
les stomates largement ouverts et fixé par la PEP-carboxylase sous forme d’acide maléique. De ce fait, le
pH en moyenne de 6, descend à 4, ce qui est nettement dans le domaine acide. De jour, les stomates sont
bien fermés, de sorte que la perte en eau est minimisée et le CO2est libéré à partir de l’acide maléique,
puis fixé par la RubisCO. La forte concentration de CO2à l’intérieur des feuilles empêche dans une large
mesure les pertes par photorespiration. Environ 3 % de tous les végétaux utilisent la voie CAM et se ré-
partissent dans au moins 18 familles végétales différentes. Il s’agit avant tout d’épiphytes des forêts hu-
mides tropicales (par exemple les orchidées et les Tillandsia), mais aussi d’espèces qui préfèrent les
biotopes arides aux fortes variations de température (Tableau 1.1). Les grosses vacuoles du mésophylle de
ces végétaux stockent de l’eau et du carbone.
7.
8.
manuel de synthèse - écologie
réponses aux questions du chapitre 1

Pourquoi est-ce que l’azote, gaz le plus abondant dans l’air, est un facteur limitant
dans la plupart des écosystèmes?
[p. 31]
L’azote est l’élément de croissance limitant le plus important. Son stock principal se trouve dans l’atmo-
sphère, constituée à 78 % de N2.Comme la plupart des organismes ne peuvent pas absorber l’azote sous cette
forme, celui-ci doit être transformé en une forme adéquate, le plus souvent en nitrate ou en ammonium.
Cela se passe dans des cycles complexes, particulièrement variés, car l’azote existe à des degrés d’oxydation
allant de –3 à +5.Beaucoup de microorganismes parviennent à fixer l’azote atmosphérique, le rendant ainsi
accessible aux organismes dits supérieurs. Ce groupe comprend des bactéries libres comme Azotobacter sp.
(en zones tempérées) ou Beijerinckia sp. (zones tropicales) ainsi que les cyanobactéries. Ces micro-orga-
nismes fonctionnent de manière particulièrement efficace à pression partielle d’oxygène basse, par exem-
ple dans les rizières submergées. Les fixateurs symbiotiques d’azote forment en outre des associations étroites
avec quelques espèces ou familles de végétaux. Les hétérotrophes absorbent l’azote avec la nourriture, par
exemple sous forme d’acides aminés ou de protéines, c’est-à-dire sous forme de liaisons organiques.
Quelle est l’importance du rapport C/N dans les analyses du sol?
[p. 35]
Le rapport entre le carbone et l’azote dans la litière (rapport C/N) donne des informations sur la dégra-
dation de la substance organique. Plus il y a d’azote, plus rapidement a lieu leur décomposition.
Comment peut-on expliquer l’aire de répartition disjointe d’une espèce?
Y a-t-il des exemples?
[p. 38]
Les aires de répartition fermées présentent également des lacunes, car tous les domaines ne se prêtent pas
à la colonisation par une espèce donnée. Si les lacunes sont de grande taille et ne peuvent être ni coloni-
sées ni franchies, on parle d’aire disjointe (Figure 1.16). Souvent, il s’agit des vestiges d’une aire autrefois
plus vaste. En Europe, la disjonction arcto-alpine est importante; elle est survenue à la suite du retrait de
la végétation de toundra dans les zones arctiques et dans l’arc alpin. Un exemple d’une telle répartition
est donné par la dryade à huit pétales (Dryas octopetala) ou par le lièvre variable (Lepus timidus).
Peut-on mesurer le chevauchement de niches de deux espèces et quelles sont les conséquences
d’un fort chevauchement?
[p. 43]
Le concept présenté ici de niche écologique indique une voie permettant de la décrire formellement. On
a besoin à cette fin de deux caractéristiques fondamentalement indépendantes l’une de l’autre: la posi-
tion de la niche et son étendue. La position de la niche définit sa situation dans l’espace. Des espèces ayant
une position de niche similaire sont volontiers regroupées en guildes. L’étendue de la niche indique quelle
part de l’espace de la niche est occupée par une espèce. Les généralistes ont une niche à étendue large, celle
des spécialistes est au contraire restreinte. Dans le terrain, le fitness est difficilement mesurable, c’est
pourquoi on déduit la niche d’une espèce par rapport à son utilisation des ressources. Si on décrit l’uti-
lisation des ressources d’une espèce le long d’un axe par une courbe normale, la moyenne fournit une me-
sure de la position de la niche, l’écart-type donne des indications au sujet de l’étendue de la niche et la
zone de recouvrement de deux courbes est une mesure du chevauchement des niches (Figure 1.17). La
mesure de l’utilisation des ressources n’est pas toujours aisée. Elle est même impossible pour les espèces
éteintes. La morphologie d’une espèce peut cependant donner des indications sur sa niche. La taille d’une
espèce donne déjà bien des informations sur sa niche, notamment la taille des organismes prédateurs
corrèle souvent fortement avec celle des proies.
9.
10.
11.
12.
manuel de synthèse - écologie
réponses aux questions du chapitre 1

Expliquez la différence entre niche fondamentale et niche réalisée.
[p. 44]
La position d’une niche et son étendue ne sont pas des valeurs immuables. On appelle niche fondamen-
tale la partie de l’espace de la niche qui peut être occupée par une espèce. Cette partie de la niche spatiale
à n-dimensions, utilisable au maximum, est modifiée en raison d’interactions interspécifiques (niche
réalisée).
13.
manuel de synthèse - écologie
réponses aux questions du chapitre 1
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%