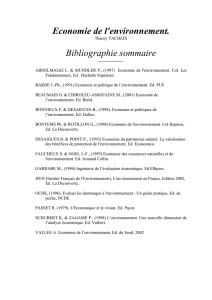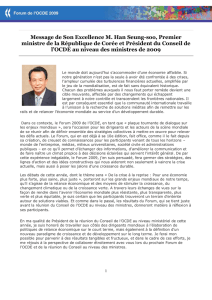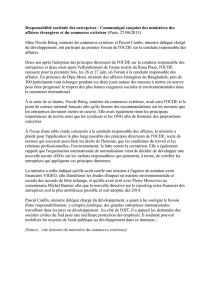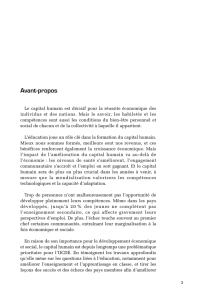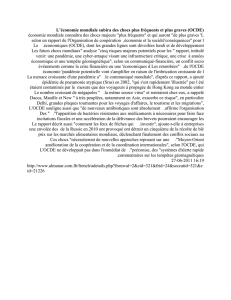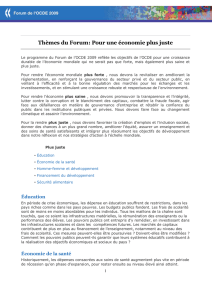vers une organisation locale du développement 2014-2024

VERS UNE ORGANISATION LOCALE
DU DÉVELOPPEMENT
2014-2024
À l’attention des leaders locaux,
maires, conseillers, directeurs généraux et citoyens engagés
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
24 février 2014

Vers une organisation locale du développement, 24 fév. 2014 Page 2
RÉSUMÉ
« Il sera très difficile de développer nos villages ruraux en travaillant chacun dans notre coin.
Travailler ensemble est incontournable, mais pour cela il faut s’organiser et se parler ».
Afin de créer une synergie, source de cohésion entre tous les acteurs du développement (élus,
citoyens, professionnels, gestionnaires, administrateurs) à l’échelle locale, supra locale et
régionale, il convient de partager une même finalité, créer des liens structurés et parler le même
langage technique.
La finalité est simple. Le développement a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des
populations. L’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et le
MAMROT (Ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire) ont
défini 12 balises à cette qualité de vie (voir page 8).
La mise en place d’équipes locales dédiées au développement et l’élaboration d’une
planification simple utilisant un vocabulaire permettant à tous de se comprendre, constituent
les bases de toute démarche locale de développement.
14 ÉQUIPES LOCALES +
14 PLANS
Ascot Corner
–
Bury
–
Chartierville
-
East
Angus
–
Cookshire
-
Eaton
–
Dudswell
-
Hampden
La Patrie
–
Lingwick
–
Newport
-
Saint
-
Isidore
-
de
-
Clifton
-
Scotstown
–
Weedon
–
Westbury
ORGANISMES SUPRA LOCAUX
CDC - Chambres de commerce - CSSS – CSHC – MRC - …
ORGANISMES SUPRA LOCAUX
CLD – SADC – CJE – CLE - …
RÉGION
DSPÉ
MAMROT
MAPAQ
UPA-Estrie
CRÉ-Estrie
CDR-Estrie
MEF
MELS
…
RÉGION
MTQ
CREE
DEC
MCC
MRN
MDEFP
MIC
MFE
…
HAUT-SAINT-FRANÇOIS

Vers une organisation locale du développement, 24 fév. 2014 Page 3
MISE EN CONTEXTE
Depuis 2007, les 14 municipalités du Haut-Saint-François se sont inscrites dans une démarche de
développement globale et intégrée impliquant plusieurs acteurs dont des élus, des citoyens et
des professionnels du développement.
De novembre 2013 à janvier 2014, un bilan a été réalisé par des représentants de quatre
municipalités du HSF (Michel Duval, citoyen engagé ; Raymond Fournier, élu; Denyse Saint-
Pierre, agente locale ; Guy Chagnon, citoyen observateur) accompagnés par l’agent rural. Ce
bilan, complété par le Comité de gestion du Pacte rural, permet de constater que les résultats
seraient plus probants si les relations entre les acteurs étaient mieux structurées. À cet effet, le
bilan a démontré la présence de défis (freins) et d’enjeux (éléments nécessaires au
développement) sur lesquels les acteurs locaux devraient s’appuyer afin d’améliorer leur façon
de travailler ensemble.
=============================
LES DEFIS
Nous répertorions ici les principaux freins existants1.
Les défis avec les citoyens
· Les citoyens sont peu intéressés par la «chose publique» (développement et avenir du
territoire local, élections, séances du conseil municipal, …) ;
· Les citoyens sont surtout intéressés par la baisse ou la stabilité de leur compte de taxes.
· Les citoyens sont critiques de l’action des élus et des bénévoles ;
· Dans certains cas, les néo-ruraux peuvent être vus comme des gens qui veulent imposer
aux natifs quoi faire chez eux (dans des communautés tissées serrées). Dans d’autres
cas, ils peuvent être vus comme des médiateurs ou des arbitres (dans les communautés
où des clans s’affrontent).
Les défis avec les élus
· Les élus ont de très nombreuses responsabilités et doivent s’occuper de tous les
problèmes de gestion courante administrative et légale.
· Plusieurs élus considèrent le développement comme une charge supplémentaire et
certains pensent ne pas avoir de contrôle dessus.
· En matière de développement, les élus délèguent souvent «à l‘aveugle», sans faire de
suivi, l’essentiel étant que les aides financières disponibles soient utilisées.
1 Les défis présentés ci-dessous sont un cumul des défis existants et non ce qui se passe dans toutes les municipalités.

Vers une organisation locale du développement, 24 fév. 2014 Page 4
Les défis organisationnels
· Les actions de développement local sont menées seulement s’il y a des aides financières
disponibles.
· Les actions et le plan de développement sont souvent organisées ou mis à jour dans
l’urgence et peu connu de l’ensemble des acteurs.
· Les représentativités sectorielles dans les comités (loisirs, agriculture, forêt, industrie,
culture, commerce, tourisme, …) peuvent créer des silos et des concurrences dans
lesquelles les représentants s’enferment oubliant la finalité du développement : le
mieux-être collectif.
· Il y a souvent un manque de liens entre les acteurs locaux, supra locaux et régionaux.
· Il y a un manque de connaissance et souvent un désintérêt pour la planification, la
structure et l’organisation générale du développement.
Les défis du bénévolat
· Les bénévoles (élus et citoyens) font ce qu’ils peuvent selon leur temps, leur motivation
et leurs connaissances. On ne peut pas leur en demander beaucoup, car c’est déjà bien
qu’ils donnent et ce ne sont pas des experts.
=================================
LES ENJEUX
Ce sont des éléments sur lesquels toute municipalité devrait miser afin d’avoir des résultats
concrets et à long terme sur son avenir.
- Miser sur des leaders allumés (élus et citoyens) en prenant soin de mixer les
genres (néo-ruraux, natifs, jeunes, aînés, hommes et femmes, etc.) sans pour autant
qu’ils représentent officiellement un genre ou un secteur socioéconomique et tout en
leur reconnaissant des compétences et des expertises individuelles variées (réflexion,
planification, communication, réalisation d’actions, modèle TRIMA, etc.).
- Aller chercher le soutien et l’accompagnement nécessaires, selon les besoins, auprès
des organismes supra locaux et régionaux.
- Créer et animer des espaces de discussion, de réflexion, de partage et d’action
agréables à fréquenter pour tous dans lesquels on peut parler de l’avenir de la
communauté et bâtir ensemble un territoire meilleur dans le plaisir des rencontres.
- Établir des liens de confiance entre les personnes impliquées dans le développement
local.

Vers une organisation locale du développement, 24 fév. 2014 Page 5
- Miser sur une pensée collective (appropriation) en regroupant les citoyens et les élus
afin de discuter de certaines idées ou projets.
- Faire preuve de stratégies afin de gérer la communication entre les acteurs (élus,
citoyens et professionnels du développement). Par exemple, envoyer des lettres
informatives directement chez les citoyens et les élus (il y a un coût, mais le message est
personnel, ça augmente les activités du bureau de poste et ça évite les interprétations
de contenu).
- Prévoir une relève en parrainant de nouvelles personnes dans les espaces de
développement (équipe locale, réalisation de projets, etc.).
- Élaborer un plan stratégique (5 – 10 ans) et d’action à court, moyen et long terme (mis
à jour chaque année) afin de donner un sens durable aux projets réalisés et faire des
liens avec les autres acteurs locaux, supra locaux et régionaux.
- Avoir un budget local de développement non lié aux programmes d’aide.
==================================
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%