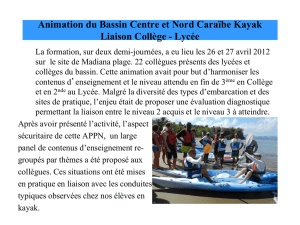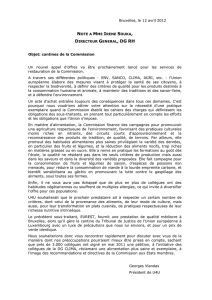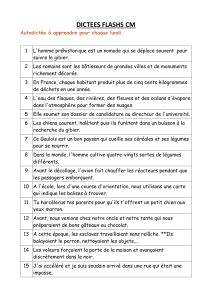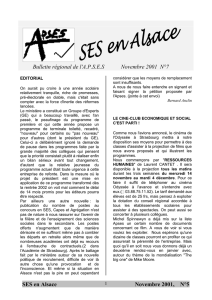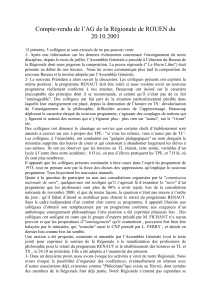Lire le discours de Roberte Hamayon

Je remercie vivement Marie-Françoise Courel et Jean-Paul Willaime de tout ce qu’ils
viennent de dire, il me reste juste à exprimer des remerciements. Tout d’abord pour cette
cérémonie, chère Marie-Françoise, mais aussi pour tout le plaisir que j’ai eu à travailler
auprès de toi au bureau de l’École pratique des Hautes Études, plaisir accompagné d’une
grande admiration. Merci, cher Jean-Paul, de m’avoir accueillie au GSRL où je me trouve
si bien, grâce au riche apport de diverses disciplines et compétences, ainsi qu’à
l’atmosphère ouverte, dynamique et confiante qui y règne. À travers vous, c’est aux
institutions de recherche, aux collègues de tous âges et aux futurs collègues tant français
qu’étrangers, à commencer par mes collègues mongols et bouriates, que je dis ici ma
gratitude pour le partage de ce qu’on appelle la passion de la recherche.
Je tiens à adresser un merci plus personnel à deux collègues sans lesquelles je ne me
trouverais tout simplement pas ici aujourd’hui : Cécile Barraud qui a eu l’idée un jour
d’octobre 2005 de proposer mon nom (mais elle a eu la discrétion de ne pas me le dire) et
Michèle Therrien qui a repris la balle au bond pour lui faire suivre son parcours.
J’ai de nombreuses dettes, en particulier à l’égard de plusieurs disparus dont je voudrais
ici saluer la mémoire : Handijn Njambuu, mon principal informateur mongol ; Éric de
Dampierre, fondateur du labo d’ethnologie et sociologie comparative, pour lequel il avait
conçu un projet généreux et ambitieux articulant recherche, enseignement, documentation
et publication dans une perspective délibérément pluridisciplinaire et comparative : il m’a
donné le goût de la fonction publique ; Évelyne Lot-Falck, à qui je dois d’avoir connu le
monde du chamanisme sibérien et les collections du Musée de l’Homme ; Claude Tardits
qui, à la mort prématurée d’Évelyne Lot-Falck, m’a incitée à poser ma candidature pour lui
succéder en 1974.
Parmi tous les collègues avec qui j’ai collaboré et à qui je tiens à exprimer ma
reconnaissance, que ceux qui sont ici veuillent bien me pardonner de ne citer que des
absents, et encore seulement certains d’entre eux : dans le domaine mongol et sibérien,
Françoise Aubin, Laurence Delaby, Marie-Lise Beffa, Jacques Legrand en France,
Caroline Humphrey à Cambridge, Alain Caillé, fondateur, directeur et animateur du
MAUSS, Maurice Godelier qui a chargé quatre de mes doctorants de réaliser le prototype
de la base de données Objet et Société qu’il a lancée dans le cadre du programme
européen ECHO.

Je suis heureuse que le président de l’EPHE, Jean-Claude Waquet, soit présent, car je
souhaite associer l’EPHE aux remerciements que j’adresse au CNRS. Je n’ai en effet
cessé pendant plus de trente ans d’apprécier cette institution, source d’enrichissement et
de stimulation par la diversité des disciplines et des domaines qui y sont représentés, y
compris du point de vue des tâches administratives que j’y ai menées. À cet égard, je dois
un merci tout spécial à Raymond Duval pour m’avoir fait comprendre, il y a une vingtaine
d’années, tout l’intérêt de l’administration de la recherche.
C’est de tout cœur que je veux dire ma profonde gratitude aux participants de mon
séminaire. Tous les jeudis, leurs remarques et questions étaient si riches et neuves qu’en
sortant de la Sorbonne, je réécrivais l’après-midi le cours que j’y avais fait le matin. Je ne
saurais dire tout ce que l’animation de recherches collectives, la préparation de notre
revue (Études mongoles et sibériennes) et la direction de thèses m’ont apporté :
renouvellement des idées, chaleur des échanges, et une sorte de joie qui m’a fait parler de
mes « merveilleux étudiants » à Françoise Tristani (je la remercie d’avoir retenu cet
aspect de notre conversation). Permettez-moi à ce propos d’adresser une pensée à
Alexandra Lavrillier, qui mène son école nomade aux fins fonds de la taïga yakoute. Je ne
sais ce que je leur ai appris, à mes étudiants, mais je suis sûre que j’ai appris d’eux,
comme j’avais auparavant appris de mes enfants. Je les en remercie tous profondément.
J’adresse un merci tout particulier à ma famille, pour sa compréhension et son soutien :
Loïc Hamayon, Michel Devaux, mes enfants et tout particulièrement mon petit-fils David
Quatrepoint qui aujourd’hui prend des photos à l’intention des autres petits-enfants,
absents.
Je suis heureuse – merci au CNRS – de la reconnaissance que constitue cette médaille
pour ma discipline, l’anthropologie. L’anthropologie, j’y suis profondément attachée en ce
qu’elle vise la connaissance et la compréhension de l’autre en tant qu’alter ego, et j’y
apprécie particulièrement l’articulation de trois dimensions : la recherche de terrain (avec
tout ce qu’elle implique à la fois d’engagement personnel et de prise de distance),
l’approche systématiquement englobante de la vie de l’homme en société dans toute sa
complexité (qui fait que des disciplines voisines s’en réclament), et la comparaison (qui
conditionne ses développements théoriques). Reconnaissance de l’anthropologie donc,
mais aussi, du moins j’aime à l’interpréter ainsi, du domaine sur lequel j’ai travaillé, qui a
été longtemps délaissé parce qu’inaccessible mais qui depuis une quinzaine d’années
qu’il est ouvert attire nombre de jeunes chercheurs.

Parce qu’elle se tient un vendredi 13, cette cérémonie m’offre en outre un clin d’œil pour
aborder mon thème de recherche préféré (d’autant que ce vendredi 13 fait écho au 1er
avril de l’année dernière, quand est parue l’annonce dans la lettre de la délégation de
Paris-A), tel un signe du destin pour superstitieux. Les peuples chasseurs de la forêt
sibérienne m’ont appris à quel point il pouvait être important de repérer comme singuliers
des événements de la vie courante, d’en faire des indices sur lesquels s’appuyer pour
prendre des décisions et orienter son action. C’est un point de vue de démuni, certes, qui
paraîtra d’une énorme naïveté à l’économiste qui va parler tout à l’heure. Mais il était
valable dans ces régions avant l’ère soviétique, il l’est redevenu depuis sa fin non
seulement pour les chasseurs vivant en forêt mais aussi dans le contexte urbain en voie
de modernisation, et il ne saurait nous être tout à fait indifférent à nous non plus.
Pour le comprendre, je vous propose de vous transporter par l’imagination dans la taïga :
immense, sombre, vide d’humains : là, seul le gibier que l’on parvient à prendre permet de
vivre. Tuer le gibier est le moindre des exploits ; il a fallu auparavant légitimer l’activité
même de chasser les animaux pour, croit-on, ne pas encourir leur vengeance et obtenir
leur accord pour qu’ils laissent certains d’entre eux aller à la rencontre du chasseur. On ne
saurait partir chasser sans avoir pris tout un ensemble de précautions qui font de la
chasse une activité tout autant rituelle qu’économique. Il s’agit en effet de transformer
symboliquement la prédation en échange entre espèces. C’est l’objet de grands rituels
compris comme visant à « obtenir de la chance », exécutés par les chamanes. Ces rituels
consistent en jeux, ou en parties que l’on joue avec les esprits animaux pour partenaires
et dont l’enjeu est la « chance » des humains.
Ainsi la chance est un bien symbolique censé augurer de l’obtention d’un bien réel qui ne
peut être produit. La chance, c’est comme le gibier, il n’y en a pas pour tout le monde tout
le temps. Il faut savoir d’abord la gagner en tant que bien symbolique potentiel, mais aussi
s’en servir pour obtenir le bien réel convoité. Aussi un rituel considéré comme réussi est-il
pour les chasseurs un engagement à réussir leur chasse. Il y a là un acte de croyance,
une forme de pari, mais aussi une attitude volontariste inconsciente d’elle-même, qui
prend appui sur toutes sortes d’éléments indiquant, pense-t-on, que la chance est de son
côté et qu’il faut s’empresser de la saisir. Ceci rappelle le kairos grec, l’Occasione que
Machiavel reconnaissait indispensable pour accéder à Fortuna, mais à condition d’avoir
aussi la Virtu.

Dans la Sibérie d’aujourd’hui, cette attitude n’est bien sûr pas limitée à la chasse et
s’applique à toutes sortes d’activités dans le contexte postsoviétique d’ouverture à
l’économie de marché, à tout ce qui demande d’avoir de la chance car ne pouvant être
produit : santé, fécondité, et toutes les formes de succès, dans les affaires de cœur
comme dans les affaires tout court. On la retrouve dans les multiples conduites
divinatoires : tout peut être bon pour prédire, conjurer, ce qui revient aussi à se forcer à
décider et à agir en faisant comme si les choses allaient marcher comme on le souhaite.
Au cœur des fêtes nationales d’aujourd’hui, on trouve les « jeux » caractéristiques des
grands rituels chamaniques d’autrefois. Il faut non seulement jouer mais surtout bien jouer
pour que la vie soit bonne et prospère – ce qui explique l’immense faveur dont jouissent
les Jeux Olympiques dans les pays d’Asie. À la chance, sont associés non seulement le
jeu, mais aussi l’amour, la joie, l’optimisme, la fortune, le succès. Aussi ne s’étonne-t-on
pas de l’orientation contemporaine de la vogue du chamanisme en Occident. Marquée à
ses débuts, à la fin de l’époque coloniale dans les années 1960, par la compréhension
coloniale du chamanisme comme psychothérapie exotique, cette vogue en fait aujourd’hui
de plus en plus une voie d’accomplissement personnel, voire de leadership coaching
comme indiqué sur le site internet d’un chamane parisien, ou de réussite financière
(Shamanic Finance is Integrating Money with Spirit, dit une publicité en Hollande). Cette
vogue est à replacer aussi dans le contexte global actuel marqué tant par le déclin des
grandes religions et idéologies que par la montée de l’individualisme et d’un libéralisme :
tout se passe comme si sans s’opposer vraiment à l’attitude soumise associée aux notions
de Dieu transcendant, d’État et de Providence, se profilait une multiplicité de voies
directes et pragmatiques, libres et potentiellement subversives, consistant à « tenter sa
chance » sans même avoir à mentionner comment et auprès de qui on la gagne.
1
/
4
100%