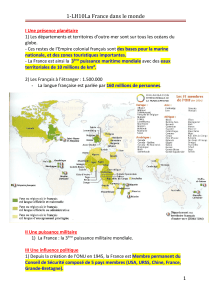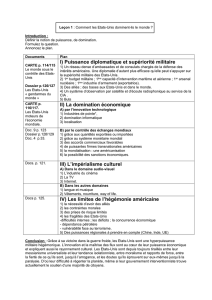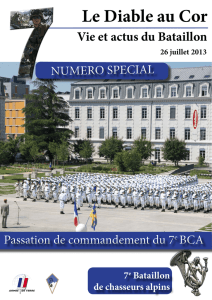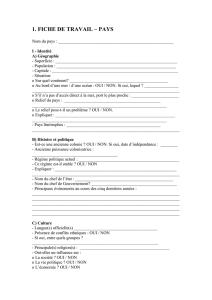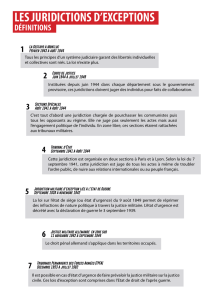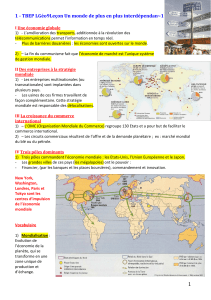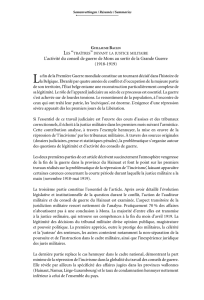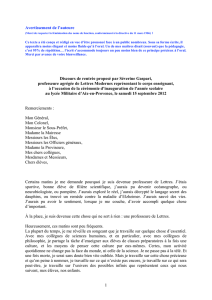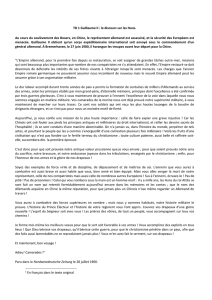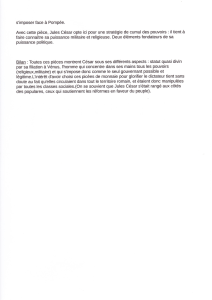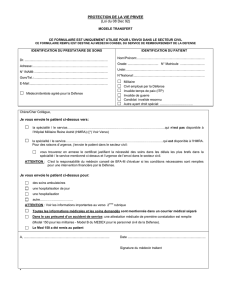La pensée militaire française dans ses publications [fin] - E

La pensée militaire française dans ses
publications [fin]
Autor(en): Bauer, Eddy
Objekttyp: Article
Zeitschrift: Revue Militaire Suisse
Band (Jahr): 94 (1949)
Heft 2
Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-342413
PDF erstellt am: 25.05.2017
Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.
Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

LA PENSÉE MILITAIRE FRANÇAISE 81
La pensée militaire française
dans ses publications
(Suite et fin)
Si même nous ne tenions aucun compte de l'épopée saha¬
rienne de la colonne Leclerc, des exploits des Forces françaises
libres en Erythrée, àBir-Hakeim et àEl Alameïn, ni de la
participation des corvettes battant le pavillon timbré de la
croix de Lorraine, àla bataille de l'Atlantique, la collaboration
apportée par la France àses alliés naturels, dans la seconde
partie de la deuxième guerre mondiale, n'en honorerait pas
moins grandement ses drapeaux et ses étendards. Du 8novem¬
bre 1942 au 8mai 1945, soit durant trente mois, ils ont flotté
aux côtés des couleurs alliées sur tous les champs de bataille
d'Afrique et d'Europe ;numériquement limité pour des raisons
indépendantes de la volonté du gouvernement provisoire
d'Alger, cet apport français n'en apas moins joué son rôle dans
la victoire générale de la coalition démocratique sur les
puissances de l'Axe.
La dure bataille de Tunisie, où les faibles troupes du général
Barré couvrirent la concentration des forces anglo-américaines
en Afrique du Nord, l'assaut décisif du Zaghouan qui mit fin
aux derniers soubresauts de résistance des Messe et des von
Arnim, l'action patiente et brillante du CE.F. en Italie, la
foudroyante exploitation du débarquement de Saint-Tropez,
le forcement de la trouée de Belfort, la prise de Colmar,
l'immortelle campagne Rhin-Danube et la légendaire chevau-

82 REVUE MILITAIRE SUISSE
chée de la 2e D.B. entre Sainte-Mère-Eglise et Berchtesgaden,
via Paris, Dompaire et Strasbourg, autant d'exploits dignes
d'orgueil et de mémoire... Ils nous prouvent, àtout le moins,
qu'il n'est pas de dégénérescence historique, que, bien conduits
et bien armés, les soldats français de cette génération trou¬
vaient dans leur cœur de quoi s'égaler aux combattants de
Verdun, d'Austerlitz et de Fontenoy.
Ceci étant, on ne s'étonnera pas que cette prestigieuse série
d'exploits ait trouvé des historiens aussi brillants que nom¬
breux. Dans le cadre de nos précédents articles, présentons au
lecteur les ouvrages les plus récents qui ont paru sur ce sujet,
tout en protestant par avance que nous n'avons nullement
l'intention d'épuiser la bibliographie française de ces cam¬
pagnes de la libération. Acet effet, il nous conviendrait
d'accaparer une place dont nous ne saurions disposer, vu les
besoins toujours plus pressants de l'actualité militaire.
Relevons, toutefois, en nous bornant aux principales,
certaines lacunes que l'on voudrait voir comblées sans trop
de délai, dans l'intérêt de la tactique et de la technique.
Depuis l'ouvrage du commandant L. Audoin-Dubreuil, paru
en 1945 sous le régime de la censure et de l'autorisation pré¬
alable 1, rien, par exemple, n'a paru qui nous retrace l'ensemble
des opérations du Corps expéditionnaire français en Tunisie.
Et pourtant le sujet vaudrait la peine ;l'habile défensive du
général Barré sur la Grande Dorsale, puis la vigoureuse offensive
des divisions de marche d'Alger, d'Oran et du Maroc qui
formaient la droite de la lre Armée britannique (Lieutenant-
général K.-N. Anderson) n'ont pas peu contribué àl'éviction
totale de l'Axe, du sol africain, laquelle formait le prélude
nécessaire àla libération de l'Europe. Et l'on n'oubliera pas
la participation àla même campagne de la colonne Leclerc,
de la lre D.F.L., des Tabors marocains et du détachement
1Commandant L. Audoin-Dubreuil :La Guerre en Tunisie. —Payot.
Paris, 1945.

LA PENSÉE MILITAIRE FRANÇAISE 83
saharien du général Delay. Il yaurait là matière àun volume
riche d'enseignements et d'exemples.
Depuis le début de l'année 1946, on nous promet un histo¬
rique officiel de la lre Armée française qui conduirait les
vaillantes divisions du général de Lattre de Tassigny, depuis
leur débarquement àSaint-Tropez jusqu'à la capitulation
inconditionnelle de l'Allemagne, qui trouva le 1er C.A. du géné¬
ral Bethouart, au sommet de l'Arlberg. On ignore les raisons qui
jusqu'ici ont retardé cette publication qui promettait d'être
magistrale, et l'on aquelque peine àse les expliquer, car,
outre les archives de la lre Armée et celles des grandes unités
subordonnées, les Français disposent encore des papiers et
des témoignages de l'adversaire. Pareille réalisation nous
intéresserait non seulement en raison des remarquables manœu¬
vres stratégiques qu'elle nous retracerait, mais en raison
aussi du cadre géographique dans lequel elles se sont déroulées,
le long de nos frontières d'Ajoie, d'Argovie, de Schaffhouse et
de Saint-Gall. Là encore exprimons le vœu que cette lacune
soit bientôt comblée. Souhaitons aussi qu'elle le soit par une
œuvre digne des hommes et des chefs qui ont accompli
presque sous nos yeux une incomparable série d'exploits,
caractérisés les uns et les autres par une implacable opiniâtreté
et par un sens approfondi de la manœuvre.
On comprend mieux les raisons qui nous ont privés jus¬
qu'ici d'une étude systématique et critique qui serait consacrée
àl'œuvre, àl'organisation et aux combats de la Résistance.
Tout d'abord, il s'agit en l'espèce de mille actions de détail
entre lesquelles il est difficile de dérouler le fil d'Ariane.
D'autre part, en cette saison passionnée, le sujet serait difficile
àtraiter de manière parfaitement objective, et le ferait-on
qu'on risquerait de se voir soumis àun véritable feu croisé
de critiques et même d'injures ;nous n'exagérons rien, preuve
en soit les polémiques qui se perpétuent sans s'apaiser,
sur la délivrance de Paris et sur le drame du Vercors. Enfin
les nécessités de cette lutte sans merci excluaient la possibilité

84 REVUE MILITAIRE SUISSE
de tenir et d'entretenir des archives régulièrement alimentées
et méthodiquement classées. Beaucoup de vrais résistants
sont tombés face àl'ennemi, ce qui adonné àd'aucuns toute
licence pour grossir leur rôle et gonfler leur personnage :
«J'étais là, telle chose m'advint. »
Aussi bien devons-nous une singulière obligation aux au¬
teurs qui n'ont pas cédé àla double tentation de la gloriole
et de l'idéologie, mais qui, tout bonnement et tout simplement,
nous ont apporté sur ce sujet controversé des expériences
vécues et dominées par la raison. Tel est le cas de M. Pierre
de Préval3 qui commanda le maquis de Meurthe-et-Moselle,
et dont l'ouvrage constitue véritablement la bible du sabotage,
non, certes, d'un sabotage romantique, trop voisin de l'enfan¬
tillage et de la pyromanie, mais d'une action de destruction
savamment concertée de manière àparalyser l'envahisseur,
tout en ménageant l'infrastructure industrielle de la nation.
S'il était nécessaire d'envisager le pire et de préparer non
seulement nos cadres militaires, mais encore nos administra¬
tions àla guérilla, on ne saurait mieux faire que de lire et
faire lire ce volume de haute volée, où le courage n'échauffe
pas ia tête.
Nul de nos lecteurs n'ignore, sur le sujet de la résistance
et de la guerre des renseignements, l'œuvre admirable de
Rémy 2;du roman policier, conçu sous sa forme la plus haute,
elle tient la passion et le mouvement dramatique, mais, en
dépit de toutes les tentations, ce moderne Edgar Poe, que l'on
rangera aux côtés du génial Lawrence, ne décolle jamais de
la réalité, et ceci nous prouverait que dans cette forme d'hosti¬
lités, l'imagination joue un rôle au moins aussi grand que la
1Pierre de Préval :Sabotages et Guérilla. —Berger-Levrault, Paris. 1945.
:Rémy :Mémoires d'un Agent français de la France libre. -Aux Trois
Couleurs ;R. Solar, Paris, 1946, 2vol.
—Le Livre du Courage et de la Peur. —id., 1947, 2vol.
—Une Affaire de. Trahison. -id., 1947, 1vol.
Comment meurt un réseau. —id., 1948, 1vol.
-Les Mains jointes. —id., 1948, 1vol.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%