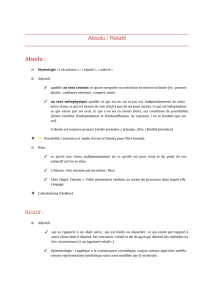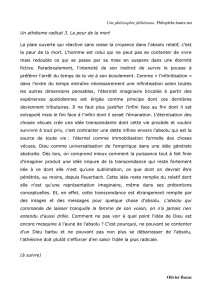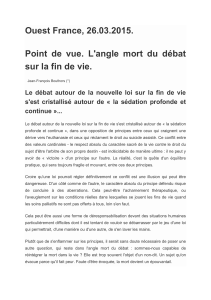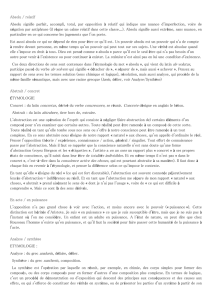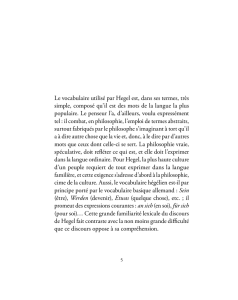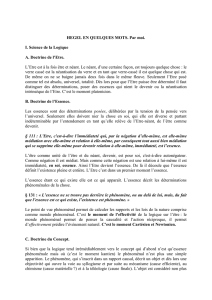L`oeuvre d`art peut-elle manifester un absolu?

L’oeuvre d’art peut-elle manifester un absolu?
Plan
INTRODUCTION
I- PLATON : L'OEUVRE D'ART, COPIE DU SENSIBLE, EST ELOIGNEE AU PLUS HAUT POINT DE
L'ABSOLU.
1) L'œuvre d'art est imitation de la nature sensible
2) Les deux sortes d'imitation.
3) Art et illusion ou l'art condamné par la philosophie
II -HEGEL : L'ABSOLU NE S'OPPOSANT PAS AUX APPARENCES SENSIBLES, L'OEUVRE D'ART
PEUT EN DROIT MANIFESTER UN ABSOLU, OU MêME L'ABSOLU.
A- Aristote : l'art n'imite pas à proprement parler la nature, mais rivalise avec elle.
B- La revalorisation de l'apparaître chez Hegel.
1) L'art a son apparence propre.
2) L'absolu a pour essence de se manifester.
3) L'absolu (l'esprit, l'Idée) est donc accessible par des moyens sensibles
4) L'œuvre d'art ne se réduit pas à son matériau sensible
III- SEULE L'OEUVRE D'ART PERMET D'ATTEINDRE L'ABSOLU
1) La conception romantique de l'art (18e) : l'art permet de montrer ce qui est indicible, non conceptualisable,
ou non connaissable
2) Kant, Critique de la faculté de juger, § 49 et 57 : les Idées esthétiques ou l'alliance gratuite entre
imagination et entendement
3) L'art fait donc mieux que la philosophie
4) Heidegger, L'origine de l'œuvre d'art : l'art et la vérité
IV- TOUTE œUVRE D'ART MANIFESTE-T-ELLE UN ABSOLU?
1) L'art contemporain est-il de l'art?
2) L'art est-il fini?
3) L'art abstrait comme langage de l'âme.
4) Que faire des ready-made?
CONCLUSION

Introduction
L’oeuvre d’art, produit du génie créateur de l’homme, a souvent prétendu être un moyen d’atteindre un absolu,
qui est de l’ordre du suprasensible, et des valeurs humaines les plus hautes. Ainsi, quand nous nous servons du
terme "oeuvre d’art", nous nous en servons avant tout, non comme d’un terme descriptif et neutre, mais comme
d’un terme connotant une valeur. Les oeuvres d’art sont censées, dans notre inconscient collectif, exprimer ce
qui est de l’ordre de l’absolu, nous faire avoir accès à ce qui est "transcendant". Elles sont considérées comme
des objets à part, et nous mettons à leur sauvegarde un intérêt important (notre ère est bien l’ère "muséale").
Pourtant, l’oeuvre d’art est-elle capable d’atteindre un absolu? Comment est-ce possible, si l’absolu est par
essence ce qui ne dépend d’aucune condition, et d’autant plus, d’aucune condition sensible? Platon n’a-t-il pas
dénoncé l’assujettissement de l’art au domaine du sensible, et par-là, n’a-t-il pas montré que l’art est incapable
de manifester un absolu? Mais la thèse de Platon présuppose que l’absolu ne se manifeste pas : il nous faut donc
ici réfléchir sur les conditions de possibilité d’une révélation sensible de l’absolu. Peut-être faudra-t-il dépasser
le dualisme manifestation sensible/ absolu, afin de pouvoir soutenir que l’oeuvre d’art peut manifester un absolu.
L’oeuvre d’art est-elle seulement "quelque chose de sensible"? Ne peut-elle rien nous montrer au-delà, nous
révéler une présence irréductible au sensible comme tel?
I- Platon : l'œuvre d'art, copie du sensible, est éloignée au plus haut point de l'absolu.
Pour Platon, l’oeuvre d’art n’a pas les moyens de manifester un absolu, étant donné qu’elle est assujettie au
sensible. L'absolu se situant par définition au-delà du monde sensible, le moyen par essence le plus inadéquat
pour atteindre l’absolu est la manifestation sensible -donc l'art!
1) L'œuvre d'art est imitation de la nature sensible.
Platon prend pour accordé que l’oeuvre d’art est imitation de la nature. Elle consiste à recopier les phénomènes
sensibles.
2) Les deux sortes d'imitation.
Dans Le Sophiste, 235 b-263c, il distingue deux espèces d’imitation :
Objet du texte : définir quelle est la spécificité de la technique de production des images. Ayant défini plus haut
l'image comme imitation, copie, de quelque chose, il distingue ici deux espèces d'imitation :
L'Etranger : je vois en elles, d'une part, une technique qui consiste à faire des copies. Celle-ci est surtout évidente
lorsque quelqu'un, tenant compte des proportions du modèle en longueur, largeur et profondeur, produit une
imitation qui respecte, en outre, les couleurs appropriées de chaque chose.
Théétète : Et alors? Tous les imitateurs n'essaient-ils pas d'agir ainsi?
L'Etranger : Ce n'est pas le cas de ceux qui produisent ou qui dessinent des œuvres monumentales. Car s'ils
reproduiaient les proportions réelles des choses belles, tu sais bien que les parties supérieures paraîtraient trop
petites, et les inférieures trop grandes, puisque nous voyons les unes de loin et les autres de près.
Théétète : Oui, absolument.
L'Etranger : ces artistes ne laissent-ils pas de côté la vérité, en produisant dans les images, au détriment des
proportions réelles, celles qui paraîtront être belles? (…) N'est-il pas juste alors d'appeler "copie" le premier type
d'imitation, car, en réalité, il "copie"? (…) Et la partie de l'imitation qui est en rapport avec elle, ne doit-elle pas
être nommée, comme nous l'avons déjà dit, "technique de production des copies"? (…) Et alors? Ce qui a
l'apparence de ressembler à ce qui est beau, tout simpelment parce qu'il est contemplé selon une mauvaise
perspective, mais qui, s'il était regardé par quelqu'un ayant la capacité de le voir nettement, perdrait cette
apparence, cette image, comment doit-elle être appelée? Si elle a l'apparence d'une copie, sans y être semblable,
n'est-elle pas une illusion? (…) Or, cette illusion constitue une partie considérable non deulement de la peinture,
mais aussi de l'imitation en général. (…) Ne serait-ce donc pas tout à fait juste de qualifier d'"illusionniste cette

technique, qui produit non pas des copies, mais des illusions? (…) Voilà donc les deux formes de la technique de
production d'images dont je parlais : celle de la copie, et celle de l'illusion.
Platon, Le Sophiste, 235 b-263 c, Ed. GF, Trad.N.Cordero, 1993
Il y a d’abord l’imitation-copie, qui consiste à recopier fidèlement la chose, mais sans avoir pour ambition de la
remplacer (c’est une relation de ressemblance, non d’identité) ; et ensuite, il y a une imitation appelée
"eikastique", qui cherche à remplacer la chose même. Pour ce faire, il faut étudier les lois de la perception
sensible, de manière à "pouvoir faire illusion". L’oeuvre d’art ne peut remplacer l’objet ou rivaliser avec lui,
qu’en faisant illusion. L’oeuvre d’art appartient donc pour Platon au domaine de l’image, du sensible. Or, tout ce
qui est de l’ordre de l’image est pour Platon, de l’ordre du moindre être. Ce qui seul est réel, c’est l’Idée, absolu
supra-sensible ne dépendant en aucune manière de conditions et des lois qui gouvernent le monde sensible. Non
seulement l’oeuvre d’art est une image, donc, quelque chose de sensible, mais en plus, elle est littéralement
assujettie au sensible, elle trompe et illusionne.
3) Art et illusion ou l'art condamné par la philosophie
L’oeuvre d’art privilégie le sensible comme moyen d’expression, et est donc condamnée par Platon, au nom de
la philosophie. En effet, l’art en vient à faire croire que l’absolu ou l’Idée est dans le sensible, or, la leçon du
Livre VI de La République (cf. la célèbre allégorie de la caverne) est bien de nous faire voir que l’absolu est tout
autre que le sensible, et inatteignable par les moyens sensibles. Ce n’est pas en étudiant les apparences et les
moyens de redoubler celles-ci que l’on pourra atteindre l’absolu, ni même le manifester. Les formes artistiques
sont rigoureusement coupées de l’eidos, Idée ou Forme intelligible, qui se trouve dans un monde suprasensible.
C’est le philosophe qui, se détournant du sensible, à l’aide de sa raison, atteint l’absolu. L’absolu ne se manifeste
pas dans le sensible, il n’apparaît pas par essence : le domaine de l’apparaître est trompeur et non seulement ne
nous révèle pas l’absolu, mais encore, ne nous apprend pas à le chercher là où il se trouve. Ce que Platon appelle
le principe "anhypothétique", ce qui est sans conditions, est atteint au terme d’un long parcours, par une sorte
d’intuition intellectuelle, qui est une sorte d’éblouissement, mais en aucun cas une révélation sensible. L’absolu,
l’Idée de Bien, est bien comparable à la luminosité du soleil, mais c’est à l’oeil de l’esprit ou de la raison qu’elle
apparaît, pas à l’oeil du corps...
Comme il le montre dans le Livre X de La République, 597a, l’oeuvre d’art est éloignée de trois degrés de la
vérité -nous pouvons ici remplacer "vérité" par "absolu", puisque pour Platon, avons-nous dit, ce qui est absolu,
c’est ce qui est le plus réel.
"Ainsi, il y a trois sortes de lits ; l'une qui existe dans la nature des choses, et dont nous pouvons dire, je pense,
que Dieu est l'auteur ; -autrement qui serait-ce ? (…) Une seconde est celle du menuisier. Et une trosième, celle
du peintre (…). Ainsi, peintre, menuisier, Dieu, ils sont trois qui président à la façon de ces trois espèces de lits.
(…) Et Dieu (…) a fait celui-là seul qui est réellement le lit ; mais deux lits de ce genre, ou plusieurs, Dieu ne les
a jamais produits et ne les produira jamais. (…) le peintre est imitateur de ce dont les deux autres sont les
ouvriers (pire encore, il recopie ce qui déjà n'est qu'apprence) l'imitation est donc loin du vrai"
Platon, La République, 597 a-sq
Ainsi, quelle différence y a-t-il entre le lit représenté par l’artiste, le lit empirique qui sert à dormir et qui est
fabriqué par l’artisan, et l’Idée de lit? Le lit de l’artiste ne fait que copier quelque chose qui déjà, est dépourvu de
réalité, au lieu de copier directement l’Idée. Le lit fabriqué par l’artisan, quant à lui, a au moins l’avantage de
"refléter" ou de manifester le lit vraiment existant, l’Idée de lit. L’artiste est un ignorant, il ne sait pas comment
est le vrai modèle. Comment le pourrait-il, puisque l’étude du sensible le détourne de tout accès possible à
l’absolu?
Ainsi, il semble que l’oeuvre d’art soit par essence incapable de pouvoir manifester un absolu. Si le monde des
phénomènes ou monde sensible est manque d’être, pure "apparence", alors, si l’oeuvre d’art est un moyen
sensible de copier le sensible, elle ne peut pas manifester quelque chose d’absolu, puisque par essence c’est ce
qui est au-delà du sensible et s’oppose rigoureusement à toute forme d’apparaître. Le paraître ou le se manifester
ne nous fait pas atteindre l’être empirique, et encore moins l’être "en soi". La figuration sensible ne pouvant
rivaliser sérieusement avec la vision intellectuelle, l’art semble bien être définitivement condamné à n’être que
pure apparence...

II -Hegel : l'absolu ne s'opposant pas aux apparences sensibles, l'œuvre d'art peut en droit manifester un absolu,
ou même l'absolu.
Mais l’apparence de l’art est-elle si trompeuse, si incapable de rien manifester d’autre que l’apparence sensible?
Et est-il vraiment impossible, et contraire à l’absolu, de se manifester?
Peut-être que la dévalorisation platonicienne de l’art part de présupposés faux ; elle aura eu l’avantage de nous
permettre de voir les conditions de possibilité que nous avons à mettre au jour pour pouvoir dire que l’oeuvre
d’art peut manifester un absolu. Il s’agit en effet de se demander si l’oeuvre d’art est, même si ses moyens
d’expression sont évidemment sensibles, si assujettie que ça au domaine du sensible, et si l’absolu est de son
côté si radicalement coupé du domaine de l’apparaître.
A- Aristote : l'art n'imite pas à proprement parler la nature, mais rivalise avec elle.
D’abord, il faut préciser que l’art n’est pas une pure copie de la nature, et encore moins des apparences. Il semble
que la réponse aristotélicienne à la thèse de Platon selon laquelle l’art se bornerait à imiter la nature, permet déjà
à l’art de pouvoir prétendre à atteindre à quelque chose au-delà du sensible. En effet, nous dit Aristote dans la
Physique, l’art ne prétend pas imiter rigoureusement la nature, mais rivaliser avec elle. Ce qui le mène à dire,
comme on peut le voir dans les livres 4 et 9 de la Poétique, que non seulement l’art (en l’occurence, la poésie)
est philosophique, car, contrairement à l’histoire, il a l’avantage d’être rationnel et général, mais en plus, il nous
permet d’avoir accès à ce que nous cache la nature et l’observation naturelle ou empirique des phénomènes.
L’art nous découvre des choses que nous ne savions pas voir dans la nature, il nous découvre des choses
"cachées". Ici, se révèle la possibilité que l’oeuvre d’art puisse manifester un absolu -du moins déjà peut-elle
nous faire avoir accès à ce qui ne se montre spontanément pas dans le réel. Platon ne voit pas que l’oeuvre d’art
est autre chose qu’une (pâle) imitation de la nature, et qu’elle peut en fait renvoyer à autre chose que le domaine
sensible.
B- La revalorisation de l'apparaître chez Hegel.
C’est ce qui a été définitivement vu par Hegel dans L’introduction à l’esthétique ; chez lui, il est tout à fait
possible à l’oeuvre d’art de manifester un absolu. En effet, d’abord, Hegel nous montre que l’art a son apparence
propre, et que l’argument tiré du fait que l’art appartient au domaine des apparences ne tient pas pour critiquer sa
prétention à manifester un absolu ; et ensuite, il nous dit bien que l’absolu doit nécessairement se manifester.
L’apparence, le domaine du sensible, l’apparaître, bref, tout ce qui chez Platon était inessentiel à l’absolu et par-
là inadéquat pour en rendre compte ou y avoir accès, est ici revalorisé.
1) L'art a son apparence propre.
Ainsi Hegel nous dit que l’art a une apparence qui lui est propre, et non "une apparence tout court". Que veut-il
dire par-là? Pour bien le comprendre, il faut préciser que Hegel estime bien que les apparences immédiates, ou la
nature, sont en quelque sorte un manque d’être, une illusion. Mais justement, l’apparence de l’art, le sensible
qu’il manifeste dans ses oeuvres, sont par rapport à ces "apparences tout court", élaborées par le travail de
l’esprit ; le sensible que manifeste l’art est intellectualisé, spiritualisé. Comme il le dit bien, "loin d’être, par
rapport à la réalité courante, de simples apparences ou illusion, les manifestations de l’art possèdent une réalité
plus haute et une existence plus vraie". Le matériau sur lequel s’exerce l’art est certes, le sensible, mais un
sensible spiritualisé.
2) L'absolu a pour essence de se manifester.
Il dit aussi, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, que l’absolu a pour essence de se manifester : "toute essence,
toute vérité, pour ne pas rester abstraction pure, doit apparaître. (...) l’apparence constitue un moment de
l’essence". A partir de Hegel, on ne peut plus sérieusement penser que l’essentiel soit radicalement coupé de ce
qui apparaît. En effet, on sait que ce qui seul est réel, c’est ce qui est concret ; comme il le dit dans la célèbre
préface des Principes de la philosophie du droit, "ce qui est rationnel est réel, et ce qui est réel est rationnel".
L’absolu n’est pas pour Hegel quelque chose qui existerait dans un monde "intelligible" ; c’est-à-dire, qu’il n’est
pas abstrait ; s’il doit exister, il faut qu’il se fasse exister, et il devra donc se manifester.

L’absolu, l’Idée hégélienne, qui n’est autre que l’Esprit du monde se réalisant à travers l’histoire des hommes,
n’est donc plus vraiment ce qui serait par essence inaccessible à l’art.
3) L'absolu (l'esprit, l'Idée) est donc accessible par des moyens sensibles
Au contraire, Hegel estime même que l’oeuvre d’art est un des moyens privilégiés de manifester l’absolu. Certes,
les produits de l’art ont toujours une apparence sensible et naturelle, mais ils ont, avons-nous vu, un contenu
éminemment spirituel. L’art nous révèle véritablement l’esprit, le spirituel. Dans le sensible de l’art, se révèle la
présence même de l’esprit. Comme il le dit : "dans son apparence même, l’art nous fait entrevoir quelque chose
qui dépasse l’apparence : la pensée". L’art, comme la religion et la philosophie, est "un mode d’expression du
divin, des besoins et des exigences les plus élevées de l’esprit" et "les peuples ont déposé dans l’art leurs idées
les plus hautes". L’art possède le pouvoir de donner de ces idées élevées une représentation sensible qui nous les
rend accessibles.
4) L'œuvre d'art ne se réduit pas à son matériau sensible
L’oeuvre d’art dépasse toujours ce qu’elle nous montre, elle ne se réduit pas à son matériau et ses moyens
d’expression sensible ; son contenu est spirituel. Dans l’oeuvre d’art , on doit oublier le particulier pendant que
nous sommes en train de l’examiner ;
"La signification de l’oeuvre se rapporte à quelque chose qui dépasse l’apparence directe (...) ; l’oeuvre d’art ne
s’épuise pas toute entière dans les lignes, les courbes, les surfaces, les creux et les entailles de la pierre, etc., mais
constitue l’extériorisation de la vie, des sentiments, de l’âme, d’un contenu de l’esprit".
Il nous parle magnifiquement de l’art grec, qui parvient à nous représenter l’absolu d’une manière tout à fait
adéquate ; dans l’art grec, nous dit Hegel, où le dieu est représenté par la figure humaine, il y a une union totale
entre le sensible et le spirituel : l’art grec a su incarner l’absolu qu’est Dieu. La forme de l’art est donc ici tout à
fait adéquate à représenter, manifester, son contenu, qui est un absolu. De même encore Hegel analyse la
peinture hollandaise en nous montrant le pouvoir qu’ont ces oeuvres de révéler, manifester, un absolu, que ce
soit l’esprit de ce peuple particulier, ou la présence même du spirituel en général.
Il semble donc que, contre Platon, l’oeuvre d’art soit à même de manifester un absolu ; en elle, on trouve une
présence de l’esprit, elle nous permet même de prendre conscience de ses intérêts les plus élevés. C’est que
l’oeuvre d’art ne se réduit pas à son matériau sensible, comme le verra à sa façon Sartre, dans les célèbres
analyses du portrait de Charles VII que l’on trouve dans l’essai sur L’imaginaire : l’oeuvre d’art est, nous dit-il,
un irréel ; sa présence sensible est juste un "analogon", un moyen sensible de nous rendre présent, de manifester
dans le réel ce qui n’appartient pas à ce monde mais est éternel et indépendant des conditions spatio-temporelles
du monde sensible.
III- Seule l'oeuvre d'art permet d'atteindre l'absolu
Non seulement l’oeuvre d’art est tout à fait capable de manifester un absolu, mais encore, il semble bien que,
contre Platon, elle soit seule capable de le faire : elle nous paraît être le moyen privilégié d’atteindre l’absolu. En
effet, nous venons de voir que l’oeuvre d’art dépasse, par ses moyens artistiques, l’apparence, le sensible. Elle
manifeste la présence de quelque chose d’absolu, d’indépendant de toute condition sensible, par des moyens
pourtant sensibles. On doit donc nécessairement en arriver à inverser le rapport instauré par Platon entre la
philosophie et l’art et dire que ce n’est pas la raison, ou la philosophie, qui peut atteindre l’absolu. Seul l’art est
apte à le faire, car il "manifeste", plutôt que d’essayer de dire ce qui par définition ne se dit pas.
1) La conception romantique de l'art (18e) : l'art permet de montrer ce qui est indicible, non conceptualisable, ou
non connaissable
Si paradoxal que cela puisse paraître, l’oeuvre d’art permet de dépasser les limitations spatio-temporelles. C’est
en tout cas ce que les Romantiques ont soutenu. Pour bien comprendre leur thèse, il nous faut ici nous arrêter un
petit moment sur la philosophie kantienne de la connaissance, qui a ouvert la voie au remplacement de la
philosophie par l’art, à la thèse selon laquelle le contenu même de la philosophie, qui est un absolu, est révélé par
l’art. En effet, Kant a montré, dans sa Critique de la raison pure, que les concepts étant seulement valables à
l’intérieur de l’expérience, qu’ils sont assujettis aux conditions et aux limitations de celle-ci : ainsi, si on peut
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%