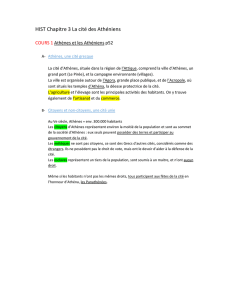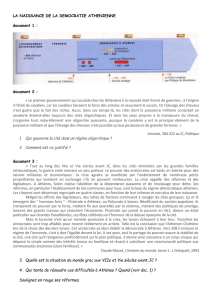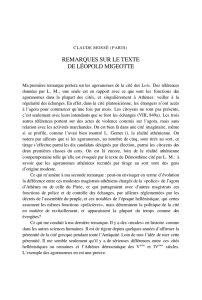Les débuts


Du même auteur
La Fin de la démocratie athénienne
PUF, 1962
Le Travail en Grèce et à Rome
PUF, 1966
Les Institutions politiques grecques
Armand Colin, 1968
Rééd.
Les Institutions grecques à l’époque classique
Armand Colin, 2008
La Tyrannie dans la Grèce antique
PUF, 1969
La Colonisation dans l’Antiquité
Fernand Nathan, 1970
Le Monde Grec et l’Orient, t. II :
Le IVe siècle et l’époque hellénistique
(en collaboration avec E. Will et P. Goukowsky)
PUF, 1975
La Femme dans la Grèce antique
Albin Michel, 1983
La Grèce archaïque d’Homère à Eschyle
Seuil, 1984
La Démocratie grecque
(Le Monde de…)
M. A. éditions, 1986

Le Procès de Socrate
Complexe, 1987
L’Antiquité dans la Révolution française
Albin Michel, 1989
Précis d’histoire grecque
(en collaboration avec A. Schnapp-Gourbeillon)
Armand Colin, 1991 ; 2009
Le Citoyen dans la Grèce antique
Nathan, 1993
Démosthène ou les ambiguïtés de la politique
Armand Colin, 1994
Politique et société en Grèce ancienne
Le modèle athénien
Aubier, 1995
Guerres et sociétés dans les mondes grecs
De 490 à 322 av. J.-C.
Vuibert, 1999
Alexandre, la destinée d’un mythe
Payot & Rivages, 2001
Les Grecs inventent la politique
Complexe, 2005
Périclès, l’inventeur de la démocratie
Payot & Rivages, 2005
Une histoire du monde antique
(direction)
Larousse, 2005
D’Homère à Plutarque, itinéraires historiques

Recueil d’articles de Claude Mossé
Ausonius, 2007
Sacrilèges et Trahisons à Athènes
Larousse, « L’Histoire comme un roman », 2009
Au nom de la loi
Justice et politique à Athènes à l’âge classique
Payot, 2010
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%