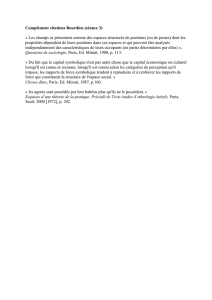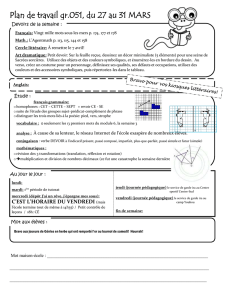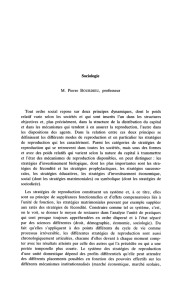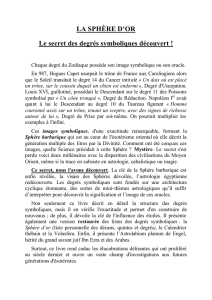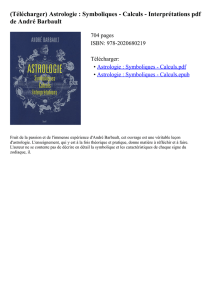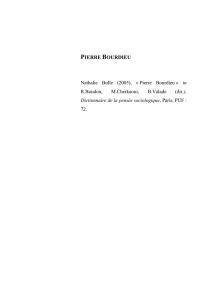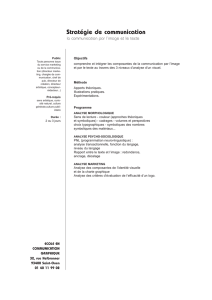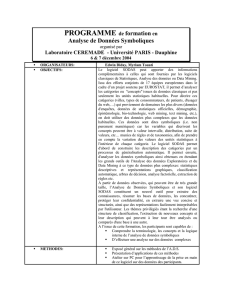Mangez FR - KNOWandPOL

Discussion complémentaire :
Structures symboliques
et structures sociales
Eric Mangez
Revue de la littérature
(partie 3)
Revue de la
littérature
Juin 2007

Discussion complémentaire Mangez
Discussion complémentaire
Structures symboliques (connaissances, croyances,
représentations), structures sociales (structures de positions
et relation de pouvoir)
L’activité de production symbolique consiste principalement en une activité
d’énonciation : il s’agit de désigner, de nommer et de mettre en relation des éléments
(acteurs, actions, objectifs, moyens, objets, valeurs, etc.) dans une forme de récit. De
cette manière, les productions symboliques visent à dire le sens de la réalité. Elles
constituent des entreprises de construction de la réalité (Bourdieu, 1977). Il existe ainsi
des récits pédagogiques, des récits économiques, des récits politiques, etc. Tous ces
récits sont des manières de raconter le monde : ils disent comment le monde
(pédagogique, économique, …) fonctionne (volet cognitif) et devrait fonctionner (volet
normatif).
On comprend aussi, à partir des propositions énoncées ci-dessus, que les productions
symboliques ont toujours une structure, qu’il est possible de dégager au moyen d’une
analyse interne. Lorsqu’on l’applique à un récit, l’analyse interne consiste à dégager
l’ensemble des relations que le récit établit entre les éléments qui le constituent. On
identifie des relations entre les éléments du texte (tel élément « est plus important que »
tel autre élément, tel élément « est au service de » telle finalité, tel événement « est
préalable à » tel autre événement, tel acteur « dispose de » telle ou telle caractéristique
et qualité, telle action « est » légitime, illégitime, etc.). Il s’agit de la structure
symbolique du texte ou du récit. Le principe sur lequel s’appuient les tenants de l’analyse
externe, dans sa formulation la plus radicale (notamment Bourdieu, 1977, 1989), est un
principe d’homologie méconnaissable entre les structures symboliques (qui ordonnent le
monde social en le classant et en le catégorisant sur le plan du sens et des significations)
et les structures sociales (qui ordonnent le monde social selon les ressources, positions
et trajectoires des individus et des groupes). Rapportée à ses conditions sociales de
production et aux caractéristiques sociologiques de ses producteurs (notamment et
principalement à leur position relative et à leur trajectoire), la production symbolique est
construite comme un exercice du pouvoir : le récit est alors considéré comme une
idéologie, au sens où il sert les intérêts de celui qui le produit.
Dans les termes de Bourdieu, si les structures symboliques sont en lien avec les
structures sociales (ou plus généralement les structures de positions), c’est parce que,
dans leurs prises de positions sur le plan symbolique, les personnes et les groupes
poursuivent, éventuellement de manière non consciente, des intérêts liés à leur position
(dans le champ et dans la structure sociale), intérêts qui peuvent consister à préserver,
ou à transformer la position occupée et les ressources qui y sont liées. L’enjeu ultime des
luttes symboliques est la reconduction ou la transformation des structures sociales et/ou
des structures du champ. Le principe selon lequel il existe des relations entre les

Discussion complémentaire Mangez
2
convictions qui prévalent dans le monde social à un moment donné de l’histoire à propos
de telle ou telle question, et « l’état de la société au moment considéré », avait été
formulé par Durkheim dès la partie introductive de l’Evolution pédagogique en France
(Durkheim, 1969, p.16).
Le pouvoir symbolique consiste à établir et à faire reconnaître comme légitime une
construction spécifique de la réalité et, corollairement, à rendre illégitimes - ou mieux :
impensables - d’autres constructions possibles de la réalité. Les acteurs et les
organisations, dans un champ donné, sont en lutte pour la définition des structures
symboliques légitimes du champ. Si la définition des productions symboliques légitimes
fait l’objet de luttes, c’est parce qu’il ne s’agit pas de récits qui seraient sans
conséquence sur la vie des personnes, sur leurs positions, sur leurs ressources, sur leurs
trajectoires. Ces récits définissent, plus ou moins implicitement, une série de principes de
classement des choses et des personnes. Ils préfigurent un certain ordre du monde, ils
prédéfinissent des distinctions entre des tâches, des métiers, des statuts. Ils sont en
quelque sorte implicitement porteurs d’une structure sociale. En effet, en construisant un
accord sur le sens à donner au monde, même si cet accord ne parle pas directement des
rôles, des ressources et des positions des acteurs, les structures symboliques légitimes
prédéfinissent aussi la manière dont le monde doit être organisé ; la manière dont les
rôles doivent être pensés et distingués ; les ressources, allouées ; les mérites, reconnus.
En ce sens, les structures symboliques légitimes préfigurent les structures sociales à
venir.
Dans la lutte pour la définition des structures symboliques légitimes, les individus et les
groupes disposent de moyens inégaux liés à leur position. Si l’on peut observer des
désaccords entre des personnes ou des groupes qui occupent des positions similaires
dans les relations de pouvoir, il n’en reste pas moins que souvent les désaccords sur le
plan symbolique – c’est-à-dire les désaccords au niveau des prises de positions – sont
liés aux positions différentes qu’occupent les personnes et les groupes dans les relations
de pouvoir, c’est-à-dire dans la structure des positions (positions différentes dans une
structure sociale, positions différentes dans une structure organisationnelle à l’intérieur
d’un champ).
En ce qu’elles visent à établir une vision du monde partagée qui permet de se
comprendre, de se parler et éventuellement de s’accorder sur des mesures à prendre, les
structures symboliques sont également des instruments de connaissance qui remplissent
une fonction politique d’intégration. Le rôle du symbolique est politique dans la mesure
où, dans les sociétés où le sens n’est pas directement donné, il doit être construit, donc
pensé et négocié : les structures symboliques légitimes servent à construire un accord
entre les personnes, accord nécessaire à la coordination de leurs actions, c’est-à-dire à
leur intégration (quand bien même des personnes ou des groupes peuvent être en

Discussion complémentaire Mangez
3
désaccord sans le savoir, ou s’accorder autour d’une même structure symbolique pour
des raisons fondamentalement différentes). Cette fonction d’intégration est d’autant plus
importante que progresse la division du travail. Dans les communautés où la division du
travail est très faible, les structures symboliques sont immédiates, elles ne doivent pas
êtres construites, pensées, négociées. Elles ne nécessitent pas l’engagement réflexif et
stratégique des acteurs.
L’analyse cognitive des politiques publiques : construction de
la réalité, matrices, pouvoir
Les principes centraux de l’approche classique des rapports entre le social et le
symbolique, que nous venons de présenter brièvement peuvent être mis en relation avec
l’analyse cognitive des politiques publiques. Le courant de l’analyse cognitive des
politiques publiques, tout en étant compatible avec la plupart des principes définis par
Bourdieu, permet de dépasser certaines de ses limites, notamment celles liées à la
représentation homogène de l’Etat et à la difficulté de penser des compromis qui soient
autre chose que des ruses des dominants (même les compromis concédés par les acteurs
dominants y sont le plus souvent, au bout du compte, pensés comme les ruses ultimes
de la raison dominante.
Avant de montrer en quoi les apports de ce courant peuvent infléchir les propositions de
la sociologie classique, il nous faut souligner que certains des principes centraux
de ce courant sont en réalité très conformes aux propositions de Bourdieu. Les
principales distinctions établies jusqu’ici sur la base d’une lecture de l’œuvre de Bourdieu,
se retrouvent en effet, en des termes parfois différents, dans le courant de l’approche
cognitive des politiques publiques.
Ainsi, le principe de base de ce courant définit les politiques publiques comme des
entreprises de « construction de la réalité » (Muller et Surel, 1998, p.30). Ce courant se
démarque ainsi des approches plus traditionnelles des politiques publiques en terme de
« problem solving » (Rose, 1991). Toujours pour signifier ce même principe de base, en
d’autres endroits, les représentants de ce courant parlent des politiques publiques
comme processus qui construisent des « cadres d’intelligibilité » (March et Olsen, 1989),
des « visions du monde » (Surel, 1997 ; Muller et Surel, 1998), des « cartes mentales »
(North, 1990), des « interprétations du monde », des « matrices cognitives et
normatives » (Muller et Surel, 1998), des « systèmes d’interprétation du réel », des
« paradigmes » (Hall, 1993), des « système de croyances » (Sabatier et Schlager, 2000),
des « référentiels » (Jobert et Muller, 1987), etc. Ces « constructions de la réalité »
définissent « le champ des possibles et du dicible » (Muller et Surel, 1998, p.48).
Si l’on met entre parenthèses les querelles très secondaires des auteurs entre eux

Discussion complémentaire Mangez
4
concernant l’opportunité d’utiliser plutôt l’une ou l’autre de ces différentes appellations,
on peut dans l’ensemble considérer que pour ce courant d’analyse cognitive des
politiques publiques, celles-ci doivent être étudiées et comprises en tant qu’elles
constituent des structures symboliques à propos de tel ou tel secteur (ou champ) de
l’action publique : « Faire une politique, ce n’est dont donc pas ‘résoudre’ un problème,
mais construire une nouvelle représentation des problèmes qui met en place les
conditions socio-politiques de leur traitement par la société, et structure par là même
l’action de l’Etat » (Muller et Surel, 1998, p.31). Dans les termes de Freeman:
« problems are what we agree them to be (de mémoire) ». « Comme l’ont souligné de
nombreux auteurs (notamment, en France, Y. Mény, J.-C. Thoenig, E. Monnier), chaque
politique est porteuse à la fois d’une idée du problème (…), d’une représentation du
groupe social ou du secteur concerné qu’elle contribue à faire exister (…) et d’une théorie
du changement social. Ce référentiel est un espace de sens qui donne à voir le monde. »
(Muller, 1996, p. 101). Notons que ce faisant, le référentiel ou le paradigme qui guide la
politique publique cache aussi tous les autres mondes possibles.
Un second principe de base de ce courant affirme que « le processus de construction
d’une matrice cognitive et normative est (…) un processus de pouvoir » au cours duquel
les différents acteurs font valoir leurs intérêts propres : il y a ainsi des « conflits » autour
de la définition de la matrice légitime : « La production de discours concurrents sur un
même phénomène implique par là même une compétition sur la qualification du
problème » (Muller et Surel, 1998, p.51, p.61). Dans ces conflits, les différents acteurs
disposent de pouvoirs d’influence inégaux qui dépendent de « facteurs structurels liés à
leurs positions dans la division du travail » et de « leur capacité à se constituer en
acteurs collectifs ». La construction d’une politique publique s’apparente alors à un
processus de lutte et de négociation à propos de la manière légitime de construire et
d’interpréter la réalité concernée. Les chercheurs du courant d’analyse cognitive
s’attachent dès lors le plus souvent « à révéler et à déconstruire la manière dont les
acteurs élaborent des argumentations concurrentes, qui visent à définir un problème
dans un "langage" qui correspond à leurs valeurs, leurs croyances, leurs positions, leurs
intérêts, les caractères de leur organisation » (Muller et Surel, 1998, p.56).
Fort logiquement, à partir de ces deux premiers principes, les auteurs caractérisent le
processus de construction des politiques publiques, dans une formulation très
bourdieusienne, comme étant indissociablement « un processus de prise de parole
(production du sens) et un processus de prise de pouvoir (structuration d’un champ de
forces)» (Muller et Surel, 1998, p.52, surlignement original). Il y a ainsi une « relation
circulaire » entre « logiques de sens et logiques de pouvoir » (idem, pp.51-52), « une
interdépendance entre configuration d’acteurs et matrices paradigmatiques » (idem,
pp.86-87). Dans les termes de Bourdieu, on pourrait reformuler cette intrication en
disant qu’il existe des relations entre les structures sociales et les structures
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%