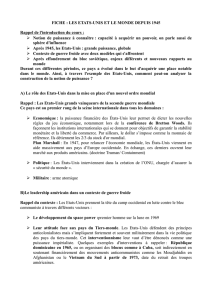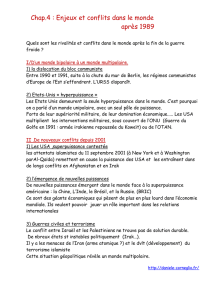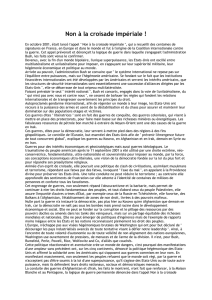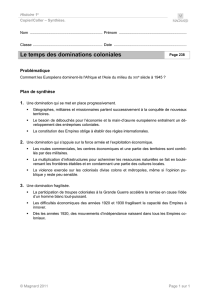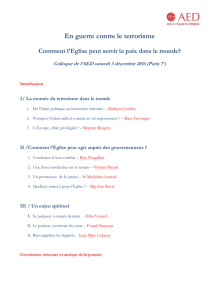3. olsson100308

1
3
___________________
Afghanistan et Irak : les origines coloniales des guerres antiterroristes
par Christian Olsson
Pour certains observateurs critiques de la « guerre globale contre la terreur » (Glo-
bal War on Terror, GWOT) décidée après les attentats du 11 septembre 2001 par
l’administration de George W. Bush, c’est une logique impériale inscrite dans la conti-
nuité d’une longue histoire guerrière qui se déploie dans les guerres engagées par les
États-Unis en Afghanistan à l’automne 2001 et en Irak en mars 2003
1
. Si cette vision
n’est pas sans fondement, il importe de se méfier des raccourcis et des simplifications
historiques : comme l’indiquait Alessandro Dal Lago au chapitre précédent, nous
n’assistons pas aujourd’hui au retour des empires d’antan ; et l’« empire global » — et
a fortiori l’« empire global américain » — n’existe pas davantage. Tout au plus y au-
rait-il des tentations impériales. Mais celles-ci viennent aujourd’hui inévitablement se
briser, telles des vagues, sur les sables de la modernité politique. Cette dernière tient
en effet l’empire en horreur, comme le montrent les réactions et les oppositions loca-
les, qu’elles soient ou non d’inspiration nationaliste, que suscitent bien souvent ces
tentations.
Pour autant, on ne peut saisir le fonctionnement et la logique de la GWOT à la seule
aune des impératifs du temps présent : comme on va le voir, la mise en perspective
historique est indispensable pour comprendre comment les modalités militaires de
l’antiterrorisme de l’actuelle administration Bush (et de ses alliés « occidentaux »)
s’inscrivent dans une histoire longue faite de continuités et de ruptures. Cette histoire
est notamment celle de l’emprunt mimétique, par les militaires « occidentaux », des
modalités d’action prêtées à un ennemi « asymétrique » dans le contexte des guerres
de décolonisation : on opposait alors la « guerre psychologique » à la « propagande par
l’action », la « terreur » ou la « contre-terreur » au « terrorisme », etc.
L’histoire, bien sûr, ne se répète jamais à l’identique. Mais le présent n’est jamais
un ordre émergeant spontanément du néant non plus. Il faut par conséquent voir les
continuités historiques malgré les ruptures et les changements. Ces continuités peuvent
être tracées par la transmission de savoir-faire ou par les trajectoires historiques
d’institutions s’inscrivant — telles les armées — dans des traditions de longue durée.
De ce point de vue, les antécédents coloniaux et néocoloniaux de l’idée et du savoir-
faire de la « guerre au terrorisme » ne sont pas fantasmés.
Dans les territoires qu’ils occupaient, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis
ont ainsi fait l’expérience de la lutte armée contre un ennemi dont les caractéristiques
réelles ou supposées de « combattants irréguliers », de « partisans » ou de « subver-
1
Noam C
HOMSKY
, De la guerre comme politique étrangère des États-Unis, Agone, Marseille,
2004.
Quand l’histoire bégaye…

2
sifs » sont aussi celles qui serviront à définir le « terrorisme » et les « terroristes » :
évanescents, omniprésents, ne portant pas de signes distinctifs, pratiquant la dissimula-
tion, ne respectant pas les normes établies de la guerre, frappant de manière indiscri-
minée, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, le terme de « terroriste » sera d’ailleurs
souvent apposé par les forces coloniales à ces combattants irréguliers, presque systé-
matiquement assimilés au communisme international.
Tel est le cas par exemple de l’Armée de libération nationale malaise (MNLA) :
alors que ses membres étaient d’abord qualifiés de « bandits », ils furent rapidement
rebaptisés « CTs » (pour communist terrorists) par le gouvernement colonial britanni-
que pendant la « Malayan Emergency » (« Urgence malaise »), de 1948 à 1960. De la
même façon, la rébellion du mouvement Mau-Mau au Kenya fut en 1952 officielle-
ment déclarée « terroriste » par l’administration coloniale britannique. Ou encore le
Viêt-Minh pendant la guerre française en Indochine (puis le « Viêt-Công » pendant la
guerre américaine au Viêt-nam) et le FLN pendant la guerre d’indépendance algé-
rienne. La liste est d’autant plus longue que l’on peut y ajouter les mouvements
d’opposition aux occupations coloniales et néocoloniales américaines en Amérique
latine et aux Caraïbes, mais aussi aux Philippines depuis l’insurrection de 1899-1902.
En effet, leurs prolongements pendant la guerre froide, à commencer par le mouve-
ment Hukbalahap (ou « Huk ») aux Philippines, férocement réprimé entre 1945
et 1954, seront presque immanquablement qualifiés de « terroristes » et « communis-
tes ». Il faut pourtant souligner que ces mouvements n’étaient pas tous de gauche, loin
s’en faut ; certains, comme l’EOKA créée en 1955 à Chypre sous administration bri-
tannique, s’identifiaient au contraire à la droite nationaliste.
C’est en tout cas par ces expériences que la lutte antiterroriste est devenue un des
savoir-faire des corps expéditionnaires des forces armées à tradition coloniale, ce qui
ne sera pas sans effet sur les dispositifs actuels de « guerre contre le terrorisme » en
Afghanistan et en Irak. Il n’est par exemple pas étonnant que le US Marine Corps
(USMC), bénéficiant d’un savoir-faire hérité notamment des « banana wars » néoco-
loniales en Amérique centrale au début du siècle dernier
2
, soit avec les forces spéciales
sur le devant de la scène de la GWOT depuis le 11 septembre. En témoigne par exem-
ple le fait que la province réputée la plus instable d’Irak, Al-Anbar, ait été de facto
placée sous la responsabilité des Marines (lesquels n’ont pas hésité à s’autoproclamer
« America’s 9/11 Force »).
La genèse coloniale du savoir-faire militaire en matière de lutte contre le terrorisme
n’implique évidemment pas un retour de la colonisation ou du colonialisme, les tech-
niques coloniales ne pouvant être considérées indépendamment du contexte historique
qui les a fait émerger. Mais encore faut-il s’accorder sur ce que l’on peut entendre par
« colonial », terme dont les sens et les connotations sont très variables (ce qui a no-
tamment permis aux représentants américains de toujours nier officiellement la dimen-
sion coloniale de certains épisodes de l’histoire américaine). Le terme sera ici utilisé
2
Le manuel du corps des Marines sur les small wars de 1940, synthétisant les enseignements tirés
de ces « guerres de la banane », constitue de ce point de vue un classique, aujourd’hui considéré par
les Marines comme hautement pertinent dans le cadre du contre-terrorisme en Irak et en Afghanistan.

3
pour désigner une période, celle qui s’ouvre avec les « grandes découvertes » au
XVI
e
siècle et se clôt théoriquement avec la décolonisation, mais aussi une pratique, la
mise sous influence de territoires « allogènes ». Aussi y inclurons-nous non seulement
les colonies au sens propre du terme (s’accompagnant de domination politique de terri-
toires et de sujétion de leurs populations), mais aussi les protectorats, les dominions et
les territoires rattachés comme l’Algérie pour la France ou les Philippines pour les
États-Unis. Il faut également souligner que la période de la décolonisation a prolongé
certaines pratiques de « gouvernance à distance » d’États postcoloniaux, en particulier
par adaptation de la technique de l’indirect rule britannique. On parlera à ce propos de
néocolonialisme.
Il faut tenir compte enfin du fait que les termes de colonialisme et de néocolonia-
lisme peuvent renvoyer à des réalités locales très différentes. Dès lors, il ne s’agira ici
en aucun cas de minimiser les singularités sociologiques des types de violence locale
secouant les territoires colonisés, ni de contester certaines des distinctions conceptuel-
les utilisées pour les décrire, comme celle entre « guérilla » et « insurrection ». Il s’agit
simplement de souligner que ces formes de violence locale ont conduit les forces ex-
péditionnaires occidentales à développer des savoir-faire particuliers, cassant la dis-
tinction entre ce qui relève classiquement de la sphère interne des États — et donc de
la police — et ce qui est propre à la sphère externe — et donc à la diplomatie et à la
guerre. Ce savoir-faire colonial de maintien de l’ordre s’est ainsi élaboré dans les in-
terstices des paradigmes dominants de la sécurité, ceux de la police en interne et de la
guerre interétatique en externe. C’est ce savoir-faire qui sert souvent aujourd’hui dans
la lutte militaire contre le terrorisme et qui continue d’en structurer certaines pratiques.
Ainsi, dans une certaine mesure, on peut bien dire que l’histoire bégaye…
La guerre classique, celle dont traitent la plupart des livres de stratégie militaire,
n’existe plus : ce n’est pas le constat d’un pacifiste, mais d’un général britannique em-
preint de pragmatisme, Rupert Smith. Dans un livre publié en 2005
3
, il montre que les
conflits contemporains impliquant des militaires « occidentaux », ceux qu’il appelle
les « guerres parmi les populations », sont radicalement différents des guerres interéta-
tiques classiques : l’enjeu stratégique y est l’adhésion des populations civiles locales
au mandat politique des militaires et non l’épreuve décisive de la force sur le champ de
bataille. Mais si ces « autres guerres » paraissent aujourd’hui centrales aux militaires
occidentaux, elles n’en sont pas pour autant nouvelles.
Certes, pendant la guerre froide, elles étaient vues surtout, à l’aune de la confronta-
tion bipolaire, comme des « conflits périphériques » découlant d’une stratégie
d’« approche indirecte » — selon l’expression de l’historien britannique Basil Liddell-
Hart
4
— de la part de l’URSS pour subvertir l’équilibre des puissances. Le discours
stratégique alors dominant a ainsi souvent empêché d’analyser ces conflits dans leur
3
Rupert S
MITH
, The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, Allan Lane, Londres,
2005.
4
Basil H. L
IDDELL
-H
ART
, Stratégie, Albin Michel, Paris, 2001.
Les « autres guerres » et l’enjeu des populations

4
singularité pour réduire leurs acteurs — lorsqu’ils étaient défavorables au bloc occi-
dental — à une « cinquième colonne » au service du bloc communiste. Cela n’a ce-
pendant pas empêché un savoir spécifique sur ces conflits de se développer à l’ombre
du paradigme dominant de la dissuasion nucléaire. Or ce savoir stratégique périphéri-
que, que ce soit sous la forme de la « contre-insurrection », de la « guerre révolution-
naire », « antisubversive », de « faible intensité » ou de « contre-guérilla » dans les
espaces coloniaux et postcoloniaux — savoirs eux-mêmes inspirés de la « pacifica-
tion » à la française ou de la « police impériale » (imperial policing) britannique, tou-
tes deux bien antérieures à la guerre froide —, nous apprend trois choses importantes.
Premièrement, ces savoirs (et les savoir-faire qui en découlent) structurent forte-
ment les discours stratégiques contemporains sur les « guerres asymétriques » ou ce
que le général Rupert Smith appelle la « guerre parmi les populations ». Ainsi, on peut
noter que le terme de « guerre dans la foule », lancé en 1956 par le colonel Jean Némo
pour décrire le type d’opérations dans lesquelles l’armée française était engagée en
Algérie (après l’Indochine), a précédé de cinquante ans celle de « guerre parmi les po-
pulations ». Par ailleurs, les références aux auteurs britanniques de la contre-
insurrection coloniale (Thompson, Kitson) ou français de la « guerre révolutionnaire »
(Lacheroy, Trinquier, Galuga…) et de la pacification coloniale (Lyautey, Gallieni)
sont pléthore dans les textes doctrinaux contemporains traitant de l’engagement des
militaires dans les « nouveaux conflits ».
Deuxièmement, il ne s’agit pas d’un savoir stratégique et doctrinal homogène et
consolidé, mais d’un ensemble disparate d’éléments hétérogènes qu’il faut à chaque
fois replacer dans leur contexte d’origine. Cependant, une de leurs caractéristiques
communes, outre le fait qu’ils se définissent par leur non-conformité aux normes de la
« guerre classique », est de souvent placer les populations au centre de leurs analyses
— et non pas le front linéaire séparant l’ami de l’ennemi, comme dans les guerres
clausewitziennes. Il s’agit de la « population à l’intérieur » de l’État en guerre à
l’extérieur (on parlera alors de « front intérieur »), mais aussi et surtout de
la population du territoire occupé par les militaires (dans ce cas, on a souvent parlé de
« guerre en surface »). L’enjeu est alors d’identifier, d’isoler et de « neutraliser »
l’ennemi se cachant au sein de la population ; ce qui suppose de la connaître, de la
contrôler et si possible d’obtenir son allégeance ou son obéissance. En ce sens, ces
engagements se distinguent des guerres clausewitziennes (ou « trinitaires », selon
l’expression de l’historien israélien Martin van Creveld
5
), fondées sur la distinction
claire entre gouvernement, forces armées et populations. Ils voient en effet s’opérer
une interpénétration des facteurs politiques, des facteurs militaires et des enjeux liés à
la gestion des populations. On considérera alors souvent que la population est le « cen-
tre de gravité » des forces armées engagées dans ces conflits.
Enfin, troisièmement, dans la mesure où un des enjeux de ces conflits est la délégi-
timation de l’adversaire aux yeux des populations, le respect de l’ennemi auquel on se
mesure — caractérisant théoriquement les « guerres classiques » — cède la place à la
5
Martin
VAN
C
REVELD
, The Transformation of War, Free Press, New York, 1991 (traduction fran-
çaise : La Transformation de la guerre, Le Rocher, Monaco, 1998).

5
stigmatisation de l’ennemi, désormais perçu comme « criminel », « bandit », « subver-
sif » ou « terroriste ». Il est vrai que, depuis la campagne d’Espagne de Napoléon Bo-
naparte (1808-1813), le terme plus neutre de « guérilla » était entré dans le vocabulaire
militaire pour désigner le type de « combat irrégulier » mené par des petites unités
mobiles et flexibles pratiquant, souvent en civil, le harcèlement et les attaques ponc-
tuelles. Mais l’expérience de la guérilla espagnole était maintenue dans un cadre
d’analyse stratégique somme toute relativement classique, dans la mesure où elle ne
pouvait être déconnectée du soutien que lui fournissait la Grande-Bretagne. Elle n’était
perçue que comme un « sous-produit » de la guerre classique. C’est avec les guerres
coloniales, néocoloniales et de décolonisation que va se systématiser l’engagement des
militaires contre un ennemi qualifié de terroriste — ou plus souvent comme « ayant
recours au terrorisme ». Ces types de conflits coloniaux deviendront alors un labora-
toire de lutte contre les formes de violences sortant du cadre normatif de la violence
légitime, sous les vocables de piraterie, de banditisme, de guérilla ou de terrorisme.
Il est difficile de décrire simplement l’ensemble des pratiques développées pour lut-
ter contre la « subversion », le « terrorisme » et les formes de violence protéiforme
dans le contexte des expériences coloniales et néocoloniales depuis la fin du
XIX
e
siècle. En effet, ces pratiques sont très diversifiées, selon les puissances colonia-
les et selon la zone régionale considérée. On peut cependant noter qu’à partir de la fin
du
XIX
e
siècle, ce savoir-faire de « pacification » (pour reprendre le terme utilisé par
les troupes coloniales françaises) ou de « small wars » puis de « police impériale »
(pour reprendre le terme britannique) tend à se systématiser avec la conquête de Ma-
dagascar et de l’Indochine par la France, l’annexion des Philippines par les États-Unis
et la guerre des Boers en Afrique australe. Un ensemble de pratiques se met alors en
place, qui va constituer un fond commun de savoir-faire colonial de sujétion de popu-
lations puis de maintien de l’ordre, même si celui-ci sera chaque fois mis en œuvre de
manière ad hoc. Ce fond commun évoluera considérablement jusqu’aux guerres de
décolonisation dans les années 1950 et 1960, moment à partir duquel il sera théorisé,
formalisé et mis en cohérence sous différentes formes.
Ces formalisations, que ce soit au travers de la guerre non-conventionnelle puis de
la contre-insurrection américaine, celle de la contre-insurrection britannique ou de la
doctrine de la « guerre révolutionnaire » française
6
, sont pour partie (mais pour partie
seulement) une mise en système et une synthèse renouvelée des enseignements dispa-
rates tirés des expériences précédentes des « troubles » dans les colonies
7
. Les échan-
ges de savoirs et de savoir-faire entre puissances coloniales deviendront également de
plus en plus fréquents à cette période. On peut ainsi isoler les éléments communs de
ces doctrines. Cela est d’autant plus vrai qu’à partir des années 1950, la référence à la
pensée de Mao Zedong devient omniprésente à mesure que l’objectif de maintenir
6
Voir Roger T
RINQUIER
, La Guerre moderne, La Table ronde, Paris, 1961.
7
Cela est montré de manière convaincante pour le cas britannique par Thomas R. M
OCKAITIS
, Bri-
tish Counterinsurgency in the Post-Imperial Era, Manchester University Press, Manchester, 1995.
De la pacification coloniale aux guerres de décolonisation
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%